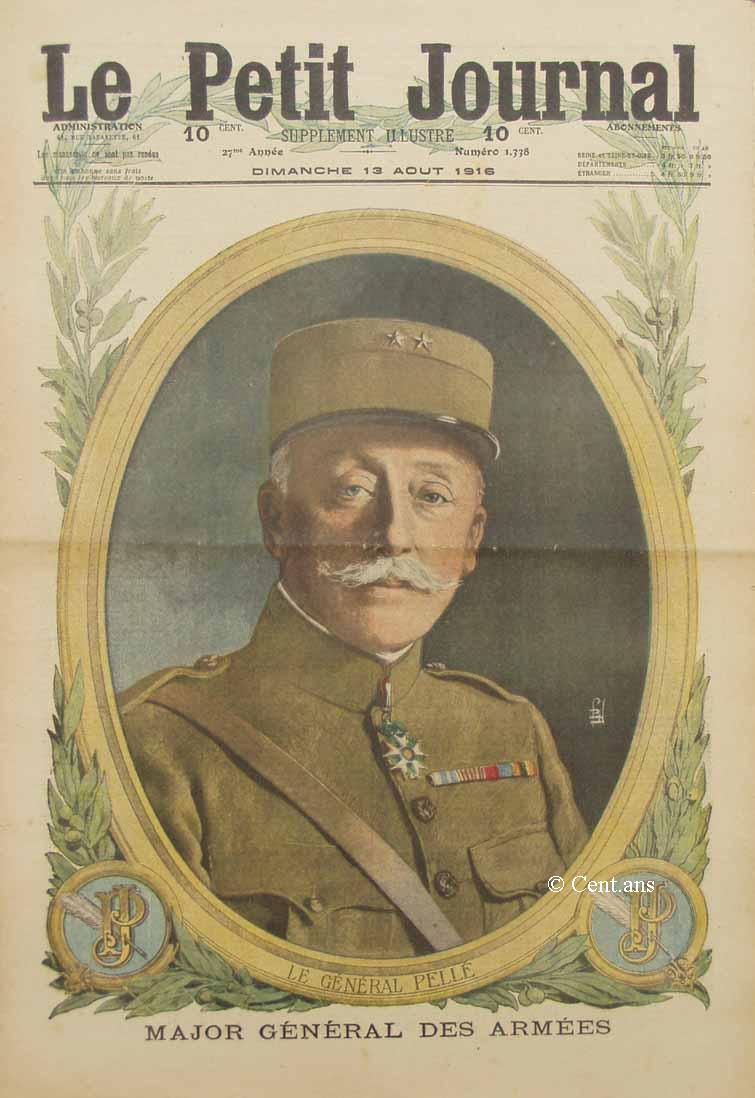LE GÉNÉRAL PELLÉ
major général des armées
Le général Pellé est le
collaborateur le plus direct du général en chef. Il joue
auprès du général Joffre ou du général
de Castelnau le rôle que jouait naguère Berthier auprès
de Napoléon.
Pour être moins éclatant que celui des commandants d'armées,
ce rôle n'en est pas moins des plus considérables et des
plus utiles.. .
On conçoit de quelle importance est la fonction d'un major général
des armées en un temps où les armées se chiffrent
par millions. Le général chargé de la remplir est
de ceux dont le portrait ne saurait être oublié dans une
galerie telle que la nôtre.
Avant la guerre, le général Pellé a appartenu aux
troupes marocaines. Il fait partie d'une famille éminemment militaire
et porte nom qui déjà fut illustré il y a quarante-six
ans, notamment à Wissembourg.
VARIÉTÉ
Les cris du ventre
Les précautions de l'Allemagne. - Comment s'épuisent les ressources les plus considérables. - L'appétit allemand. - La fin par la faim.
Il y a deux ans, l'Allemagne partait gaillardement
à la conquête du monde. Comme un torrent, la masse irrésistible
des casques à pointe roulait sur la Belgique puis sur le Nord
et sur l'Est de la France. Les bataillons passaient dans les villes,
au pas de parade. Et, tout en maudissant les brutalités de I'envahisseur,
on s'émerveillait de voir ces soldats superbes, bien équipés,
bien nourris qui défilaient en chantant sur des rythmes de cantiques
leur orgueil et leurs espoirs.
C'était l'ère de l'abondance. L'Allemagne avait longuement
préparé les munitions du ventre comme les autres munitions.
D'immenses approvisionnements de bétail avaient été
faits. L'Allemagne, grosse mangeuse de viande (elle en consommait au
début de la guerre, plus de sept millions de kilos par jour),
avait pris ses précautions. Elle possédait au mois d'août
1914, du bétail sur pied représentant plus de six milliards
de kilos de viande.
Avec une telle avance, on peut regarder l'avenir avec quelque confiance.
Les Allemande le considéraient avec d'autant plus de sérénité
que leur outillage alimentaire était à la hauteur de leurs
ressources.
Alors que nous n'avions pas même aux Halles de Paris, une chambre
froide pour la conservation des denrées, l'Allemagne possédait
plus de trois cent cinquante usines frigorifiques, plus une dizaine
d'usines militaires, appartenant à l'Etat, et chargées
d'assurer le ravitaillement des armées d'une manière normale.
Près de chaque abattoir, il existait une usine frigorifique,
et, dès le temps de paix, les troupes avaient été
habituées à consommer de la viande congelée.
Le blé seulement pouvait manquer car, annuellement, la différence
entre la production et la consommation donne un déficit de plus
de deux millions de tonnes. Mais les Boches, là encore, avaient
pris leurs précautions. Ils avaient consacré à
d'immenses approvisionnements de grains une partie de leur trésor
de guerre. Et, de plus, l'alliance autrichienne leur permettait de compter
sur les ressources considérables en céréales de
la Hongrie.
Enfin, la question du pain leur apparaissait infiniment moins importante
que celles de la saucisse ou de la pomme de terre. On sait que l'Allemand
n'est qu'un petit mangeur de pain et que, même en temps de paix,
il ne mange que du pain très médiocre. La perspective
du pain K et même du pain K K ne pouvait l'effrayer.
L'essentiel est qu'on pût manger beaucoup de saucisses et beaucoup
de pommes de terre. Avec cela, on était sûr que les soldats
marcheraient et que les civils tiendraient.
Au surplus, les approvisionnements étaient calculés pour
une période beaucoup plus longue que celle qu'assignaient à
la durée de la guerre messieurs les prophètes du grand
état-major impérial. Chacun sait qu'en un mois on devait
avoir raison de la France, et que l'écrasement de la Russie ne
devait pas demander beaucoup plus d'efforts. En mettant les choses au
pire, tout serait fini pour Noël.. Et alors, que de brocs vidés
et que de saucisses englouties dans la joie du triomphe !...
***
Ces belles prévisions ne se réalisèrent pas. Les
Boches s'aperçurent vite que la guerre serait plus longue qu'ils
ne l'avaient prévue. Rendons leur cette justice. Plus sages que
les Parisiens de 1870, ils ne dilapidèrent pas leurs ressources.
Au contraire, ils s'ingénirent à les faire durer le plus
longtemps possible.
Dès les premiers mois de 1915, on nous parlait de la famine en
Allemagne. C'était aller un peu vite en besogne. La famine était
encore loin ; mais les Boches commençaient à la redouter
et s'organisaient pour en retarder l'échéance.
On eut peut-être le tort en France, d'attacher trop d'importance
à certains ra****, a certaines manifestations
qui ne tendaient à rien moins qu'à nous faire croire que
l'Allemagne en était à sa dernière saucisse. L'Allemagne,
à la vérité, commençait à se serrer
le ventre et à se rationner. Mais elle n'en était pas
encore à la disette.
Les classes dirigeantes donnaient l'exemple de la frugalité nécessaire.
L'empereur tout le premier avait ordonné que le train culinaire
de sa maison fût réduit considérablement.
Dès le mois de mars 1915, l'impératrice avait quitté
le château royal dont les vastes appartements déserts lui
causaient de la dépression. Elle s'était installée
à Monbijou, nom que porte un ensemble de plusieurs pavillons
situés dans le vieux Berlin, n'ayant auprès d'elle que
deux demoiselles d'honneur.
« De temps en temps, disait alors une correspondance de Berlin,
le Kaiser y fait une courte apparition. II vient pour voir si l'on s'est
conformé aux nécessités du régime alimentaire.
Et le genre de vie à la cour a, en effet, radicalement changé.
Les repas y sont d'une modestie inouïe. Le premier déjeuner
de l'impératrice Augusta-Victoria consiste en une tasse de thé
et un seul oeuf à la coque. A midi, une soupe, un seul plat de
viande et quelques fruits. Pour dîner, une soupe, un plat de viande
et un plat de farine, nouilles ou macaroni. Les pommes de terre ne sont
servies qu'en robe de chambre ; éplucher le tubercule cru, c'est
gaspiller de la matière comestible.
» L'empereur ne manque jamais, ajoutait l'auteur de cette correspondance,
de faire de la propagande pour le pain K. Parfois, il force les siens
à grignoter en public du fameux pain de guerre... »
L'exemple sans doute n'était pas inutile, car ce pain de guerre
était bien mauvais, et les Allemands, si peu friands qu'ils fûssent
de bon pain, avaient quelque peine à s'y habituer.
Ils commençaient aussi à trouver la vie chère,
la guerre longue et le rationnement excessif. Comme à Paris en
1870, les classes moyennes souffraient tout particulièrement.
Les pauvres vivaient - mal sans doute - des libéralités
de l'État ; les riches pouvaient encore, à prix d'or,
se procurer le nécessaire et même le superflu ; mais les
gens de la petite bourgeoisie, dont la guerre avait déjà
diminué les ressources, éprouvaient les plus grandes difficultés
à vivre.
Vers la fin de l'année 1915 se produisirent les premières
émeutes sur les marchés. « Nous voulons nos hommes
! » et « Nous voulons du pain ! », criaient les ménagères.
La police les dispersa à coups de sabre.
Ce n'était pas le moyen d'arranger les choses. Les émeutes
se renouvelèrent, se multiplièrent, gagnèrent de
proche en proche.
Le gouvernement allemand, avec cet esprit pédagogue qui distingue
le caractère de cette nation, s'avisa qu'on pourrait suppléer
à la distribution de victuailles par une distribution de bons
conseils. Des conférences furent organisées pour apprendre
aux ménagères à tirer parti des ressources alimentaires
dont elles pouvaient disposer. Conférenciers et conférencières
furent assez mal reçus.
« Récemment, écrivait une femme à son mari,
j'ai assisté à une assemblée de femmes. Deux dames
de la bonne société voulaient nous apprendre, à
nous, femmes d'ouvriers et de cultivateurs, comment nous devons économiser.
Et il y avait de quoi se mettre en colère. On disait que nous
devions et pouvions préparer des plats nourrissants sans viande,
sans oeufs, sans graisse et sans farine. Voilà un dîner,
Point de goûter. Avec, un petit morceau de pain et une portion
de fromage on pouvait apaiser la faim. Mais où prendre du fromage
puisque les fruiteries sont fermées ?.. Il faudrait que tu entendes
les cultivateurs crier, lorsqu'on leur enlève leur blé.
Si cela continue, les gens vont se prendre à la gorge. »
-Vouloir que les femmes du peuple fissent de la cuisine sans graisse
et se contentâssent de deux repas par jour, c'était, en
effet, demander une chose difficile. On sait que l'Allemande est, en
temps normal une infatigable mangeuse. On raconte à ce propos
dans le pays rhénan une histoire que Jules Huret a recueillie
dans un de ses articles sur l'Allemagne et qui, bien qu'elle ait l'air
d'une charge, est une peinture parfaitement exacte de la goinfrerie
des femmes du peuple boche.
Un Anglais, raconte Huret, était venu s'installer à Cologne
et avait appelé une femme pour faire sa lessive et celle de sa
famille. Avant de l'engager, il lui demanda ses conditions :
- Eh bien, voilà, dit-elle, j'arriverai chez vous à six
heures du matin.
- Si tôt ? s'étonne l'Anglais.
- Oui, c'est l'heure de mon premier déjeuner.
- Aoh ! fait l'Anglais.
- Oui, vous me donnerez du café au lait, pas très fort,
du pain et du beurre. Puis, je travaillerai jusqu'à huit heures
et demie. Alors je recevrai du jambon et de la bière. A dix heures
et demie, je recevrai encore un peu de café et de pain à
la graisse. A une heure c'est le dîner : je prends de la soupe,
de la viande, des légumes, de la bière, et du café.
A quatre heures, je recevrai un morceau de fromage, du café et
du pain. A six heures une tartine avec un bout de saucisson. A huit
heures, pour le souper, je ne suis pas difficile, vous me donnerez ce
que vous voudrez. Et vous me paierez 3 marks 50.
- Et si je vous priais de manger toute la journée, demanda l'Anglais,
combien me prendriez-vous ?
Cette histoire, je le répète, a l'air d'une plaisanterie
; elle est pourtant, sous sa forme humoristique, on ne peut plus vraisemblable.
En temps normal, l'ouvrière allemande - et l'ouvrier, naturellement
- font de six à huit repas par jour. Sans doute toute cette nourriture
qu'ils engloutissent n'est pas très , relevée. Peu importe
! Ce qui compte pour le Boche, ce n'est pas la qualité, c'est
la quantité. Que le pain soit un peu plus mauvais en temps de
guerre qu'en temps de paix, que la graisse sente le vieux cuir et la
charcuterie le moisi, ça n'a pas d'importance pourvu qu'on mange
à son appétit.
Or, l'appétit allemand est une chose impérieuse et kolossale
contre laquelle les objurgations du patriotisme n'eurent pas grand effet.
C'est assez dire que les conférenciers qui prêchaient l'abstinence
n'eurent guère de succès. Dans une lettre trouvée
sur un prisonnier allemand, la femme du dit prisonnier, habitant Neun-Kirchen,
lui racontait en février dernier :
« Un monsieur est venu faire une conférence. Il a dit :
« Il faut travailler beaucoup et manger peu ». Il était
temps qu'il s'en aille : on l'aurait écharpé. »
****
Dès lors, les civils allemands ne cachent plus leurs affres ;
et nous avons aujourd'hui maintes et maintes preuves de la disette grandissante.
Un livre des plus intéressants vient de paraître à
ce propos sous ce titre : « l'Aveu ». C'est un recueil et
un commentaire des lettres trouvées sur les prisonniers allemands
à Verdun.
L'historien Louis Madelin en est l'auteur.
« J'ai eu sous les yeux, dit-il, pour la période mars-mai
1916, cent lettres où la question des vivres se pose et où
la charcuterie occupe une telle place qu'on en sort avec une sorte de
nausée.
» On pourrait, avec ces cent lettres, dresser un tarif des denrées
de toute sorte des Vosges à la Vistule et de la Baltique aux
Monts de Bohème : car de Berlin aux petits villages et d'Essen
à Oberammergau, on n'hésite pas à mettre sous les
yeux des soldats des chiffres effrayants. Je renonce à pénétrer
dans les détails de ce drame alimentaire et d'ailleurs pathétique.
L'Allemand prend fort naturellement au tragique, - ayant une forte propension
aux points de vue comestibles - une saucisse qui coûte 3 marks
60 la livre et dont après six heures de queue, une bataille entre
femmes, quelques coups de poing et même de plat de sabre, on touche
un demi-quart à peine de la main condescendante d'un charcutier.
» Je m'arrête à quelques traits en passant, sans
sombrer dans l'océan des chiffres. A Berlin (14 mars) «
la question des vivres est devenue épouvantable. il n'y a plus
ni beurre, ni sucre, ni café. La viande de porc a déjà
complètement disparu depuis longtemps et on n'a la permission
de fabriquer du chocolat qu'en petite quantité... Les pommes
de terre, qui forment le fond de l'alimentation des classes pauvres,
deviennent une délicatesse et leur prix augmente d'une façon
colossale... Finalement il faudra que ce soient les soldats qui envoient
du front quelque chose à manger, ajoute le Berlinois, car on
répond toujours que tout a été réquisitionné
pour l'armée... »
D'Edgardkirch, le 15 mai : « Cela ne peut pas durer très
longtemps, il règne une grande misère dans les villes.
Ils ont bien des cartes de beurre, mais ils ne peuvent pas trouver de
beurre. Il en est de même pour tout. Les pommes de terre sont
réquisitionnées. Demain ce sera le tour du foin et de
la paille. Le garde champêtre passera, mesurera et calculera d'après
le nombre de têtes de bétail. » De Wilhelmetahl (Westphalie),
le 5 mars, on se plaignait déjà que des gens volaient
les chiens pour faire leur « pot-au-feu » ; on en fait maintenant
des saucisses.
De Lippstadt, le 25 mai : « ... On a encore souscrit 10 milliards
500 millions, mais quoi sert l'argent quand les vivres manquent ? »
De Mayence, le 2 avril, s'élève ce cri pathétique
pour qui a vécu de l'autre côté du Rhin : «
L'Allemagne n'a plus de pomme de terre ! Il nous faut manger ce que
l'on donnait autrefois aux cochons. » C'est épouvantable,
écrit-on de Halle, le 2 avril, tous les jours ne manger que des
tartines de compote et de marmelade ; on finit par devenir soi-même
compote et marmelade. Et il faut être là à l'heure
exacte et s'avancer au pas de parade, sinon l'on n'a rien.» De
Berlin-Treptore, le 6 avril : « Le pain dit « de guerre
» qu'il nous faut manger est une masse gluante et brune... C'est
une vraie nourriture pour les cochons, mais comme il n'y a pas de cochons
pour le manger, c'est à nous de le faire. Quant aux cochons,
ils sont actuellement fumés et pendus dans les lardoirs des riches
agrariens... » De Hambourg, le 11 avril : « les articles
disparaissent l'un après l'autre, jusqu'au moment où il
n'y aura plus rien du tout, et alors ce sera la fin. »
De Chanlottenburg, le 12 : « Il faut maintenant faire la guerre
pour le sucre comme pour le beurre et une fois qu'on est dans la boutique,
on vous dit qu'il n'y en a plus. Tu ne peux savoir dans quelle colère
on se met... » D'Osnabrück, même date : « J'espère
que pour la Pentecôte tu seras de retour auprès de nous...
car je suis d'avis que la guerre ne peut plus durer longtemps, car il
y a ici une telle misère que c'est une honte (Schmalchlapporci)...
»
D'Essen, le 16 : « On pourra bientôt instituer un Comité
de famine, car on n'a plus rien pour son argent. »
De Düsseldorf, le 17 avril : « Si la guerre dure encore longtemps,
nous mourrons de faim. » De Berlin-Schmargendorf, le 21 avril
: Nous n'avons plus qu'à nous coudre l'estomac pour n'avoir plus
besoin de manger.»
Les parents du Musketier H..., du 20e régiment, lui écrivent
: « Il n'est plus possible de vivre et même pas de mourir
(sic) Combien de temps faudra-t-il pour avoir une fin ? Jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus d'hommes ? »
***
Voilà leur état d'esprit dépeint
d'après eux-mêmes. Concluez...
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 13 août 1916