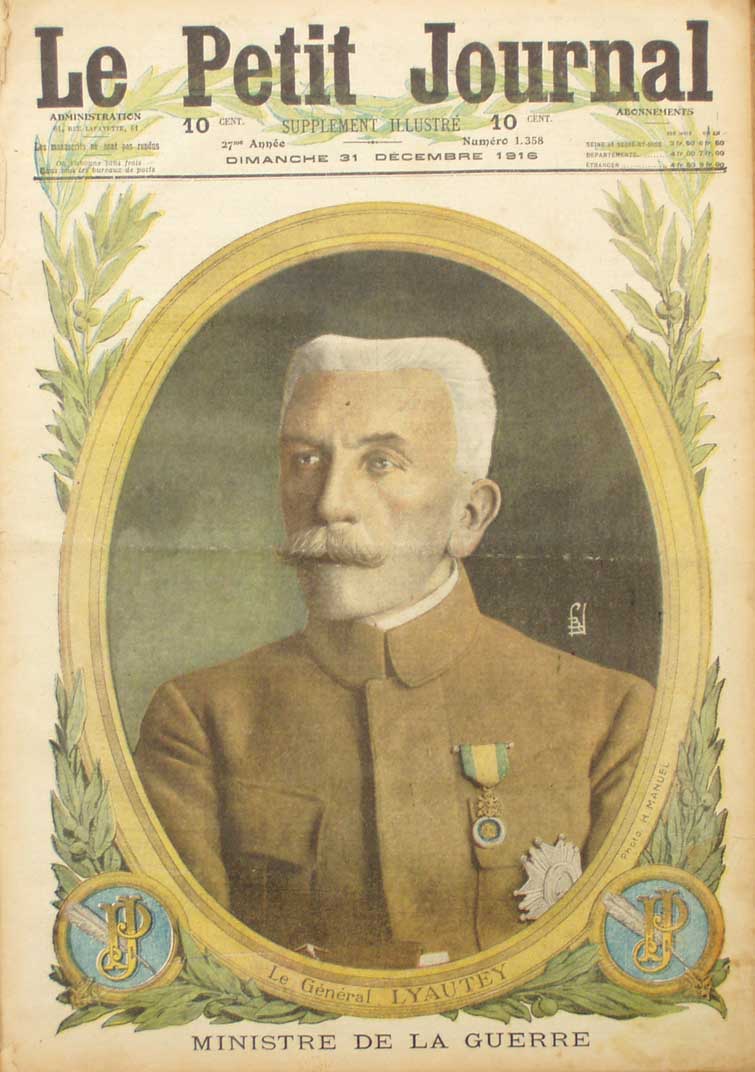Le général Lautey
Ministre de la Guerre
Le général Louis-Hubert-Gonzalve
Lyautey, ministre de la Guerre, a soixante-deux ans. Il est né
à Nancy le 17 novembre 1854. Petit-fils d'un général
de division qui fut sénateur sous le second empire, il entra
à Saint-Cyr le 24 octobre 1873.
Il fut nommé sous-lieutenant de cavalerie le 1er octobre 1875,
lieutenant le 20 décembre 1877 ; capitaine le 22 septembre 1882
; chef d'escadrons le 22 mars 1893 ; colonel le 6 février 1900
; général de brigade le 9 octobre 1903 ; de division le
30 juillet 1907. Il est grand-croix de la Légion d'honneur depuis
le 17 Septembre 1913. L'Académie française l'a élu
peu de temps avant la guerre au fauteuil laissé vacant par la
mort du général Langlois ; mais sa réception a
été ajournée en raison des événements
Le général Lyautey est un des plus illustres parmi ces
chefs qui se formèrent dans les expéditions coloniales
et dont la présente guerre donne tous les jours l'occasion d'apprécier
l'énergie et les talents militaires.
Jeune chef d'escadron de cavalerie, il avait obtenu de suivre Galliéni
au Tonkin, puis à Madagascar, et tout de suite il s'était
distingué parmi ses meilleurs lieutenants, non pas seulement
par sa belle tenue dans combats, mais aussi et surtout par ses hautes
qualités d'administrateur.
Lorsque Lyautey quitta Madagascar, en 1902, Galliéni lui adressa
une lettre rappelant l'œuvre accomplie et se terminant ainsi :
« J'émets le voeu que le gouvernement fasse encore appel
à votre patriotisme pour présider à l'épanouissement
d'une oeuvre coloniale nouvelle dont votre expérience assurera
le succès. » Dix ans plus tard, en 1912, le vœu de
Galliéni devait s'accomplir : Lyautey fut nommé résident
général et commandant en chef au Maroc.
Il prenait possession de ses fonctions en une période critique,
au lendemain des sanglantes émeutes de Fez, alors que l'empire
chèrifien en feu semblait devoir nous échapper. En quelques
mois, il sut rétablir une situation presque que désespérée
; il délivra Fez de bandes qui l'assiégeaient, il fit
occuper Marrakech, mettant ainsi fin à la menaçante agitation
du Sud ; il refoula les tribus berbères dans l'Est, vers l'Atlas.
;
En 1913, par les expéditions des généraux Gouraud
et Baumgarten à Khenifra et à Taza, il opéra la
jonction entre le Maroc occidental et le Maroc oriental.
Dès lors, le Maroc était conquis et presque pacifié.
« Tout le monde sait aujourd'hui, dit M. Eugène Tardieu,
dans une excellente étude sur le nouveau ministre, qu'au premier
jour de la guerre, devant la nécessité de ramener en France
toutes les troupes occupant le Maroc, on suggéra au général
Lyautey de ramener ses forces a la côte et d'abandonner ainsi
provisoirement le Maroc lui-même. Résolument, le général
Lyautey s'y refusa. Il mobilisa sur place tous les Français résidant
au Maroc, leva des régiments indigènes, envoya en Fronce
un contingent plus élevé que celui qu'on attendait de
lui et poursuivit la lutte. Les intrigues allemandes furent maîtrisées,
les tribu rebelles maintenues grâce à des prodiges d'héroïsme
de la part des troupes qui restaient en terre marocaine; et en pleine
guerre le général Lyautey inaugurait cette Exposition
de Casablanca, bientôt suivie de la foire de Fez, in manifestations
qui attestaient d'une manière éclatante la pérennité
de notre action pacifique au Maroc...»
Et notre confrère ajoute :
« Le nouveau ministre de la Guerre est par dessus tout un homme
d'idées et de réalisation. »
VARIÉTÉ
Le jouet boche et le jouet français
L'invasion de la camelote allemande. - Poupées d'autrefois. - Quelques chiffres. - Le jouet des enfants de France doit être un jouet français.
Avant de nous envahir avec leurs armées, les Boches nous avaient
envahis avec leur camelote.
Or, de tous les articles de la camelote allemande, le jouet boche fut,à
coup sûr, l'un des plus envahissants.
Le jouet, pourtant, avait été, de tout temps, une spécialité
française et même spécialité parisienne.
Nuremberg, il est vrai, exportait ses jouets dès le XVIe siècle
; mais, à cette époque, Paris s'était fait depuis
longtemps déjà une spécialité des jouets
jolis et de bon goût. Nuremberg ne pouvait pas lutter contre la
délicatesse de main-d'oeuvre et le savoir-faire de l'ouvrier
parisien.
Les poupées de Paris étaient déjà célèbres.
On vantait dans l'Europe entière l'habileté de l'ouvrier
qui les modelait, le bon goût de l'habilleuse qui faisait leur
toilette.
C'est que Paris était déjà la ville qui donnait
le ton pour la coquetterie, la ville vers laquelle étaient tournés
les yeux et les désirs des femmes du reste du monde.
On conçoit qu'elle devait être aussi la plus fameuse pour
les petites filles qui aimaient les poupées jolies et bien attifées.
Aussi les chefs-d'oeuvre des poupetiers parisiens étaient-ils
estimés partout, même en Allemagne.
En 1571, la duchesse de Baviére eut une fille. La duchesse de
Lorraine voulut faire un présent à la petite princesse.
Et, tout de suite, elle pensa à lui envoyer quelques belles poupées
de Paris. Elle n'alla pas les chercher à Nuremberg, bien que
cette ville fût tout près de Munich.
Mais la poupée parisienne, en ce temps-là, n'était
pas seulement un jouet pour petites filles ; c'était encore une
auxiliaire de la mode. C'est elle qui avait pour mission de porter dans
les provinces et à l'étranger les modèles du bon
goût français et de l'élégance parisienne.
Dès le début du XVIe siècle, à chaque changement
de saison, c'est-à-dire à chaque changement de mode, on
envoyait de Paris en Flandre, en Allemagne et autres lieux, de petites
figurines modelée par les poupetiers parisiens et habillées
par les ouvrières parisiennes suivant la dernière mode
de la capitale. Elles s'en allaient ainsi, ces gracieuses poupées
de Paris, donner aux nobles dames des cours étrangères
une idée exacte de la mode de Paris.
Dès lors, il ne se passa plus une année sans qu'on se
servît de ces messagères pour répandre au loin les
élégances françaises. Et les poupées portèrent
ainsi par le monde toute les modes qu'invente la fantaisie des belles
dames et que réalisa le talent des bonnes faiseuses.
Au XVIe siècle on appelait ces poupées des pandores,
et, souvent, on en envoyait deux en même temps, l'une pour la
grande toilette, l'autre pour le déshabillé : la grande
pandore et la petite pandore.
Au XVIIe siècle, même en temps de guerre avec l'Angleterre,
les poupées françaises avaient droit de passage. La poupée
était la seule chose respectée par les belligérants.
Au temps de Louis XV, époque où le bon goût français
faisait loi par toute l'Europe, on attendait avec impatience, au début
de chaque saison, à Vienne, à Londres, à Bruxelles,
à Berlin, à Madrid, les poupées qui devaient apporter
la mode de Versailles.
Et ces poupées étaient de véritables petits chefs-d'œuvre.
Pas un détail des ajustements qui vogue n'avait été
omis dans leur confection Elles ne reproduisaient pas seulement le costume
de dessous et de dessus, mais encore la coiffure avec toutes ses complications
; elles portaient les mouches aux endroits du visage où, il était
de bon ton de les porter ; elles avaient jusqu'au parfum préféré
des élégantes.
Plus tard, on n'eut plus besoin de ces figurines pour faire connaître
au monde entier les inventions de l'élégance parisienne
; les gravures de mode remplacèrent les poupées. Mais
il est curieux de rappeler qu'au début de la guerre, à
la fin de 1914, alors que beaucoup de journaux de modes avaient suspendu
leur publication, on songea à se servir des poupées comme
au temps passé, pour faire connaître la mode nouvelle à
l'étranger.
Plus de sept cents poupées furent mises à la disposition
d'un groupe de midinettes réunies dans une salle de la Bourse
du Travail. Les grands magasins envoyèrent de la lingerie, des
étoffes. Et bientôt les poupées, transformées
en élégantes Parisiennes mises à la dernière
mode, purent être expédiées aux destinations choisies.
Cinq cents partirent en Amérique, deux cents à Londres.
Et les gracieuses figurines portèrent ainsi à l'étranger
la preuve que, même en temps de guerre, la France restait toujours
la patrie de l'élégance et du bon goût.
***
N'était-il point pénible de constater, en ces dernières
années que cette suprématie dans l'industrie du jouet
en général et de la poupée en particulier qui nous
avait appartenu si longtemps, nous échappait, et que la grossière
camelote d'outre-Rhin triomphait, jusque chez mous, de l'art de nos
bimbelotiers et de nos poupetiers ?
Déjà, dans les dernières années du XIXe
siècle, l'importation en France des jouets et articles dits de
Paris venant d'Allemagne avait pris des proportions inquiétantes.
Elle ne fit qu'augmenter dans les premières années du
XXe, jusqu'à ce qu'éclatât la guerre.
Empruntons à ce sujet quelques chiffres à un économiste,
M. Max Dutray :
« En 1901, dit-il, nous importions d'Allemagne 1.150.203 kilos
de jeux, jouets et autres articles de bimbeloterie. En 1910, nous avons
acheté au même pays 1.871.200 kilos de ces articles, soit
une une augmentation de 720.997 kilos, soit un accroissement de 62 p.
100 en dix ans. En calculant ces quantités au moyen des taux
d'évaluation fixés pour les années 1901 et 1910,
nous obtenons pour l'année 1901 une valeur d'importations d'articles
de bimbeloterie de 8.096.294 fr., et pour 1910 13.038.150 fr... »
Passons à l'article de Paris : c'était bien pis encore
:
Alors qu'en 1901 nous n'importions que 122.860 kilos de bijouterie en
métaux communs, en 1910 les quantités reçues d'Allemagne
ne s'élevaient pas à moins de 272.800 kilos. C'est donc,
en l'espace de dix années, un accroissement de 149.940 kilos,
ou de 122 p 100. En calculant la, valeur de ces articles sur les mêmes
bases que les jouets, nous obtenons 1.627.895 fr. d'importations pour
1901 et 33.545.000 fr.. pour 1910. »
L'économiste concluait de ces chiffres que c'était le
commerce allemand qui profitait surtout de notre générosité
de fin d'année. « Ce que le Bonhomme Noël place dans
les souliers des petits enfants de France, observait-il non sans amertume,
ce sont surtout des jeux, jouets et articles de Paris fabriqués
en Allemagne. »
Pour nous inonder ainsi de leurs produits, les fabricants allemands
usaient d'un moyen qui nos lois douanières favorisaient : Ils
expédiaient leurs jouets et leurs articles de Paris à
demi-façonnés, de manière à bénéficier
à l'entrée du tarif réduit des matières
premières. Un industriel, Allemand d'origine, établi en
France, les recevait et les achevait. Comme la main-d'oeuvre et les
matières premières étaient moins chères
en Allemagne que chez nous, et comme, d'autre part, l'objet allemand
n'avait payé, pour entrer en france qu'un infime droit de douane,
il en résultait qu'on pouvait vendre ici le jouet allemand à
des prix défiant la concurrence française.
La conséquence de ceci, c'est que, tandis qu'il y a trente ou
quarante ans, le chiffre de notre exportation en jouets était
trois fois supérieur celui de l'importation, c'est le contraire
qui se produisait en ces dernières années, et l'importation
dépassait considérablement l'exportation.
En Allemagne contrairement à ce qui se passait chez nous, les
lois douanières protégeaient singulièrement l'industrie
du jouet.
Il y a quelques années une personne que je connais envoya aux
fillettes d'un ses amis établi en Lorraine allemande, un petit
colis contenant quelques joujoux et articles de Paris. Il y en avait
exactement pour une valeur de 26 francs. Savez-vous combien la douane
allemande exigea de droits d'entrée pour ce petit colis déclaré
comme « jouets d'enfants » - Quatorze francs quatre-vingt-dix-sept
centimes !... C'est-à-dire près de soixante p. cent de
la valeur des objets transportés.
L'industrie de Nuremberg était bien défendue, comme vous
voyez, à la frontière boche.
***
Elle était aussi singulièrement protégée
et favorisée en Allemagne.
Les Allemands, pour assurer et développer leur fabrication avaient
créé à Sonnenberg une école industrielle
destinée spécialement à l'enseignement de toutes
les parties de la fabrication du jouet. Cette institution, fondée
en 1883 par les commerçants de Sonnenberg, jouissait d'une double
subvention du gouvernement et de la municipalité.
Chez nous, rien de pareil : des tarifs douaniers favorables à
l'importation étrangère ; des tarifs de transport défavorables,
à notre propre exportation. L'industrie du jouet français
et de l'article de Paris ne pouvait résister à un pareil
traitement. L'année qui précéda la guerre, plus
de 80% des jouets jetés sur le marché étaient d'origine
allemandes. La France qui avait encore, il y a une dizaine d'années
sept ou huit fabriques de têtes de poupées, n'en possédait
plus une seule. Les têtes, les bras, les corps des poupées,
tout était fait en Allemagne. Seules, les poupées de luxe
étaient encore habillées à Paris. Les Allemands,
sur ce point, seulement, avaient renoncé à nous faire
concurrence. Ils s'étaient rendu compte que nulle part au monde
on n'eût su attifer avec autant de « chic » les petites
figurines qui font la joie et l'émerveillement des fillettes.
L'ouvrière française était toujours heureusement,
la première en son art, et, par cet art, les poupées gardaient
du moins quelque chose de réellement français, quelque
chose que l'étranger ne pouvait nous ravir et ne nous ravira
jamais : la grâce, l'élégance et le bon goût.
Pour le reste, les Boches triomphaient, et pour assurer ce triomphe,
ils ne se privaient pas de plagier. Ils nous pillaient à loisir.
Prenant sans scrupules les modèles de jouets imaginés
par nos fabricants, ils les fabriquaient à la diable pour les
lancer sur les marchés de l'étranger. C'était plus
mal fait, mais c'était moins cher ; et ils vendaient.
Tous nos jouets parisiens remarqués au concours Lépine
étaient copiés par eux et fabriqués ensuite par,
des maisons allemandes en dépit des brevets protecteurs.
Parfois, cependant, ils tiraient quelque chose de leur fonds ; et, alors,
on voyait de belles horreurs.
Vous souvient-il de ces poupées aux grosses têtes et aux
gros yeux en boule qu'on vit il y a quelques années, apparaître
aux devantures des marchands ? C'était des poupées importées
d'Allemagne. Si l'on n'avait su qu'elles venaient de par delà
le Rhin, leur laideur eût immédiatement décelé
cette origine.
Les gens capables de fabriquer de telles horreurs témoignaient,
en effet, du goût le plus teuton qui se pût imaginer.
Les poupées avaient la prétention d'être drôles.
Oui, ces laideurs étaient faites dans le but d'amuser les enfants.
La vérité, c'est qu'elles les effrayaient. Ces yeux énormes
donnaient à ces figures des expressions de cauchemar et le premier
sentiment des petites filles, en les regardant, était un sentiment
de répulsion et de peur.
Quelle sottise que de déformer le visage des poupées !
Une pareille idée ne pouvait naître dans des cervelles
allemandes.
La poupée, loin d'avoir une figure de monstre, doit être
parée de toutes les grâces et de toutes les séductions.
Dans l'imagination de la petite fille, la poupée est son enfant.
Comment l'aimera-t-elle, comment la considérera-t-elle comme
sa fille, si la poupée a une figure affreuse et de gros yeux
en boule de loto ?
Nous sommes aujourd'hui de toutes ces horreurs, de toutes ces hideuses
camelotes de l'industrie allemande. La guerre finie, surveillons nos
frontières pour les empêcher de revenir. Protégeons
surtout nos inventeurs, nos fabricants. Faisons revivre cette industrie
du jouet jadis si française par l'ingéniosité et
par la grâce. Le jouet joue son rôle dans l'éducation
de l'enfance. Il faut que 1e jouet des petits enfants de France soit
un jouet français.
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 31 décembre 1916