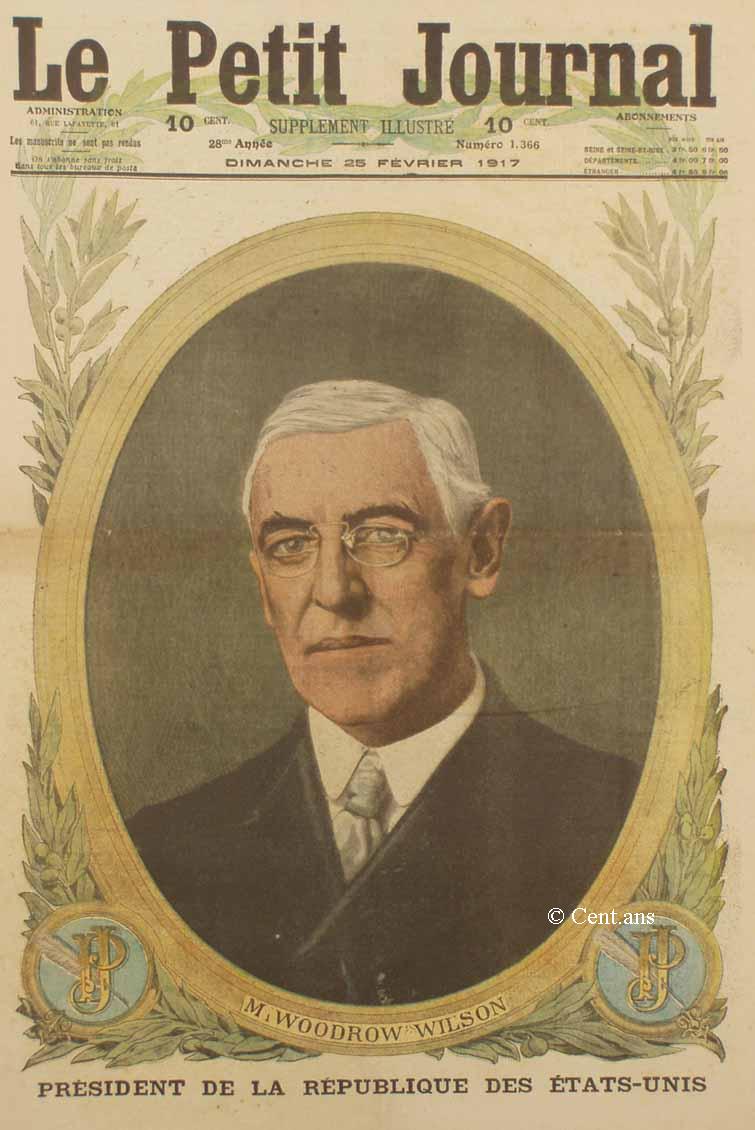M. WOODROW WILSON
Président de la République des États-Unis
Le Président Wilson, dont l'attitude
énergique en face de l'Allemagne a recueilli approbation du monde
civilisé, est né le 28 décembre 1855 à Staunton,
en Virginie où son père était pasteur.
Après avoir fait d'excellentes études de droit, il s'établit
avocat à Atlanta. En 1888, il était nommé professeur
d'économie politique à la Wesleyan University. Deux ans
plus tard, il passait à l'université de Princeton ; et,
en 1902, on le choisissait comme président de cette université.
Entre temps, M. Wilson avait publié divers ouvrages qui avaient
attiré l'attention sur son nom : notamment un traité de
Science politique qui est devenu un manuel classique aux Etats-Unis,
et une Histoire du peuple américain, également très
populaire.
L'un des Français qui connaissent le mieux les homme et les choses
de l'Amérique contemporaine, notre excellent collaborateur François
de Tessan, à qui nous empruntons maints éléments
de cette notice, observe que c'est à partir de ce moment que
M. Wilson se lança réellement dans la vie active.
« Il connut, dit-il, des heures décisives pour sa carrière
d'homme public. En effet, il fut amené à répandre
parmi les étudiants confiés à sa garde les principes
démocratiques qu'ils méconnaissaient. Sa première
tentative consista à briser ces clubs de jeunes millionnaires
qui constituaient autant de petites chapelles. Contre ces tendances
de l'aristocratie ploutocratique il protesta de toutes ses forces. «
Laisserons-nous ces influences qui maintenant dominent notre vie commerciale
s'emparer de nos collèges ? s'écria-t-il avec indignation.
La grande voix de l'Amérique ne vient pas des temples du savoir.
Elle arrive comme un murmure des collines et des bois, des fermes, des
usines, des moulins. En se propageant, elle gagne en volume jusqu'à
ce qu'elle atteigne la demeure des hommes du peuple...»
Et il ajoutait :
« Toute mon énergie je l'emploierai désormais à
la régénération de l'esprit démocratique
dans la jeunesse. »
M. Woodrow Wilson tint parole et il réussit. Sa propagande démocratique
triompha. En 1910, les électeurs de New-Jersey l'élurent
gouverneur. Bientôt on commença à parler de lui
pour la présidence.
En 1912, il fut élu a plus haute magistrature du pays.
« II arrivait au pouvoir, dit encore M. de Tessan, avec la confiance
générale, confiance justifiée par par son intégrité,
sa distinction intellectuelle et l'étendue de
connaissances juridiques. M. Wilson est un maître de la prose
anglaise ; il a le style fleuri d'expressions délicates, de sentences
émouvantes ; il conte aussi l'anecdocte d'une façon charmante
et fait les délices de ses amis dans l'intimité.
» Il a, ajoute son biographe, une tête très anglo-saxonne,
longue, osseuse, dont la mâchoire est très prononcée.
Ses yeux gris pétillent derrière les lorgnons avec malice
et son sourire découvre une denture tout à fait britannique.
M. Woodrow Wilson avoue qu'il n'a rien de la beauté classique.
»
Et M. de Tessan reproduit quelques vers empreints d'humour que M.Wilson
a écrits sur lui-même.
En voici la traduction :
« Certes, en fait de beauté je ne suis pas une étoile
« Il y en a d'autres plus beaux et de beaucoup
« Mais de ma figure je ne me soucie guère,
« Car je suis derrière elle.
« Ce sont les gens qui sont en face de moi qui peuvent être
émus. ,
Et, en effet, les Allemands qui se trouvent en ce moment en face de
M. Wilson doivent être quelque peu émus.
VARIÉTÉ
Les Américains et la France
Tout homme a deux patries... - Le testament de Washington. - Ce qu'on pensait de nous en Amérique. - Un voeu de Théodore Roosevelt.
C'est un grand Américain, le diplomate Thomas Jefferson, qui
a dit cette parole demeurée célèbre, et qui fut
même traduite en vers par un de nos poètes :
« Tout homme a deux patries, la sienne et la France. »
Or, quand il parlait de la France, Jefferson en parlait en connaissance
de cause. Il avait succédé à Franklin comme représentant
des États-Unis à Paris, et il avait pu, au cours d'un
séjour de cinq années - de 1784 à 1789 - dans notre
pays, apprécier les beautés de la France et les vertus
de l'âme française.
En quittant Paris pour retourner en Amérique, Jefferson complétait
la pensée qu'il avait si éloquemment exprimée dans
sa phrase célèbre par une lettre qui eut alors un grand
retentissement :
« Je ne puis quitter ce grand et bon pays, écrivait-il,
sans exprimer ma conviction de la supériorité du caractère
de ses habitants sur celui des autres nations de la terre. Je n'ai jamais
connu de peuple qui eût plus de bienveillance et fût plus
capable de chaleur et de dévouement dans ses amitiés intimes.
La supériorité des Français dans les sciences,
la facilité et la vivacité de leur conversation donnent
à leur société un charme qu'on ne peut trouver
ailleurs. »
Ces sentiments de Jefferson pour la France, on les retrouve chez tous
les Américains qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, se
sont donné la peine de bien voir notre pays, de l'étudier,
d'en pénétrer la civilisation et les moeurs, sans se laisser
influencer par les préjugés absurdes et injurieux que
la propagande allemande n'a cessé de répandre contre nous
par delà l'Océan.
Peu d'années après le retour de Jefferson aux États-Unis,
les sympathies pour la France s'étaient tellement accrues chez
le peuple américain qu'elles faillirent l'entraîner dans
la guerre et le porter au secours de notre pays.
En 1792, lorsque les démocrates américains apprirent que
la monarchie française était renversée, et que
la France s'était constituée en république, leurs
sympathies pour notre pays ne connurent plus de bornes. La guerre que
les puissances absolutistes de l'Europe avaient déclarée
à la France apparut à leurs yeux comme une croisade impie
dirigée contre la liberté humaine et contre tous les gouvernements
libres de la terre. La cause des États-Unis leur parut engagée
dans cette guerre ; il leur semblait que leur indépendance dépendait
de son issue. La coalition contre la France était aussi une coalition
contre l'Amérique, et si le despotisme triomphait en Europe,
qui pouvait garantir qu'il ne chercherait pas un jour à s'établir
dans le Nouveau Monde ? Tel était le sentiment populaire aux
États-Unis. Et si le gouvernement auquel l'existence de la république
en France apparaissait comme une chose impossible ou tout au moins éphémère,
n'avait pas résiste à l'entraînement populaire,
on eût vu la république des États Unis venir au
secours de sa jeune soeur la république française.
Déjà, des armements de corsaires s'étaient préparés
dans quelques ports de l'Union. Mais Washington en fut promptement informé.
Il prit des mesures énergiques et rapides pour réfréner
ces velléités combatives.
Une proclamation fut adressée au peuple américain, interdisant
aux citoyens de prendre une part quelconque aux hostilités maritimes,
les avertissant de ne porter à aucun des belligérants
les articles définis contrebande de guerre et leur enjoignant
de s'abstenir de tout acte incompatible avec les devoirs d'une nation
amie.
Cette proclamation est restée la base du système de neutralité
absolue dont le gouvernement américain ne s'est jamais départi
dans les grandes luttes qui, depuis lors, ont bouleversé l'Europe.
On sait, en effet, que la conduite politique des États-Unis,
vis-à-vis des nations de l'Europe, a été tracée
par Washington dans ses adieux au peuple américain, adieux qu'il
publia au moment de quitter pour toujours la direction des affaires
de la république.
« Notre grande règle de conduite vis-à-vis des nations
étrangères, dit ce document, ou plutôt ce testament,
consiste, en étendant nos relations commerciales avec elles,
d'avoir le moins possible de rapports politiques avec leurs gouvernements
respectifs. L'Europe a des intérêts d'ancienne date qui
ne nous touchent qu'à un faible degré. Elle doit, dès
lors, être engagée fréquemment dans des controverses
ou des querelles dont la cause est étrangère à
nos affaires. Il ne serait pas sage, par conséquent, de nous
laisser entraîner par des liens artificiels dans des collisions
résultant de ses haines et de ses antipathies.
» Notre position insulaire et éloignée nous permet
de suivre une marche différente. Pourquoi alors abandonner les
avantages d'une position exceptionnelle ? Pourquoi irions-nous nous
placer sur un terrain étranger ? Pourquoi irions-nous risquer
notre avenir dans les différends de l'Europe et mettre notre
paix et notre prospérité à la merci des caprices,
des rivalités, et de l'ambition des nations de l'ancien monde
? »
Tels sont les conseils d'abstention systématique donnés
par celui qui fut le premier président de la République
américaine, conseils qui sont devenus la base de la politique
étrangère de tous ses successeurs. Tout en nous témoignant
ses sympathies de la façon la plus effective chaque fois que
la France était engagée dans un conflit, l'Amérique
les a suivis strictement, ces conseils de Washington ; mais le grand
Américain n'avait pas prévu l'Allemagne, son orgueil,
ses brutalités, son mépris du droit des gens, et la nécessité
pour l'Amérique de se joindre aux nations alliées contre
le Boche, afin de sauvegarder ses intérêts économiques
en même temps que pour assurer le triomphe de la civilisation
et du droit.
S'il eût prévu l'Allemagne, Washington eût apporté
quelques restrictions à sa thèse d'abstention politique,
et, président des États-Unis à l'heure actuelle,
il est certain que le grand politique, le glorieux général
qui fit l'indépendance américaine, n'agirait pas autrement
que ne le fait son successeur à la présidence des Etats-Unis
: le président Wilson.
***
Je ne vais pas passer en revue ici tous les témoignages de sympathie
que l'Amérique et les Américains donnèrent à
la France au cours des cent trente-quatre ans qui nous séparent
de la fondation de la république des États-Unis. Il y
faudrait des volumes,
Cette sympathie a pour point de départ, dans le passé
lointain, le plus noble sentiment : la reconnaissance.
Un des Français qui ont le mieux étudié l'Amérique,
M. André Tardieu, l'a observé :
« Dans l'amitié des Américains pour notre pays,
dit-il, l'histoire garde une part prépondérante. Les États-Unis
sont un pays de tradition. Et la tradition américaine est, à
sa racine, une tradition française... Le sentiment français
existe en Amérique. Et les manifestations dont il a été
l'origine ne l'ont pas épuisé. Les statues de La Fayette
et de Rochambeau qui se dressent en face de la Maison Blanche, leurs
portraits placés au Capitole dans la salle des séances,
à droite et à gauche du président, ne sont pas
de simples « marques extérieures » d'attachement.
Cet attachement survit dans les cœurs, Et l'on ne peut pas ne pas
être frappé de l'unanime spontanéité avec
laquelle il s'exprime... »
En dépit des progrès de l'émigration allemande
aux États-Unis, malgré la propagande anti-française
organisée par les Boche, dans le Nouveau Monde, cet attachement
a survécu en effet.
Et, cependant, les campagnes menées par nos ennemis, les maladresses
commises par nous-mêmes eussent pu le compromettre. L'Allemagne,
aux États-Unis, comme partout ailleurs, représentait la
France comme une nation abâtardie, et cette campagne de diffamation
ne fut pas sans effet. Nos compatriotes qui, en ces dernières
années, visitèrent l'Amérique et étudièrent
les sentiments des Américains à l'égard de la France
constatèrent souvent que ce qu'ils admiraient en nous ce n'était
plus notre force, comme au temps de Washington, mais notre charme.
M. Tardieu, notamment, l'a fort bien observé :
« Ce que les Américains admirent en nous en ce début
de siècle, dit-il, ce ne sont pas nos vertus, ce sont nos agréments
; ce n'est ni notre politique ni notre capacité d'agir, ni notre
faculté d'expansion, c'est notre élégance, notre
goût, nos modes, notre littérature et notre art.... Nous
exerçons sur eux un vif attrait, mais nous manquons de prestige
et d'autorité.
Et il ajoute :
» Pour avoir, en 1871, subi la loi de l'étranger, nous
sommes demeurés suspects d'anémie nationale aux yeux des
Américains. Seule l'affirmation énergique de notre vitalité
comme peuple est de nature à rétablir notre crédit
moral à son niveau d'autrefois. »
Or, cette affirmation, la France l'a donnée dans la présente
guerre, et l'Amérique sait maintenant que la grâce n'est
point la seule vertu que la France d'aujourd'hui ait hérité
de la France du passé.
Au surplus, les Américains qui ont vécu chez nous de notre
vie française, pénétré dans nos foyers et
étudié nos moeurs avec sincérité ne s'y
sont pas trompés.
Un éminent professeur américain, M. Harry Van Dyke, qui
fit, il y a quelques années, une série de conférences
à la Sorbonne, disait, en nous quittant :
« J'ai appris que Paris n'est pas la ville de loisirs et de danse
perpétuelle que l'on imagine parfois à l'étranger
; aussi bien dans l'industrie, le commerce, la finance que dans l'art,
la littérature et l'enseignement, j'ai rencontré les personnes
les plus actives. On travaille, on travaille beaucoup à Paris.
Le labeur y est énorme quoique discret. Et cela est bien fait
pour surprendre ceux qui ne se font une idée de Paris que par
la légende... J'en ai été surpris moi-même
...»
Ah ! la légende ! ... la légende du Français léger,
de la France oisive, du Paris jouisseur, quel tort elle nous a fait
à l'étranger !... La propagande de nos ennemis n'a pas
peu contribué à la répandre ; mais il faut bien
reconnaître, que si elle s'est si facilement établie, il
y a aussi un peu de notre faute. Ce ne sont pas toujours les meilleurs
produits de notre pays que nous avons exportés ; et certains
romans scandaleux, certaines pièces morbides que notre snobisme
nous faisait admirer, n'auraient jamais dû franchir nos frontières.
C'est sur ces romans, c'est sur ces pièces qu'on nous a jugés.
On a cru que les uns et les autres étaient le reflet de nos moeurs,
et on nous en a moins estimés.
Il y a quelques années, une de nos plus célèbres
actrices porta en Amérique tout un répertoire de ces pièces
malsaines. Quand elle eut fini sa tournée, un Français
de là-bas disait : « Cette femme, avec les pièces
qu'elle a jouées, a détruit en quelques jours tous les
efforts que nous avons faits depuis vingt ans pour exalter la France
dans l'esprit des Américains. »
Il est vrai que les Américains venus chez nous ont bien vite
constaté que rien n'était plus injuste que de nous juger
sur cette déplorable littérature. ? Je ne citerai à
ce propos qu'une seule opinion, celle d'un célèbre professeur
des États-Unis, M. Barrett Wendel qui a écrit sur la France
tout un livre.
M. Barrett Wendel a rendu justice surtout à la femme française
et au charme du foyer français.
« En France, dit-il, l'amour des parents pour leurs enfants et
réciproquement, est au-dessus de toute discussion possible. Il
est si fervent, en vérité, que seule la crainte de paraître
odieux empêche de dire qu'il est plus fort, plus profond, plus
spontané que partout ailleurs. »
Tous les Américains, il est vrai, ne peuvent venir chez nous,
mais réjouissons-nous de constater qu'ils y viennent d'année
en année plus nombreux, et que, même pendant la guerre,
ils n'ont pas cessé d'y venir.
En dépit des efforts faits par les Boches pour amener les «
Transatlantiques » à Berlin, ceux-ci ont toujours préféré
Paris. Sur les trois cent mille Américains qui, bon an mal an,
avant la guerre, traversaient annuellement l'Atlantique, le plus grand
nombre était attiré en Europe par le désir de voir
Paris et notre Côte d'Azur. Soyez sûrs qu'avant connu la
France tous ces voyageurs étaient désormais pour nous
autant d'amis.
Depuis l'époque ou éclata le cataclysme qui bouleverse
l'Europe, les témoignages de cette amitié se sont multipliés.
Sous le titre de Voix américaines, Berger-Levrault a
rempli quatre volumes des éloges que les Américains qui
nous ont vus à l'oeuvre ont faits de notre peuple et de nos soldats.
Ceux-là mêmes qui avaient cru à l'absurde légende
de l'abaissement de la France, ceux-là surtout ont répudié
leur erreur avec éclat.
« On ne doit pas parler, disait l'un d'eux, d'une renaissance
de la France : la guerre a simplement, révélé la
France telle qu'elle est. »
***
Il y a sept ans, au mois d'avril 1910, l'ex-président
Roosevelt vint faire à Paris; une conférence qu'il terminait
ainsi :
« Et maintenant, mes hôtes, un mot en vous quittant. Vous
et moi appartenons aux deux seules Républiques ayant rang parmi
les grandes puissances du globe. L'ancienne, amitié entre la
France et les États-Unis a été, dans son ensemble,
une amitié sincère et désintéressée.
Une calamité chez vous serait une douleur chez nous. Mais ce
serait plus encore. Dans la bouillonnante tourmente qu'offre l'histoire
de l'humanité, quelques nations brillent par la possession d'une
certaine force ou d'un certain charme ou de quelque don spécial
de beauté, sagesse ou puissance qui les place à jamais
parmi les guides du genre humain. La France est une de ces nations.
Le monde entier souffrirait de sa perte. Il est certaines leçons
d'éclat et de vaillance généreuse qu'elle sait
mieux donner qu'aucune autre des nations soeurs... Vous avez un grand
passé. Je suis convaincra que vous avez un grand avenir. Puissiez-vous
longtemps agir en fiers citoyens d'une nation à qui revient l'un
des premiers rôles dans l'enseignement et le perfectionnement
de l'humanité ! »
Tel était le voeu d'un grand citoyen américain. Nos amis
d'Amérique peuvent constater aujourd'hui que les citoyens français
l'ont pleinement réalisé.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 25 février 1917