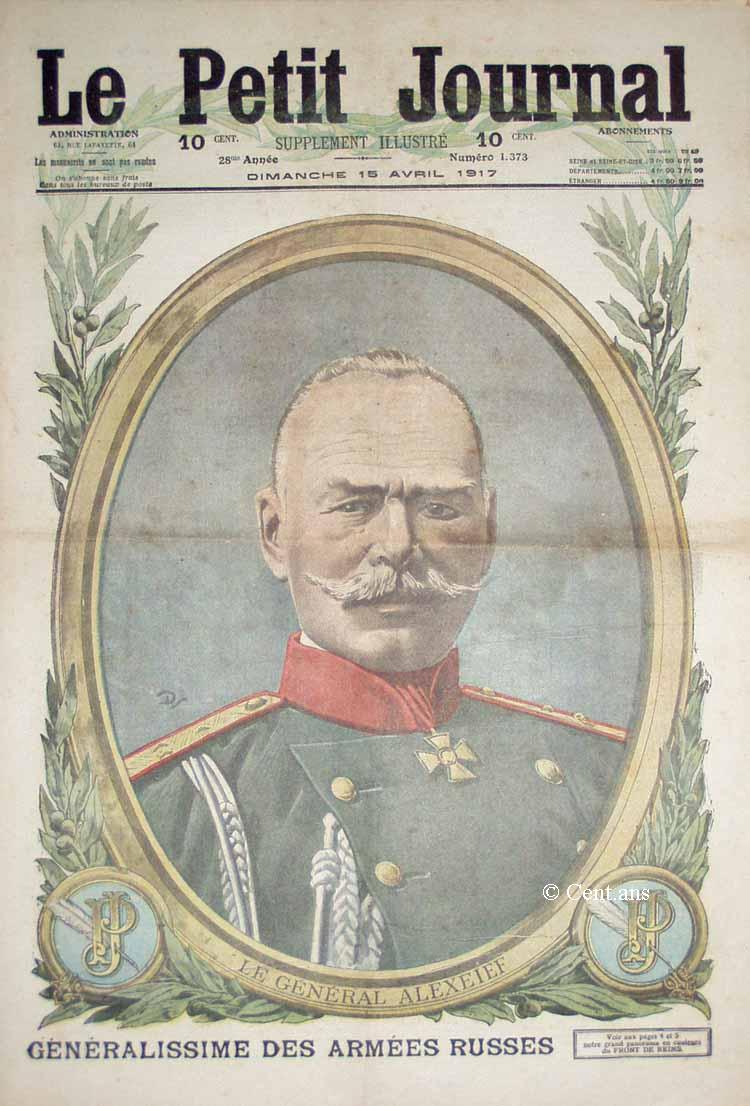LE GÉNÉRAL ALEXEIEF
Généralissime des armées russes
On sait que le général Alexeief,
chef d'état-major des armées russes, a été
désigné par le gouvernement provisoire comme généralissime.
« L'opinion française, dit un de nos plus éminents
critiques militaires, connaît la haut-valeur du général
Alexeief. Elle n'a pas oublié dans quelles conditions critiques
ce chef est entré en scène.
» C'était aux heures les plus sombres de l'été1915.
Varsovie, Brest-Litovsk, Kovno étaient tombées. Vilna
allait succomber. Riga était menacée. Quelques centaines
de mille hommes démunis d'armes et de munitions opposaient à
l'invasion la barrière d'héroïques sacrifices. A
ce moment critique, le tsar vint se placer à la tête de
ses troupes et désigna pour le suppléer dans les fonctions
de généralissime effectif, le général Alexeief.
» L'arrêt de l'offensive d'Hindenburg a été
le premier résultat singulièrement réconfortant
de cette collaboration. Puis, après un hiver de laborieux efforts
réparateur, vinrent les jours glorieux de l'attaque de Broussiloff,
avec la conquête de la Bukovine et 600.000 prisonniers. Il n'a,
certes, pas tenu au chef du grand état-major russe que cette
brillante opération n'eût un autre lendemain que l'épreuve
Roumaine.
» - A la fin de janvier 1917, on apprenait que le général
Alexeief était obligé de prendre repos prolongé
pour raisons de santé.
Le 10 mars, remis de ses fatigues, il reprenait ses fonctions.
Partisan dévoué du nouveau régime, le général
Alexeief s'efforce de substituer une discipline raisonnée à
la discipline automatique de l'ancien régime.
Il est décidé à pousser vigoureusement les opérations
jusqu'à la victoire définitive.
Ajoutons que la popularité du général Alexeief
est considérable dans l'armée russe et son choix comme
généralissime a été accueilli partout avec
le plus vif enthousiasme.
VARIÉTÉ
La “ société des Nations ”
Projets de paix perpétuelle. - Pacifistes d'autrefois. - L'abbé de Saint-Pierre. - L'Allemagne en 1806. - Henri IV pacifiste. - L'apologue de la fouine et du hérisson.
Les extrêmes se touchent : c'est généralement
après les grandes guerres qui désolèrent le monde
que se firent jour les espérances de paix universelle.
Nous sommes même, cette fois, plus pressés que ne le furent
nos aïeux ; la guerre n'est pas encore finie, et déjà
l'on nous parle de la « Société des Nations »,
de l'entente universelle pour éviter le retour de pareils cataclysmes
; et les prophètes de l'arbitrage international, les rêveurs
de la fraternité humaine dont le canon a, depuis trois ans bientôt,
interrompu les discours, commencent à retrouver la voix.
On a évoqué récemment à ce propos une figure
douceâtre et falote, celle du bon abbé de Saint-Pierre,
l'auteur du Projet de paix perpétuelle, qu'un socialiste
de marque confondait plaisamment l'autre jour avec l'auteur de Paul
et Virginie.
Or, l'abbé de Saint-Pierre ne fut pas le premier qui caressa
cette généreuse utopie de la fraternité des peuples.
M, Vesnitch, ministre de Serbie à Paris, qui est un fin lettré
et connaît le passé de la France mieux que beaucoup de
Français, a naguère exhumé les noms de deux précurseurs
qui abordèrent, l'un à l'aurore du XIVe siècle,
l'autre au commencement du XVIIe, le problème du maintien de
la paix générale et de l'arbitrage international.
Le premier se nommait Pierre Dubois. Il était avocat à
Coutances. Député aux Etats-Généraux, il
rédige un long mémoire qu'il présente à
Philippe-le-Bel, et dans lequel il propose ses combinaisons politique,
judiciaires et autres pour assurer l'entente, entre les peuples par
l'établissement d'un véritable congrès de la paix.
« Les siècles, dit M. Vesnitch, ont pu changer des détails
dans les idées de Pierre Dubois, mais les grandes lignes sont
restées debout ; certaines dispositions sur l'arbitrage international
et sur sa procédure, arrêtées par les conférences
de La Haye, rappellent les projets de ce « publiciste »
du XIVe siècle presque textuellement. »
Il faut croire, cependant, que notre homme ne prenait pas ses idées
très au sérieux, car il avait intitulé son travail
: Les « rêves » d'un homme de bien.
Le second précurseur a nom Emeric Cruci, né en 1590, mort
en 1648.
Celui-ci a exposé ses idées dans un livre; le Nouveau
Cynée, et synthétise son oeuvre dans sa préface.
Sans se préoccuper des guerriers, qui l'appelleront par mépris
« homme de plume et d'écritoire », il propose une
chose : « non seulement possible, dit-il, mais aussi de laquelle
les anciens ont eu l'expérience. Sous l'empire d'Auguste, toutes
les nations étaient pacifiées... Qui nous empêche
d'espérer un bien dont les siècles passés ont joui
? Je crois qu'il n'y a rien de si facile que cette affaire, si les princes
chrétiens la veulent entreprendre. Il ne faut pas dire que les
propositions qui se font de la paix universelle sont chimériques
et mal fondées. »
Hélas ! les princes chrétiens ne voulurent pas écouter
la voix du candide pacifiste et leurs peuples continuèrent à
se massacrer.
Cela n'empêcha pas qu'un siècle plus tard, au lendemain
des grandes guerres de Louis XIV, au lendemain de Denain, apparut un
nouveau projet de paix perpétuelle. C'était l'oeuvre d'un
doux ecclésiastique, l'abbé de Saint-Pierre. Saint-Simon
disait de lui : « Il avait de l'esprit, des lettres et des chimères.
»
Il avait surtout des chimères, notamment celle de faire régner
la paix dans le monde. Ayant accompagné le cardinal de Polignac
au congrès d'Utrecht, il conçut là l'idée
de son Projet de paix perpétuelle. Et, l'année
suivante, il publia son oeuvre tendant à la création d'un
sénat ou tribunal arbitral européen qui réglerait
toutes les difficultés entre les peuples sans effusion de sang.
Cela fait, il s'en fut trouver les ministres avec l'espoir de leur faire
adopter ses projets. Le pauvre pacifiste fut assez mal accueilli. «
Vous avez oublié un article essentiel, lui dit le cardinal Fleury,
alors premier ministre, celui d'envoyer des missionnaires pour toucher
le coeur des princes et leur persuader d'entrer dans vos vues. »
Le cardinal Dubois ne le prit par plus au sérieux. Il se contenta
de dire de son ouvrage ce que le pacifiste du temps de Philippe-le-Bel
avait dit du sien : « Ce
sont les rêves d'un homme de bien. »
Cependant, le bon abbé ne se décourageait pas. Il avait
conscience d'avoir fait une grande oeuvre, et il le proclamait avec
un orgueil naïf qui ferait sourire si l'auteur n'apparaissait pas
profondément convaincu.
« Comme jamais, écrit-il, projet plus grand, plus beau
ni plus utile n'occupa l'esprit humain que celui d'une paix perpétuelle
et universelle entre tous les peuples de l'Europe, jamais auteur ne
mérita mieux l'attention du public que celui qui propose les
moyens pour mettre ce projet à exécution... »
Malheureusement, le bon pacifiste ne semble pas avoir trouvé
meilleur accueil auprès du public qu'auprès des ministres.
Ses généreuses utopies n'eurent guère d'écho.
Il s'en consola en cultivant son idée fixe pour sa joie intime
et personnelle.
« Je vais voir du moins en idée, écrit-il, les hommes
s'unir et s'aimer ; je vais penser à une douce et paisible société
de frères, vivant dans une concorde éternelle, tous conduits
par les mêmes maximes, tous heureux du bonheur commun ; et, réalisant
en moi-même un tableau si touchant, l'image d'une félicité
qui n'est point m'en fera goûter quelques instants une véritable.
»
Comme quoi, vous le voyez, le digne abbé n'était point
tout à fait dupe de sa chimère. Caresser son utopie suffisait
à ce pacifiste d'autrefois. C'est bien dommage que les pacifistes
d'avant la guerre ne se soient pas toujours contentés à
si bon compte.
***
Les théories pacifistes ne sont pas incompatibles avec l'esprit
terroriste. Nos anarchistes d'avant-guerre étaient tous des amis
de l'humanité. Robespierre l'avait été avant eux.
Le 15 mai 1790, il propose à l'Assemblée Constituante
de déclarer que « la nation française, contente
d'être libre, ne veut s'engager dans aucune guerre et veut vivre
avec toutes les nations dans cette fraternité qu'avait commandée
la nature ». Pétion et d'autres pacifistes renchérissent
et réclament le désarmement.
En vain Mirabeau intervient de sa voix de tonnerre : « La paix
perpétuelle, s'écrie-t-il, est un rêve, et un rêve
dangereux s'il entraîne la France à désarmer devant
une Europe en armes... » L'Assemblée vote cependant la
motion de Robespierre.
Dès lors une campagne de désorganisation nationale s'engage.
Mais, deux ans plus tard la guerre éclate ; et, malgré
la campagne des pacifistes, la France entière se lève
dans un admirable élan de patriotisme.
Alors, comme aujourd'hui, les événements démontrèrent
que la propagande des internationalistes n'avait pas entamé l'âme
du peuple.
II eut curieux de constater que cette démoralisation par l'antimilitarisme
et la propagande pacifiste, ce fut la Prusse qui, de toutes les nations
d'Europe, la subit le plus profondément et en supporta naguère
les plus cruelles conséquences.
Ouvrez le célèbre ouvrage sur la guerre et la stratégie,
de Clausewitz, le fameux écrivain militaire allemand, vous y
lirez ceci sur l'état d'esprit de la Prusse aux
environs de 1806:
« On ne songeait alors, dit Clausewitz, qu'au bonheur universel,
à la paix éternelle, à la fraternité des
peuples... Le sentiment national avait disparu, et, avec lui, les passions
solides et saines, le feu sacré et l'amour violent de la patrie.
Le dilettantisme spirituel avait tué le sens pratique... »
Le résultat de cette mentalité pacifiste, vous le connaissez
: ce fut Iéna et la conquête de la Prusse par les armées
françaises.
La leçon fut rude aux Boches d'alors. Mais ce peuple a de la
mémoire et de la rancune. Il nous a prouvé, en 1870 et
aujourd'hui, qu'il ne l'avait point oubliée...
Chez nous, cependant, après la période guerrière
de l'empire, après les campagnes d'Algérie, sous Louis-Philippe,
la généreuse mais dangereuse utopie de la paix universelle
renaissait à la faveur du mouvement démocratique de 1848.
Comme au temps de l'Assemblés Constituante, on tente de répandre
dans les masses la croyance en la fraternité des nations. On
chante
Les peuples sont pour nous des frères.
Les poètes se font l'écho de ces idées humanitaires. Lamartine écrit cette fameuse Marseillaise de la Paix que l'antipatrotisme a tant exploitée depuis :
Et pourquoi nous haïr et mettre entre les
races
Ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'oeil de Dieu...
L'égoïsme et la haine ont seuls une
patrie,
La fraternité n'en a pas.
Victor Hugo flétrit la guerre. Les philosophes, toujours prêts
à prendre leurs rêveries pour des réalités,
la déclarent désormais impossible.
« La guerre, proclame Proudhon, est arrivée à la
fin de son oeuvre, et la parole est à l'économie politique
et à la paix...
Les hommes sont petits : il dépend d'eux, jusqu'à un certain
point, de troubler le cours des choses... L'humanité seule est
grande ; elle est infaillible. Or je crois pouvoir le dire en son nom
« L'humanité ne veut plus la guerre. »
Admirez la prescience du philosophe socialiste. Jamais peut-être
les peuples du monde ne se sont autant battus que depuis qu'il écrivit
ces lignes.
Sous le second empire, les théories humanitaires, s'érigent
en protestation contre les campagnes militaires. On prône le pacifisme,
tandis qu'une école politique naissante va jusqu'à attaquer
le principe des nationalités et nier la patrie.
Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne,
exaltée par son succès de Sadowa, s'apprête à
de nouvelles conquêtes.
Nos revers de 1870 auraient dû nous défendre à tout
jamais contre l'utopie pacifiste et la croyance à la fraternité
des peuples.
Il n'en fut rien. Peu d'années s'écoulèrent et
l'on vit bientôt renaître ces funestes doctrines. Elles
tentèrent même de pénétrer l'école
française.
Deux ans avant la guerre, un instituteur me disait :
« J'avais dans ma classe quelques tableaux représentant
des batailles célèbres de la Révolution et du premier
empire : Jemappes, Marengo, Austerlitz, Iéna, quelques autres
encore. Un jour, M. l'inspecteur primaire me prit à part et me
dit :
« - Vous devriez bien enlever ces tableaux que vous avez là.
Ces batailles de l'empire, vous savez, il est préférable
de ne pas afficher ça.
« - Bien, monsieur l'inspecteur ; je vais les enlever. Mais ne
pourrais-je pas laisser Jemappes ? C'est une victoire républicaine.
« - Évidemment, c'est une victoire républicaine,
mais c'est une bataille... Il ne faut pas montrer des batailles aux
enfants. Croyez-moi, mon ami, enlevez tous ces beaux et remplacez-les
par des sujets pacifiques. Ça vaudra mieux. »
Et l'instituteur enleva les batailles.
Vous voyez par cette simple anecdote jusqu'à quel degré
de sottise atteignait la propagande pacifiste d'avant la guerre. Un
tel système ne pouvait aboutir qu'à ceci : les petits
Français sortant de l'école eussent tout ignoré
de l'histoire militaire de leur pays. Et c'eût été
le plus clair résultat de cette méthode d'enseignement.
Car il eût fallu que les pédagogues pacifistes fussent
plus naïfs que de raison pour s'imaginer qu'ils supprimeraient
la guerre dans l'avenir en n'en parlant plus dans le présent.
Ce procédé rappelle celui de l'autruche qui, poursuivie
par le chasseur, se cache la tête derrière une pierre et
s'imagine ainsi qu'on ne la voit pas. C'est puéril tout simplement.
Avec de telles méthodes, on émascule une nation, on l'endort
dans une fausse sécurité. Et, un beau jour, le réveil
est terrible.
Nous n'étions pas tout à fait endormis, heureusement quand
éclata la guerre, et la France a depuis lors, prouvé triomphalement
aux Boches qu'elle avait su résister à la propagande de
tous les empirique et de tous les songe-creux de la paix universelle
et du désarmement.
***
Ceci dit, faut-il conclure que le rêve généreux
de la « Société des Nations » est irréalisable.
Non, certes. Mais s'il faut considérer sa réalisation,
ce n'est point à la façon du digne abbé de Saint-Pierre
et de nos théoriciens pacifistes d'avant-guerre. La méthode
du bon roi Henri IV me semble ici infiniment préférable.
Car le bon roi Henri IV, lui aussi, fut pacifiste ; mais il le fut intelligemment
et pratiquement. Avec son grand ministre Sully, il rêva d'une
grande « République chrétienne » qui devait
se constituer par l'union d'une douzaine d'États d'Europe et
la constitution d'un grand tribunal international chargé de résoudre
tous les conflits entre ces États.
Mais Henri IV pensait que la force morale ne pouvait être suffisante
pour assurer le respect des verdicts rendus par ce tribunal. Il voulait
que ses décisions fussent appuyées par une force matérielle
capable de contraindre tout État réfractaire à
se soumettre aux délibérations prises par la majorité
des juges du dit tribunal.
Son pacifisme était donc, si l'on peut dire, un pacifisme armé.
Et n'est-ce pas le seul capable d'assurer le maintien de la paix ?
Si vous voulez la paix, commencez par préparer la guerre contre
ceux qui manquent à la foi internationale. Sinon, vous jouez
un jeu de dupes.
Vous rappelez-vous une amusante comédie de Labiche qui s'appelle
les vivacités du capitaine Tic ? L'auteur nous y montre
un de ces sociologues à courte vue, comme il s'en est tant rencontrés
chez nous depuis un quart de siècle, un de ces nigauds prud'hommesques
qui célèbrent volontiers le pacifisme, l'amour de l'humanité
et gémissent à tout propos sur les dépenses du
budget de la guerre.
Ce personnage, qui s'appelle Désambois, rêve de fraternité
universelle et s'élève à tout propos contre le
système des armes permanentes.
« Le penseur, le philosophe sérieux, s'écrie-t-il,
se demandent avec angoisse à quoi servent ces phalanges improductives
!...»
Alors, le capitaine Tic lui raconte une histoire, l'histoire d'un hérisson
philosophe qui dédaignait, lui aussi, les « baïonnettes»
improductives qu'il avait sur le dos.
Et ce hérisson philosophe disait :
« Cet appareil de guerre ne me sert à rien et il est désobligeant
pour mes voisins. »
Il le supprima donc et arracha de son dos la forêt de pointes
qui le protégeait.
« Et, alors, demanda M.Désambrois, qu'arriva-t-il ?
« - Eh bien ! répondit le capitaine Tic, il arriva une
fouine qui, le trouvant gras et sans défense, le croqua comme
un oeuf... »
Voilà, n'est-il pas vrai, un petit apologue qui pourrait servir
d'enseignement aux pacifistes.
La paix universelle, la fraternité des peuples, l'entente entre
les nations, l'humanité triomphant des patries, tout cela est
fort bien en théorie. Mais gang aux faux frères ! Les
hérissons feront bien de ne pas arracher leur armure tant que
les fouines garderont leurs dents.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 15 avril 1917