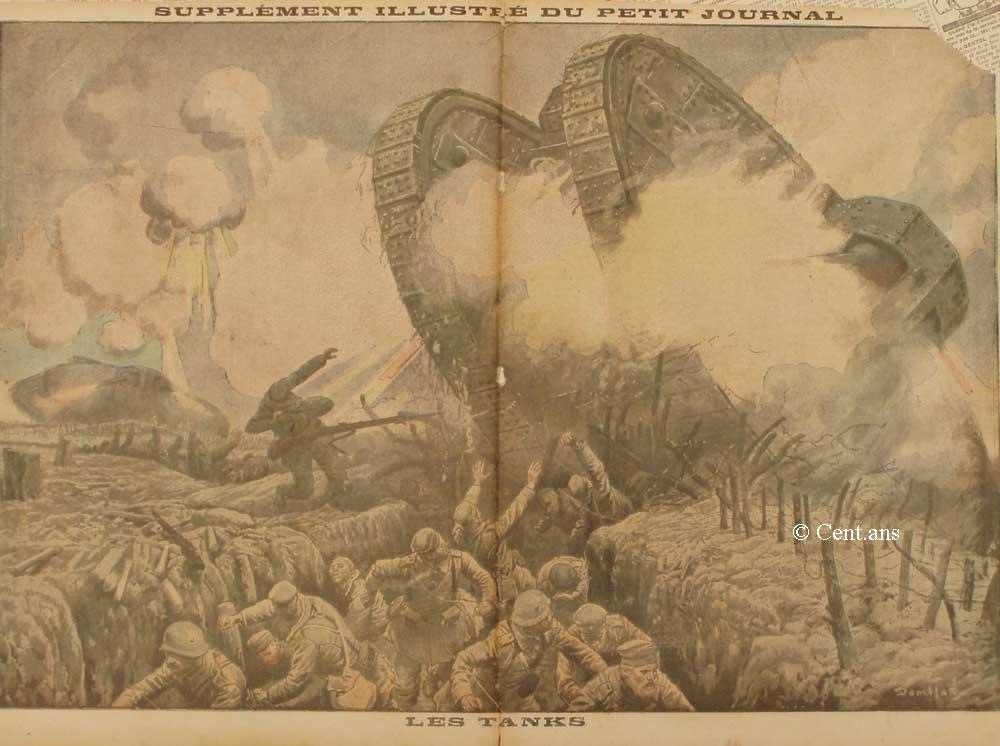LES TANKS
Les tanks jouent un rôle considérable
dans l'offensive de nos alliés.
Le correspondant du daily Mail écrit :
« On reconnaît l'aide inestimable apporté par les
tanks lors de la prise de Monchy et de la redoute de la Harpe.
» Moi qui suivis le remous, si l'on peut ainsi dire, d'un des
tanks les plus actifs, je puis parler en connaissance de cause de l'habileté
de ces pachydermes à franchir les trous de marmites, à
démolir les fils barbelés, à s'ébrouer sous
l'avalanche des balles et des obus... »
Quant aux effets du tank, jugez-en par ces lignes dont l'auteur n'est
autre qu'un soldat qui prit part à la bataille dans un de ces
monstres automobiles.
« Notre machine avance de sa marche régulière et
inexorable. Un fossé ! nous le franchissons ; un talus ! nous
l'escaladons; un amas de moellons provenant d'une maison démolie
! nous passons à travers. Et voici tout à coup les premiers
réseaux de fils de fer barbelés. Notre tank ne fait pas
même un effort : tout casse, tout se brise, tout est arraché.
Les piquets de bois sautent de toutes côtés, les chevaux
de frise sont écrasés. J'ai l'impression d'être
à l'intérieur d'un gigantesque coin de fer qui entrerait
dans du beurre. Quant à nous, nous tirons sans relâche,
la main sur notre « outil », l'oeil collé au «
regard » percé dans le blindage.
» Un heurt ! un halètement puissant un dernier temps d'arrêt
à peine perceptible : l'avant de notre machine écarte
les sacs de terre et de ciment et les rejette de chaque côté,
comme fait le soc d'une charrue labourant la terre. Un heurt plus sec
! Une sorte de coup sourd, un craquement nous entrons dans un mur qui
cède. Nous broyons des engins. Des grenades éclatent sur
notre blindage. Nous sommes en plein sur le nid, et soudain, de vilaines
têtes de Germains, l'épouvante peinte sur le visage nous
apparaissent des deux côtés.
» Chez les Allemands, c'est le plus extraordinaire désarroi
que j'aie jamais vu. Ils se jettent à plat ventre, ils lèvent
les bras au ciel ; quelques-uns tentent de fuir. Un coup de sifflet
retentit dans le tank, qui s'arrête.
Notre objectif est enlevé. Notre « machine »s'est
comportée comme aux essais.»
VARIÉTÉ
Du char de guerre au Tank
La guerre des machines. - Les Tanks
de l'antiquité. - L'hélépole de Démétrius.
Chars de guerre du XVIe siècle. - La forteresse mobile de Balbi
--Un rêve du Baiser
On a dit de cette guerre qu'elle était
la « guerre des machines ». Jamais, en effet, les sciences
et l'industrie humaines ne furent mises autant à profit pour
l'oeuvre de destruction. Fusils automatiques, mitrailleuses, autos-canons,
aéroplanes, dirigeables, charrues automobiles pour creuser les
tranchées, torpilles aériennes, gaz asphyxiants et bombes
asphyxiantes, jets de liquides enflammés, jamais les progrès
de la science ne mirent plus de ressources au service de la guerre.
Mais de toutes les machines imaginées et réalisées
au cours de cette lutte gigantesque, le tank, la forteresse mobile restera
la plus caractéristique, la plus représentative, celle
qui témoignera le mieux des efforts accomplis par les belligérants
dans la recherche et dans la réalisation de l'effroyable et du
colossal.
Or, comme il n'est rien d'absolument nouveau sous le soleil, de même
que l'orgue de bombarde a précédé la mitrailleuse,
de même que le feu grégeois a précédé
la bombe incendiaire, le tank a eu de lointains ancêtres dans
les guerres de l'humanité. Ne vous semblent-il pas curieux de
passer en revue ces engins précurseurs de notre actuelle «
Crème de menthe » ?
***
Le premier en date parmi ces aïeux du tank est, à coup sûr,
le char de guerre des armées perses.
Ce fut, dit-on, Cyrus qui l'imagina. Aux essieux des chars ordinaires
qui servaient à transporter les chefs sur le champ de bataille,
il fixa des lames de faux, ce qui devait rendre le passage de ces chars
extrêmement meurtrier. Puis, il perfectionna son invention et
ajouta deux longues pointes fixées à l'extrémité
du timon, pour percer tout ce qui se présentait de face. Enfin,
il munit l'arrière du char de lames tranchantes et aiguës
pour empêcher qu'on y pût monter.
Je vous laisse à penser quelle boucherie devait faire un tel
engin lancé dans les masses ennemies.
Après le char de guerre des Perses vient l' « hélépole
» des Grecs.
L'hélépole - qui veut dire preneuse de villes - n'est
plus un char, mais une tour, une machine de siège mouvante, supportée
par des tortues et armée d'énormes béliers.
La plus célèbre de ces machines est celle que construisit
Démétrius Poliorcète pour faire le siège
de Rhodes.
En voici la description que nous fournit Diodore de Sicile, et d'après
la traduction du chevalier de Folard :
« Démétrius ayant préparé quantité
de matériaux de toute espèce, fit faire une machine qu'on
appelle hélépole, qui surpassait en grandeur
toutes celles qui avaient paru avant lui. La base en était carrée.
Chaque face avait cinquante coudées. Sa construction était
un assemblage de poutres équarries liées avec du fer ;
des poutres, distantes les unes des autres d'environ une coudée,
traversaient cette base par le milieu, pour donner de l'aisance à
ceux qui devaient pousser la machine. Toute cette masse était
mise en mouvement par le moyen de huit roues proportionnées au
poids de la machine, dont les jantes étaient de deux coudées
d'épaisseur et armées de fortes bandes de fer.
» Pour les mouvements obliques on avait fait des antistreptes
(sortes de roues à billes) par le moyen desquelles la machine
se tournait de tous les sens. Aux encoignures, il y avait des poteaux
d'égale longueur, et hauts à peu près de cent coudées,
penchés les uns vers les autres. La machine était à
neuf étages.
» Trois de ses côtés étaient couverts de lames
de fer, afin que les feux lancés de la ville ne pussent l'endommager.
Chaque étage avait des fenêtres sur le devant d'une grandeur
et d'une figure, proportionnées à la grosseur des traits
de la machine. Au-dessus de chaque fenêtre était élevé
un auvent, ou manière de rideau, fait de cuir garni et rembourré
de laine, lequel s'abaissait par une machine et contre lequel les coups
lancés par ceux de la place perdaient toute leur force. Chacun
des étages avait deux larges échelles, l'une desquelles
servait à porter aux soldats les munitions nécessaires,
et l'autre pour le retour.
» Pour éviter l'embarras et la confusion, trois mille quatre
cents hommes poussaient cette machine les uns par dedans et les autres
par dehors, C'était l'élite de toute l'armée pour
la force et pour la vigueur ; mais l'art avec lequel cette machine avait
été faite facilitait beaucoup le mouvement. Démétrius
employa les équipages des vaisseaux pour aplanir le chemin par
où les machines devaient passer. Ce chemin était long
de quatre stades, de sorte que l'étendue des travaux était
de six entre-deux de tours et de sept tours, et le nombre tant des ouvriers
que des travailleurs montait à trente mille. »
Avouez que nos tanks d'aujourd'hui sont de bien modestes engins, comparés
à cette formidable machine qui exigeait plus de trois mille paires
de bras pour la mettre en route et toute une armée pour lui préparer
le chemin.
Cependant, ne croyez pas que cette description soit, de la part de l'historien
sicilien, oeuvre de pure imagination. Plutarque l'a confirmée
presque dans les mêmes termes et avec des chiffres à peu
près correspondants.
« La machine, dit-il, que Démétrius fit approcher
des murailles de Rhodes, avait par le bas, en chaque côté
de sa longueur quarante-huit coudées (Diodore dit cinquante)
et soixante-six de hauteur... »
Il confirme la forme pyramidale de l'engin qui « allait toujours
en rétrécissant en pointe par le haut ».
Il note, comme Diodore, que « le front qui regardait vers les
ennemis était ouvert et avait à chaque étage des
fenêtres par lesquelles on jetait toutes espèces de traits.»
Et il ajoute que la machine « était si bien assise qu'elle
ne branlait pas, ni ne penchait d'un côté ni de l'autre
quand on la faisait mouvoir, et demeurait droite et ferme dans son soubassement,
s'avançant également autant en un endroit qu'en l'autre
avec un bruit et un son merveilleux... »
Toutes les tours de guerre n'avaient pas ces dimensions colossales.
Mais comme elles servaient généralement dans les sièges
des villes elles étaient toujours assez hautes pour dominer les
remparts de la cité assiégée. Souvent, elles étaient
munies à l'un des étages supérieurs, d'un pont-levis
qui se rabattait sur la muraille ou sur la brèche et permettait
aux assaillants de pénétrer dans la ville. Quand elles
n'étaient pas blindées comme celle de Démémtrius,
on les garnissait de peaux crues pour les protéger contre l'incendie.
Montées sur des roues très basses, qu'on mettait en mouvement
de l'intérieur à l'aide de leviers, les essieux faisant
office de treuils, elles avaient l'air de marcher d'elles-mêmes.
Contre ces monstres automobiles les assiégés employaient
divers moyens de défense. Tantôt, ils essayaient de les
briser à coups de bélier ou en lançant sur eux
de lourdes pièces avec les machines de jet ; tantôt ils
les brûlaient, soit en y mettant directement le feu pendant des
sorties soit en y lançant des traits ou des vases garnis de subtances
incendiaires. D'autres fois, ils employaient la sape et minaient le
terrain sur lequel ils étaient placés, car la tour de
siège une fois renversée ne pouvait plus être relevée.
Les Tyriens, assiégés par Alexandre, employaient même
contre ses tours un moyen de défense assez original : ils leur
jetaient d'immenses filets qui les enveloppaient tout entières
; et, tandis que les défenseurs essayaient de se dépêtrer
de ces rets, ils avaient tout loisir de brûler le monstre ou de
l'enfoncer à coups de bélier.
Ces tours mobiles ne servirent pas seulement à l'attaque des
villes. Elles figurèrent aussi dans les batailles. Cyrus ne se
contentait pas des chars à faux, il eut ainsi des tours de guerre.
A la bataille de Thymbrée, plus de cinq siècles avant
Jésus-Christ, l'armée perse en avait plusieurs. Ces tours
étaient hautes de 4 m. 50 environ. Chacune renfermait vingt archers
et était traînée par huit paires de boeufs. Mais
à l'inverse de nos tanks qui vont de l'avant et déblaient
la voie à l'infanterie, les tours de Cyrus demeuraient derrière
les lignes de fantassins, et les archers, du haut de leur plate-forme,
tiraient par dessus la tête des troupes placées devant
les tours et criblaient l'ennemi de coups plongeants.
***
Le moyen âge négligea la guerre des machines. Les chevaliers
qui à l'apparition du canon, crièrent à l'indignité,
eussent rougi d'employer à la guerre d'autres armes que leur
lance et leur épée.
Mais, au XVIe siècle, on voit reparaître certains engins
inspirés des méthodes guerrières de l'antiquité,
et perfectionnés. Végèce dans son livre des Stratagèmes,
imprimé à Paris en 1536, reproduit l'image d'une tour
roulante percée de meurtrières à travers lesquelles
passe la gueule de plusieurs couleuvrines, que servent des artilleurs
coiffés de casques tout pareils à la bourguignote d'aujourd'hui.
Les Anglais, sous Henri VIII, employèrent, dit-on, de ces chariots
de guerre. On cite encore un ingénieur du roi de France Henri
III, Agostino Ramelli, qui construisit en 1588 un grand chariot voûté,
clos et bien fermé où deux ou trois couples d'arquebusiers
étaient postés à des meurtrières. Le propulseur
de ce char de guerre se trouvait à l'intérieur, où
un homme actionnait, au moyen d'une manivelle, deux aubes latérales
à palettes mordant le sol.
C'étaient là les autos-mitrailleuses de la Renaissance.
Autos ? non ; car ces tours et ces chars marchaient encore à
bras d'homme, comme l'antique hélépole de Déniétrius
Poliorcète. Le premier projet de traction automobile appliquée
à l'artillerie ne devait voir le jour, avec le chariot de Cugnot,
qu'à la fin du XVIII, siècle ; et la première forteresse
automobile, la véritable précurseuse du tank, ne devait
être réalisée que cent ans plus tard, à l'époque
de la première guerre franco-allemande.
L'inventeur était un ingénieur italien nommé Balbi.
Dès l'année 1854, il avait présenté au gouvernement
français son projet de Forteresse mobile en fer. On
sait quel est généralement le sort des inventions présentées
à nos administrations : celle de Balbi, par sa nouveauté,
par son audace, devait plus que toute autre, être mal accueillie.
Une forteresse marchant toute seule à la vapeur... Allons donc
! jamais la routine des bureaux ne consentirait à croire cela
réalisable. L'inventeur fut éconduit.
Cependant, il ne se découragea pas. En 1870, au lendemain de
l'investissement de Paris, il vint proposer au gouvernement de la Défense
nationale l'invention que le gouvernement impérial avait dédaignée.
Il n'eut pas plus de chance, hélas avec la république
qu'avec l'empire. Les gouvernements changent, mais l'esprit rétrograde
des bureaux reste éternellement le même.
Alors Balbi eut recours à l'initiative privée et ouvrit
une souscription en vue de construire sa forteresse roulante. On a retrouvé
les listes de souscripteurs et relevé, paraît-il, parmi
les premiers noms inscrits, celui de M. Clémenceau, alors maire
de Montmartre.
Balbi, dans une brochure aujourd'hui introuvable, décrivait en
ces termes sa Forteresse mobile :
« Mue par la vapeur, disait-il, et construite comme les monitors
américains, c'est-à-dire cuirassée et à
l'épreuve de l'artillerie, cette forteresse, de dimensions variables,
percée de créneaux pour le tir des fusils et armée
soit de mitrailleuses, soit de canons de différents calibres,
peut, en se portant contre les ouvrages ennemis, les détruire
et frayer, à travers leurs lignes d'investissement, un passage
aux défenseurs de Paris. Construite de façon à
pouvoir, dans les plaines comme sur les côtes, gravir ou descendre
des plans inclinés, elle doit, par la seule masse de son poids,
s'élevant jusqu'à dix, quinze mille kilogrammes et plus,
renverser, broyer, détruire tous les obstacles. C'est, en un
mot, une véritable forteresse roulante, invulnérable et
dont l'action est terrible. Sur la déclivité de cette
forteresse, dans ses parties essentielles, les projectiles de toute
nature ne peuvent que dévier ou ricocher. La pièce d'artillerie
dont elle doit être armée ne peut être démontée.
Par une disposition nouvelle, le sabord, qui ne s'ouvre que pour l'issue
du boulet, de l'obus ou de la mitraille se referme aussitôt le
coup parti et reconstitue alors, par la jonction des quatre lames triangulaires
qui le composent, l'éperon qui termine, comme dans les monitors
maritimes, l'avant de la forteresse.
» Assailli par des ennemis qui en voudraient, par impossible,
tenter l'assaut, le toit conique de la tour, armé à sa
base de lames solides, aiguës et tranchantes, se met à tourner
avec une rapidité qui devient vertigineuse, et tout ce qui l'approche
est, en un instant, rejeté au loin, fauché, dispersé,
anéanti. De larges roues, adaptées
à des essieux brisés, supportent l'appareil et lui permettent
d'avancer, de reculer, d'obliquer, d'évoluer en tous sens sur
les terrains les plus accidentés, qu'elle nivèle, pour
ainsi dire, sous son poids énorme, comme sur les routes ordinaires
ou les voies ferrées. Indépendamment des artilleurs et
des soldats postés aux créneaux, un seul homme suffit
à la direction de cette énorme machine. Et la dépense
du combustible est de un franc cinquante par heure, Le prix de chaque
forteresse est de dix-sept mille francs. »
Avouez que c'était un prix fort raisonnable pour un pareil engin
et que le budget de la guerre eût pu supporter la dépense
sans qu'il en coûtât beaucoup à la France. Mais Trochu,
gouverneur de Paris, n'était pas l'homme des initiative hardies.
Balbi, cependant, recueillit par la souscription privée assez
d'argent pour réaliser son rêve ; il se mit à l'oeuvre.
Trop tard, hélas ! La paix fut signée avant que la forteresse
pût être achevée ; et cette aïeule de «
Crème de menthe » ne servit jamais.
Depuis lors, d'autres projets virent le jour, mais restèrent
à l'état de projet. Dans aucune des guerres récentes
on ne signale l'emploi de forteresses automobiles conçues sur
le principe de ce terrible tank dont les Allemands eurent pour la première
fois la révélation au cours de la bataille de la Somme.
Et, cependant, d'aucuns prétendent que Guillaume II en personne
aurait, en 1897, dessiné de ses augustes mains un projet de forteresse
automobile à l'usage de l'armée allemande.
Qu'en advint-il ? Nul ne pourrait le dire. L'invention du criminel Tonchatout
ne sortit pas du néant. C'est bien dommage que tous les rêves
de ce fou sanguinaire n'y soient pas demeurés avec elle.
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 29 avril 1917