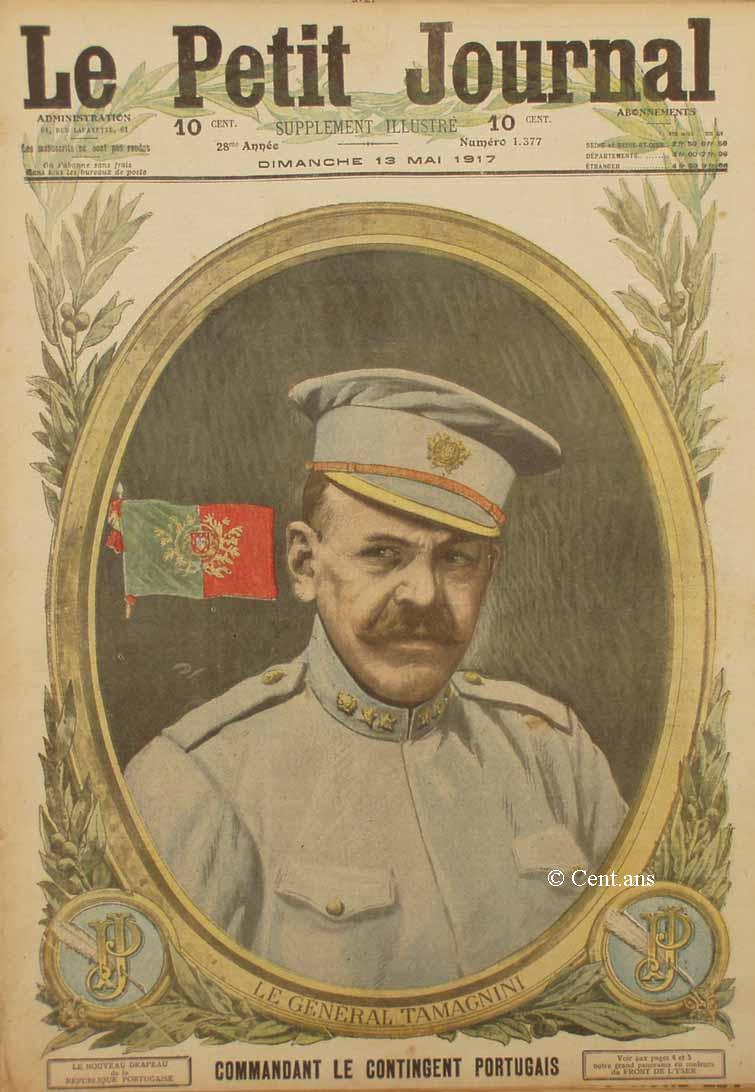NOS GRAVURES LE GÉNÉRAL TAMAGNINI
Le général Tamagnini d'Abreu est le commandant en chef
des forces portugaises qui combattent sur notre front.
Grand, élancé, il a gardé, bien qu'il ait légèrement
dépassé la soixantaine, l'allure jeune d'un officier de
cavalerie.
Il fut, sous l'impulsion du ministre de la Guerre du Portugal, M. Norton
de Mattos, un des réorganisateurs de l'armée portugaise.
Il aspirait ardemment à faire jouer à son pays un rôle
dans la grande lutte. C'est avec une forte volonté qu'il a préparé,
au camp de Tancos, à peu de distance de Lisbonne, les troupes
qui lui étaient confiées.
Figure essentiellement militaire, le général Tamagnini
s'est toujours tenu en dehors des agitations politiques. On l'a surnommé,
au Portugal - et c'est un surnom dont il est fier - le « disciplinateur
». Sa sévérité sait, d'ailleurs, se tempérer
de cordialité, et il inspire la plus grande confiance aux soldats
qu'il a formés. Ils savent que, en venant prendre leur part d'honneur
et de péril à côté des Français et
des Anglais, ils ouvrent pour leur patrie, riche de grands souvenirs,
une ère nouvelle d'histoire. C'est cette idée qu'il a
développée en eux, en s'attachant à doubler de
cette force morale l'entraînement auquel il les soumettait.
Ajoutons ce détail savoureux à la courte notice sur le
grand chef portugais :
Le général Tamagnini jouit du privilège de fleurir
sa boutonnière avec les camélias du fameux château
national de Penha, dont les fleurs, selon une nouvelle coutume, sont
réservées aux meilleurs serviteurs de la nation
VARIÉTÉ
Le Portugal et la France
Le contingent portugais - Relations légendaires et historiques de la France et du Portugal. - La Légion portugaise sous le premier empire. - Connaissons mieux le Portugal.
Depuis deux mois les troupes portugaises sont en France : depuis quinze
jours seulement les journaux français sont autorisés à
le dire. Auparavant c'était un secret. Seulement, ce secret,
imposé à la presse française, ne l'était
pas à la presse portugaise. Dès le mois de mars, les journaux
de Lisbonne avaient annoncé, avec des manchettes énormes,
le débarquement des contingents portugais en France. Mais il
paraît que les Allemands ne lisent que le journaux français
; ils ne lisent pas les journaux portugais.
Voilà pourquoi, apparemment, les Portugais sont arrivé
à bon port. - Notez que je ne dis pas quel port il est toujours
interdit de le nommer.
Bref, concluons de tout ceci que, s'il est vrai, suivant un fameux refrain
d'opérette, que les « Portugais sont toujours gais »,
nos amis de Lusitanie n'ont pas dû manquer, dès leur arrivée
chez nous, de s'égayer quelque peu aux dépens de la censure
française.
***
Ce refrain, dont je viens d'évoquer le souvenir, ce refrain qui
présente les Portugais comme un peuple perpétuellement
en gaîté est d'ailleurs fallacieux. Les Portugais sont,
au contraire, un peuple plutôt grave, sérieux, peu bruyant,
chez lequel l'élément celtique domine souvent l'élément
latin.
Ce n'est point à dire que les Portugais soient rebelles aux enthousiasmes...
Non pas ! L'ardent soleil qui féconde les campagnes lusitaniennes
n'est point sans influence sur les cerveaux ; mais ses ardeurs sont
adoucies par le tempérament du peuple. Le Portugais ne s'emballe
pas. Il raisonne, et ses enthousiasmes sont réfléchis.
Ils n'en sont que plus sincères.
Sincère aussi, et profondément sincère est l'attachement
du peuple portugais à notre pays On ne sait pas assez en France
combien l'influence de notre civilisation, de nos moeurs, de notre esprit
est vivace en Portugal.
Les relations cordiales de la France et du Portugal remontent jusqu'aux
temps légendaires. On en trouvé la trace dans une de nos
plus jolies traditions maritimes, la légende de Jean de Calais,
Jean de Calais, marin fameux, était la terreur des pirates qui
infestaient les côtes du Calaisis. Or, il advint qu'un jour ayant
délivré deux belles jeunes filles captives d'un forban,
il s'éprit de l'une d'elles et l'épousa. Plus tard, devant
reprendre la mer, et voulant emporter partout avec lui la chère
vision de celle qu'il aimait, il fit peindre l'effigie de sa femme à
la proue de son vaisseau.
Puis il partit pour le Portugal où il allait, faire du commerce.
Et comme il entrait dans le port de Lisbonne, le roi de ce pays avisa
son vaisseau et reconnut, dans l'image peinte à l'avant, le portrait
de la princesse sa fille, enlevée jadis par les pirates que Jean
de Calais avait vaincus. La tradition ajoute que le roi ayant déclaré
valable le mariage de sa fille et du héros calaisien, désigna
ce dernier pour lui succéder.
Et c'est ainsi qu'aux époques fabuleuses, un marin français
régna sur le royaume des Algarves.
Si de la légende nous passons à histoire, nous retrouvons
encore la France présidant à la naissance de la nation
portugaise.
Jusqu'à la fin du XIe siècle, jusqu'au règne d'Alphonse
VI de Castille, l'histoire du Portugal s'est confondue avec celle de
l'Espagne. C'est seulement sous ce souverain qu'elle s'en détache
complètement.
Un seigneur français, Henni de Bourgogne, ayant prêté
au roi Alphonse le secours de son épée, celui-ci lui donna
en récompense sa fille Théréja, avec le comté
de Portugal pour dot.
Telle est la véritable fondation de l'État de Portugal,
dont le premier prince fut un Bourguignon, descendant direct de la famille
capétienne qui régnait en France.
N'y a-t-il pas de l'atavisme dans cet attachement si vif que, le Portugal
a toujours témoigné à la France ?
La place me manque pour passer en revue les fastes, si mal connus, du
royaume lusitanien ; mais il est cependant une époque féconde
en exploits merveilleux, une époque glorieuse que nous ne saurions
laisser dans l'ombre : c'est celle des conquêtes maritimes du
Portugal.
De Lisbonne, des caravelles innombrables voguent à la conquête
du monde. Des hommes hardis, des marins aventureux, en qui bouillonne
le vieux sang généreux de la Lusitanie, vont, en donnant
à leur pays l'empire des mers, le combler de richesses et le
couvrir de gloire.
Déjà, sous le roi Jean 1er, des Portugais ont découvert.
Puerto-Santo et Madère. et tenté le voyage circulaire
autour de l'Afrique ; don Henri, son fils, fondant l'École navale
de Saint-Vincent, fut le véritable instigateur des grands voyages
en Afrique et dans l'Inde.
Sous Jean II, les navigateurs portugais abordent au Bénin et
au Congo ; Barthélemy Diaz découvre le cap de Bonne-Espérance
; Payva, s'enfonce courageusement dans l'Abyssinie où il est
assassiné ; Covillan descend la mer Rouge et visite le premier
Calicut et Goa, ces deux villes de L'Inde occidentale qui seront plus
tard les comptoirs les plus riches des Portugais.
Sous Emmanuel le Fortuné, voici la plus haute figure des grands
aventuriers de ce temps : Vasco de Gama, le conquérant de l'Inde.
Puis, c'est Alvarès Cabral qui découvre le Brésil.
Et, pendant de nombreuses années, se succèdent, ininterrompues;
les expéditions, les aventures qui tiennent du merveilleux, les
étonnantes victoires des Albusquerque, des Almeida, de Soarez,
de Siquiera, de Constantin, de Bragance, de tous ces valeureux chefs
qui, à la tête de quelques poignées de braves, firent
flotter le drapeau portugais sur toutes les côtes, du golfe Persique
jusqu'en Chine, depuis Ormuz Jusqu'aux embouchures du fleuve Jaune.
Rien ne manque à la gloire de cette extraordinaire épopée
: il se trouva pour la chanter un poète digne d'elle. Les hauts
faits de Gama et des conquérants portugais inspirèrent
à Luis de Camoëns l'un des plus beaux parmi les poèmes
épiques de tous les temps et de tous les pays : ces Lusiades
où l'on retrouve sans cesse, au milieu des accents poétiques
les plus élevés, les sentiments les plus purs, ce courage
indomptable, cette noble fierté, ce caractère chevaleresque,
cet amour profond de la patrie qui sont les qualités dominantes
de la nation portugaise, oeuvre sublime qui commande à la fois
l'admiration pour le poète qui l'a conçue, la sympathie
et le respect pour le peuple qui l'inspira.
***
Ce n'est pas la première fois que des troupes portugaises combattent
côte à côte avec les soldats de la France.
A l'époque où, dans l'armée française, il
y avait des représentants de presque toutes les nations de l'Europe,
c'est-à-dire sous le premier empire, la France eut à son
service une légion portugaise. Un décret de 1808 l'organisa.
Elle comptait cinq régiments d'infanterie, deux de cavalerie
et une batterie d'artillerie commandés par le général
marquis d'Alorna. Les soldats de la légion portugaise portaient
un habit couleur brun-de-capucin avec parements et retroussis rouges
et un pantalon a bande rouge. Les cavaliers avaient le casque en cuir
vernissé avec chenille.
« Ces troupes, dit Paul Ginesty, qui a consacré une étude
à la légion portugaise, firent leurs grands débuts,
pendant la campagne d'Autriche, à la, journée d'Abensberg.
Après Wagram, Napoléon donnait aux Portugais une preuve
de sa satisfaction de leur attitude : il formait une demi-brigade de
compagnies d'élite tirées de leurs bataillons.
On retrouve les Portugais Borodino, où, sous les ordres de Davout
et de Ney, ils contribuèrent à l'attaque des redoutes
de Semenowskoï. Malgré de grandes pertes, ils montrèrent
de la constance et de la fermeté pendant les phases critiques
de la campagne de Russie. Ils furent de ces braves qui, à Wiazma,
rompirent les lignes russes dans des conditions désespérées.
Ils firent partie ensuite, de ces garnisons d'Allemagne que laissait
le prince Eugène, gagnant Dresde. Des détachements portugais
partirent de France avec l'empereur, allant se jeter dans une nouvelle
et suprême lutte, et furent versés dans le corps d'armée
commandé par Bertrand. On les vit à Lutzen ; il y en eut,
plus tard, à Hanau, dernière bataille gagnée sur
le sol étranger... »
Napoléon n'avait pas oublié les services rendus par les
soldats portugais. Quand furent licenciées les troupes étrangères
à la solde de la France, il recommanda au ministre de la Guerre
les plus grands ménagements à leur égard. Jusqu'en
avril 1814, un bataillon portugais continua à servir la cause
française.
Ces souvenirs de la collaboration des soldats de Lusitanie à
la grande épopée impériale s'imposaient il l'heure
où de nouveau les Troupes portugaises viennent combattre auprès
des nôtres pour la cause de la liberté des peuples.
***
Cette constance et cette fermeté que les soldats de la légion
portugaise montrèrent jadis pendant la retraite de Russie sont
d'ailleurs les qualités de la race.
La grande vertu des Portugais est la patience ; et c'est une vertu indispensable
dans la guerre telle qu'on la pratique aujourd'hui.
Cette patience, s'il faut en croire les écrivains qui ont étudié
le Portugais chez lui, est poussée jusqu'aux extrêmes limites.
« La patience, dit Mme Quillardet dans son ouvrage les Portugais
chez eux, est la caractéristique du Portugais, le mot qui
lui revient toujours à la bouche. Pacencia ! fait l'enfant
qui vient d'être réprimandé ; « Prends patience
», dit l'homme riche au mendiant en lui refusant l'aumône.
Et le plus beau, c'est la patience avec laquelle celui-ci accepte le
conseil.
» Je regardais, un jour, à Lisbonne, tomber une forte averse
; partout ailleurs on aurait couru se réfugier sous quelque porche.
Eux, tranquillement, sans bouger, commissionnaires, marchands de poissons,
recevaient la douche. Un tramway est en panne ; les pauvres mules efflanquées
ne peuvent gravir la montée ; ailleurs, en France, la moitié
des voyageurs descendraient pour alléger et pousser à
la roue ; ici on attend une heure, deux heures, jusqu'à ce qu'arrivent
des mules de renfort. On attendrait jusqu'au lendemain au besoin, demain
(amanha) étant, avec la patience le grand remède
à tout : amanha et pacencia. »
Nos amis de Portugal ont eu, dès le début de leur intervention
dans la guerre, l'occasion de témoigner de cette résignation
qui forme le fond de leur caractère. Partis au mois de mars de
leur pays ensoleillé, ils ont souffert cruellement, mais stoïquement,
du froid qui régnait alors en mer et sur nos côtes.
Cependant, leur enthousiasme n'en était pas refroidi.
Un de nos confrères qui assista à leur débarquement
raconte que M. Chagas, le ministre de Portugal en France, qui était
venu leur souhaiter la bienvenue, s'adressa à l'un d'eux.
- Toi qui es de la montagne n'as-tu pas redouté l'orage et les
sous-marins ?
- Non, lui répondit le petit soldat :
j'avais, en partant, jeté mon cœur au large.
Et notre confrère ajoute :
« Cette forme originale de notre « Le sort en est jeté
! » indique un fatalisme tout militaire, qui ne saurait surprendre
chez les fils des marins hardis qui, les premiers, atteignirent ou conquirent
la Chine, le japon, les Indes, le Brésil, la côte de Malabar,
le cap le Bonne-Espérance, le cap Vert, le Congo, les Canaries,
Madère, - chez ceux qui ont à honorer un conquistador
comme Vasco de Gama et un poète comme Camoëns. Un colonel
portugais, accompagnant le ministre du Portugal, arrêtait parfois
des soldats ce promenant dans la ville et leur demandait s'ils étaient
contents de se trouver en France. Tous disaient leur satisfaction d'avoir
heureusement effectué le voyage.
- Alors, dit le colonel bon enfant, à quelques-uns d'entre eux,
tenez-vous bien ; songez que les soldats français vous regardent...
» Et, l'un des petits troupiers portugais, qui avait, l'oeil brillant,
mais le nez rougi par la bise, lui répondit en souriant avec
malice et en saluant militairement :
- Oui, mon colonel ; mais on se tiendra mieux encore quand il fera moins
froid.. »
Les soldats français connaissent déjà la valeur
de leurs camarades lusitaniens. Dès le début de 1915,
une mission militaire française avait été envoyé
en Portugal. Elle en rapporta les meilleures impressions.
« Nous sommes enchantés de ce que nous avons vu, disait
un des officiers de cette mission. Nous sommes d'avis que le soldat
portugais est l'un des meilleurs d'Europe. Il est prêt à
participer victorieusement aux combats des tranchées. Il est,
comme le disait le général Marbot, un soldat courageux,
sobre et loyal. Nous l'admirions déjà comme soldat d'Afrique.
Nous sommes sûrs qu'il sera également à la hauteur
de sa renommée européenne. »
Tous ceux qui ont vu les Portugais depuis leur arrivée, ont pu
constater dès l'abord que les soldats ont l'aspect vif, vigoureux,
très crâne dans leur uniforme bleu horizon, et qu'ils sont
équipés de façon très pratique. Leur allure
souple n'a rien du militarisme allemand. Les officier sont jeunes, élégants.
Tous parlent le français, et la plupart même le parlent
d'une façon très pure.
C'est là, pour les Français qui sont peu renseignés
sur le Portugal, une preuve de l'attachement sincère et profond
que ce pays a pour la France et de l'admiration qu'on y professe pour
la civilisation française.
Il faut qu'on sache, en effet, qu'en Portugal tout est à la mode
de France et que, sur dix volumes que vendent les libraires, il y en
a neuf en langue française et un en portugais.
Un des grands chagrins des Portugais, c'est de ne pouvoir communiquer
directement avec la France, au double point de vue intellectuel et économique.
La nécessité de traverser l'Espagne équivaut pour
eux à un véritable éloignement.
Et puis, ils sentent que s'ils nous connaissent bien et nous estiment,
nous autres, nous les connaissons mal. Nous les confondons trop souvent
avec leurs voisins les Espagnols. Or, les deux peuples ont des vertu
diverses, des signes distinctifs bien différents. Le Portugais,
je le répète, tient beaucoup du Celte, alors que l'Espagnol
est un Latin.
Ce ne sont point seulement de hautes montagnes qui séparent les
deux pays, ce sont aussi des traditions. Les deux langues même
n'ont rien de commun : celle du Portugal est plus douce, plus harmonieuse
; elle n'a pas pris les consonnes gutturales que les Arabes ont importées
en Espagne. Les Espagnols lui rendent d'ailleurs un juste hommage. Ils
l'appellent la langue des fleurs.
***
Quelques années avant la guerre, un de nos compatriotes qui avait
séjourné assez longtemps en Portugal, nous disait :
« En Portugal, on aime la France. La langue française est
parlée à Lisbonne et dans les grandes villes du Portugal,
non seulement, par la haute société, mais par la plupart
des commerçants et même par des ouvriers. L'anglais y est
bien moins répandu que le français, et l'allemand ne l'est
pas du tout : et c'est par l'intermédiaire de notre propre langue
que cependant les Allemands parviennent à se substituer à
notre commerce dans cette Lusitanie si française, car dans les
bibliothèques privées on trouve plus d'ouvrage français
que d'ouvrages portugais...»
Dans des conditions si propices, un commerce actif eût dû
s'établir entre les deux nations. Eh bien, il n'en était
rien. Là, comme partout, les Allemands nous dominaient : ils
avaient conquis la seconde place, après l'Angleterre, dans les
importations en Portugal, alors que nous n'occupions que le cinquième
rang, après l'Espagne et les Etats-Unis.
Le même Français ajoutait :
« L'une des grandes causes du peu de développement des
relations commerciales entre la France et le Portugal, c'est le trop
petit nombre de Français établis en Portugal. Les maisons
allemandes et anglaises y ont des succursales, des représentants,
des ingénieurs chargés de réparer les machines,
de les garantir, de les mettre en état. Les maisons françaises
se contentent le plus souvent d'y envoyer des commis-voyageurs qui n'ont
pas l'autorité nécessaire pour traiter de grosses affaires.
C'est ainsi que l'industrie de l'électricité en Portugal
est presque entièrement aujourd'hui entre les mains des Allemands.
» Notez que la France a déjà beaucoup fait pour
le Portugal : elle a construit ses chemins de fer, ses ponts, ses ports,
mais elle l'a fait parce que le Portugal l'en a priée. Ce n'est
pas suffisant ; il faut aller solliciter ses achats, et notre voisinage,
l'excellence de nos produits nous permettent d'affronter avantageusement
la concurrence étrangère. Mais il faut avant tout offrir
notre marchandise et avoir des bateaux pour l'amener à bon compte...
»
Voilà des suggestions qui ne devront pas être perdues après
la guerre.
Les Portugais, d'ailleurs, comptent beaucoup sur la fraternité
d'armes créée par la guerre entre eux et les Français,
pour amener ceux-ci à les mieux connaître et à mieux
connaître leur pays.
Leur espérance ne saurait être vaine. Il faut que les Français
aient des relations plus étroites avec ce peuple si hospitalier
et si français de coeur ; il faut qu'ils aillent plus nombreux
vers cette contrée superbe et vers cette noble cité de
Lisbonne qui, suivant l'expression de Byron, « déploie
son image flottante sur ce noble fleuve du Tage que les poètes
ont pavé de sable d'or ».
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 13 mai 1917