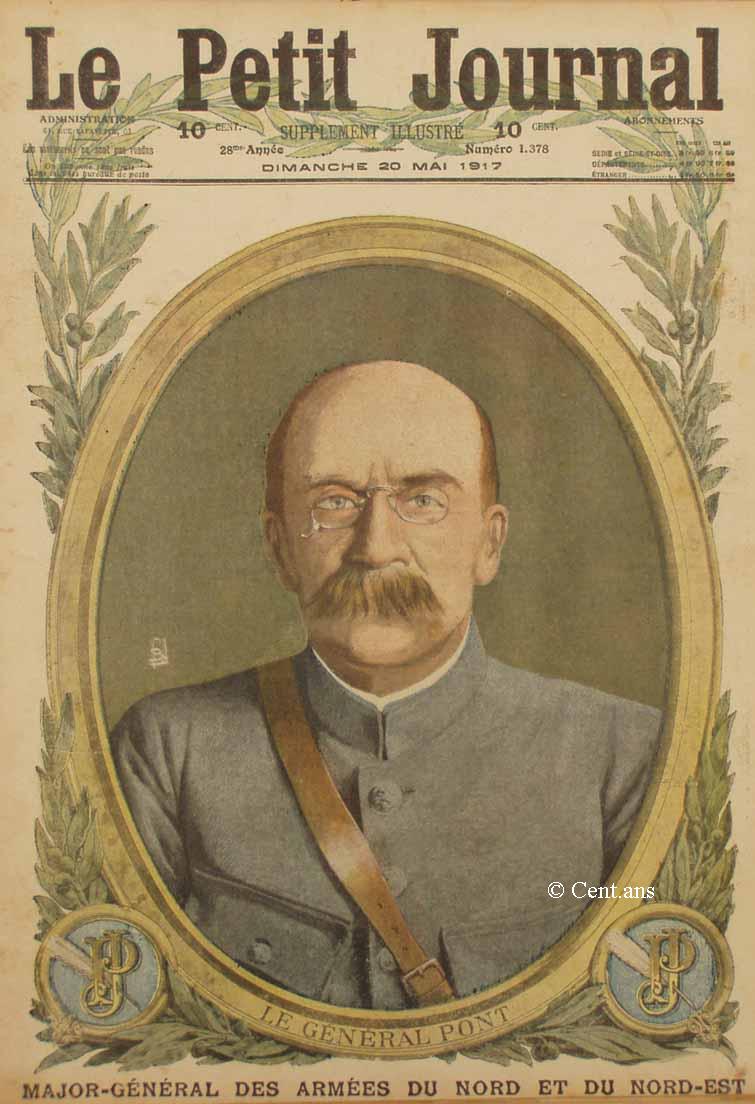Le général Pont
Major général des Armées du Nord et du
Nord-Est
Le général Pont, major général
des armées du Nord et du Nord-Est depuis le 20 décembre
1916, appartient à l'arme de l'artillerie.
Au moment de la mobilisation, le lieutenant-colonel Pont était
chef du 3e bureau au ministère de la Guerre. Il fut alors placé
tête du 3e bureau de l'état-major général.
On sait quelles sont les attributions de ce ce bureau, chargé
des opérations, et l'on peut imaginer le travail qui lui incomba,
particulièrement au début de la campagne : retraite, victoire
de la Marne, bataille de l'Yser, organisation des positions fortifiées.
Nommé colonel en novembre 1914, chargé des fonctions d'aide-major
général des opérations en juin 1915, puis général
de brigade à titre temporaire le 11 octobre 1915, 1e général
Pont n'a pas cessé de prendre une part active à l'élaboration
de la tactique exigée par la nouvelle forme de la guerre.
Le 28 janvier 1916, il fut nommé au commandement de la 11e brigade,
et le 30 avril à celui de la 6e division d'infanterie, à
la tête de laquelle il prit part à la défense de
Verdun et combattit à Vaux, Thiaumont et Bezonvaux, Nommé
général de division le 16 décembre 1916, il fut
rappelé le 20 décembre au Grand Quartier Général
pour y prendre les fonctions de major général.
VARIÉTÉ
Fortunes rapides
Nouveaux riches. - « Il n'y a que le premier million qui coûte.
» - Les inventeurs qui ont réussi. - La fortune va moins
au génie qu'aux parasites du génie.
On parle beaucoup des « nouveaux riches
» car la guerre qui ruine les uns enrichit les autres. Tel industriel
dont l'industrie marchait cahin-caha naguère, tel commerçant
modeste, tel homme d'affaires habile que les circonstances n'avaient
pas favorisé, devenus fournisseurs de l'État, ont fais
soudain de brillantes fortunes. Les voilà millionnaires.
D'aucuns s'imaginent que les commerces de luxe ont été,
du fait de la guerre, plongés dans le marasme. Il n'en est rien.
Il faut bien que les nouveaux riches se meublent, se parent, dépensent
leurs revenus. Un chroniqueur racontait l'autre jour cette anecdote
:
Une dame d'allure bourgeoise, simplement mise, avec un petit air timide,
entre chez un des plus somptueux joailliers de la rue de la Paix et
se fait montrer des colliers de perles.
- Combien celui-ci ?
C'est le plus beau : un splendide collier de sept rangs de perles du
plus pur orient.
-Cent mille francs.
La dame, d'un modeste sac de cuir usagé tire cent billets de
mille, emporte l'écrin, monte dans un taxi et s'en va.
C'est une nouvelle riche qui vient de s'offrir sa première fantaisie.
Combien de gens qui, naguère, eussent à peine osé
rêver l'aisance, connaîtront, grâce à la guerre,
l'opulence, et auront vu, en moins de trois ans, s'échafauder,
sur 1a douleur hélas ! et la misère d'autrui, leur prodigieuse
fortune !
La richesse n'est pas toujours le fruit de longs efforts. Elle arrive
plus souvent quoi ne le croit par un coup heureux du destin. Et, pour
certains, la guerre aura déclenché cette faveur du sort.
Aux États-Unis, avant la guerre, il y avait, suivant la statistique,
4.100 personnes ayant plus d'un million de dollars, c'est-à-dire
plus de cinq millions de francs.
Après la guerre, il y en aura 500 de plus. Telle firme de poudre
a distribué en 1915 un dividende de 200 % à ses actionnaires.
Telle autre fabrique de poudre sans fumée fait un bénéfice
net de 1.600 000 francs par semaine. Telle fabrique de canons qui produit
plus que Krupp et le Creusot, a gagné, dans la seule année
1915, 225 millions, dont le directeur a touché le dixième.
Une maison de Brooklyn fabrique 15.000 obus par jour, qui laissent un
profit de 450.000 fr.
La guerre a tellement développé l'industrie en ce pays
que certaines villes manufacturières dans lesquelles se trouvent
des fabriques d'armes et de munitions, ont vu, en moins d'un an, doubler
leur population ouvrière.
Jugez par là des fortunes réalisées.
***
Il ne faudrait pas conclure de ceci que la guerre seule engendra de
« nouveaux riches » et que les fortunes rapides ne se créent
qu'à la faveur des massacres et des bouleversements.
L'activité et l'ingéniosité humaines, et aussi,
disons-le, la chance amènent, en temps de paix comme en temps
de guerre de pareils résultats. Ils font moins scandale en temps
de paix, voilà tout !
Nous en aurions maintes preuves, sans quitter l'Amérique, et
en passant en revue seulement l'histoire de quelques milliardaires des
États-Unis.
Presque toujours, on trouve au début de ces énormes fortunes
quelque chose de hasardeux et de providentiel. Un coup de veine a amené
le premier million. Et, comme disait un jour le milliardaire Richard
Copians, il n'y a que le premier million qui coûte : les autres
viennent tout seuls.
Astor, le premier de la dynastie, simple petit représentant d'une
maison anglaise aux États-Unis, s'avise d'acheter des fourrures
aux Indiens et aux trappeurs du Canada et de les revendre à New-York.
Il amasse rapidement 250.000 dollars avec lesquels il spécule
sur les terrains de la ville. En quelques années, il est à
la tête d'une fortune colossale.
Titus Salt, auquel Bradfort, devenue grâce à lui une grande
ville industrielle, a élevé une statue, n'était
qu'un simple courtier en laines. Ayant acheté une grande quantité
de bourre de laine dont il ne pouvait se défaire, et se trouvant,
de ce fait acculé à la ruine, il se mit à chercher
les moyens d'utiliser cette bourre vaille que vaille. Après quelques
essais, il trouva une combinaison et arriva à fabriquer, avec
ce produit de peu de valeur, une étoffe fine et soyeuse qui eut
une vogue considérable. Sa fortune était faite. Elle était
sortie, chose singulière, d'une affaire que, tout d'abord, i1
avait pu croire désastreuse.
George Flower, modeste fermier d'Amérique, avait acheté
à vil prix tous les terrains d'une plaine. Sa ferme prospéra
vite. Il revendit ses champs avec un énorme bénéfice
et devint millionnaire en quelques années. Là, s'élève
aujourd'hui Chicago.
Revenons en Europe. Est-il histoire plus merveilleuse que celle de James
Baird ? Fermier en Écosse, il labourait son champ de ses mains,
quand la présence de cailloux noirs parmi les mottes de terre
attira son attention. Sans rien dire à personne. il creusa, chercha,
trouva la houille. Quelques années plus tard, le petit fermier
était devenu le plus opulent métallurgiste de son pays.
A Birmingham, un jour, un vieux médecin de la ville s'évertuait
à tailler une plume d'oie afin de rédiger l'ordonnance
qu'attendait un client. Celui-ci regardait et songeait.
- Docteur, dit-il en s'en allant, je vous apporterai demain une plume
que vous n'aurez pas besoin de tailler.
Le lendemain, en effet, il apportait au médecin une plume de
fer fabriquée par lui et qui écrivait fort bien.
- Pourquoi n'en faites-vous pas d'autres ? lui dit le docteur.
Il en fit d'autres, tant d'autres même, que la manufacture de
plumes de Birmingham, au bout de quelque temps arriva à produire
trois tonnes de fer par semaine, et que son fondateur devint archi-millionaire.
Tous ces hommes devenus presque subitement riches, de pauvres ou de
modestes qu'ils étaient, surent saisir au passage la fortune
par les cheveux. Mais que dire de M. Mac Cormack, de Leadville (Colorado)
? M. Mac Cormack fit mieux : c'est dans ses propres cheveux qu'il trouva
la fortune.
M. Mac Cormack se faisait couper les cheveux. L'artiste capillaire,
placé en pleine lumière, opérait, tondait et s'étonnait
des reflets dorés de la chevelure, déjà blonde,
de son client. A la fin, n'y tenant plus :
- Mais, monsieur, c'est étonnant ! Vous avez des paillettes d'or
sur la tête ! En vérité, c'est un placer que vous
devriez exploiter !
M. Mac Cormack ne dit rien, mais il réfléchit que ses
cheveux, enduits de pommade, avaient fort bien pu retenir ces paillettes
pendant les bains quotidiens qu'il prenait dans un petit ruisselet,
situé derrière son champ, à Leadville, et de là
à s'informer...
Il s'informa, en effet, i1 fit même venir un ingénieur
et l'ingénieur constata que le ruisselet charriait de l'or en
notable quantité. Cormack acheta ou loua tous les terrains, convoqua
quelques gros brasseurs d'affaires, et, finalement, il vendit son ruisseau
contre deux millions en espèces.
La recherche de l'or ne donne pas toujours des résultats aussi
faciles et aussi rapides. L'histoire de Joe Ladue, le fondateur de Dawson-City,
dans l'Alaska, en est la preuve.
« Joe Ladue, dit son biographe, M. Saint Aubin, est un de ces
Yankees nés, comme dit leur expression typique. avec une cuiller
d'argent à la bouche. Il était trappeur et parcourait
les forêts qui environnent le lac Champlain. Ce Bas-de-Cuir avait
alors vingt ans. On le trouve successivement dans le Colorado, le Wyoming,
le Dakota, chassant, prospectant, interrogeant le sol inutilement.
« Une rencontre fortuite avec un vieux camarade Lobdell, lui donne
l'idée d'aller à l'Alaska. Le chasseur de castors, le
chercheur d'or aurait là-bas plus d'occasions de faire fortune.
Lobdell lui prête les premiers fonds nécessaires. Il part,
fait le trafic avec les Indiens, qui lui vendent des fourrures va, vient,
l'oeil et l'oreille au guet. En 1888, il entend dire qu'il y a de l'or
aux environs du Klondike. Quelques mineurs prétendent en avoir
découvert de ce côté. Il n'hésite pas à
s'y rendre, souffre la faim durant des semaines, des mois, se meurt
de froid, Échoue pendant longtemps dans toutes ses investigations,
et réussit, enfin, grâce à une persévérance
héroïque... »
Joe Ladue est archi-millionnaire à quarante-cinq ans. Du jour
où il a trouvé l'or qu'il cherchait, la richesse lui est
venue tout à coup ; mais que d'années de recherches vaines,
que de misères subies avant d'atteindre ce résultat !
La fortune, ici, n'est pas due simplement à un coup de chance
: elle est justifiée par une énergie, une volonté,
une obstination, une fermeté d'âme et un courage au travail
vraiment exceptionnels, et qui forcent l'admiration pour l'homme qui
en témoigna.
On ne peut guère, en de pareils cas, accuser la fortune de s'être
montrée aveugle et d'avoir favorisé qui ne la méritait
pas.
***
La fortune, en effet, n'est pas toujours et fatalement aveugle ; il
lui arrive quelquefois de distribuer ses faveurs à bon escient.
L'histoire de quelques inventeurs en serait la preuve.
Car quoi qu'en dise la légende, tous les inventeurs ne meurent
pas sur la paille ou dans un cabanon. La loi, sans doute, ne les protège
pas assez ; mais la chance parfois leur donne des compensations légitimes.
Le malheur, c'est que beaucoup de grands inventeurs, d'inventeurs de
génie, ayant amené, soit dans l'organisation sociale,
soit dans l'industrie, les plus grands progrès par leurs découvertes
n'obtiennent pas les récompenses qu'ils mériteraient,
et meurent pauvres, alors que ceux qui ont exploité leurs trouvailles
s'enrichissent. C'est l'éternel « sic vos non vobis »
de Virgile. Mais ce n'est pas là, Dieu merci, une loi constante
; et l'on a vu, on voit encore des inventeurs tirer un gros profit,
et un profit rapide de leurs inventions.
Parmi ces favorisés du sort, les petits inventeurs sont généralement
plus nombreux que ceux qui firent accomplir quelque grand progrès
à l'humanité. La reconnaissance des hommes est plus prompte
pour l'inventeur d'un jeu ou d'une babiole ingénieuse que pour
celui dont l'invention géniale doit bouleverser et rénover
la vie sociale.
M. Lacordaire, qui, naguère, dans la Revue des Revues,
montra « comment les petits inventeurs deviennent de gros millionnaires
», a signalé cette particularité.
« Presque toujours, dit-il, ce sont les petites découvertes
dues à la réflexion, à l'observation, au hasard,
qui rapportent les plus gros bénéfices. Telle chose, qui
paraîtra insignifiante à la généralité
des gens sera une source de brillante prospérité pour
qui sait en tirer l'utilité et le profit pratiques. Cela est
si vrai que le premier conseil à donner aux chercheurs est celui-ci
:
« - N'échafaudez pas de projets gigantesques ; ils croulent
fréquemment pendant qu'on les édifie ; contentez-vous
de regarder autour de vous, voyez ce qui manque, ce qui fait lacune,
ce qui pourrait la remplir, et si vous avez le génie de l'invention,
dirigez-le de ce côté... »
C'est, en somme, ce que répondait un jour Edison à quelqu'un
qui lui demandait comment il fallait s'y prendre pour devenir riche.
- Devenir riche ?... Il suffit de s'asseoir et de regarder le premier
objet sur lequel l'oeil tombe ; celui qui ne sait pas en tirer profit
n'a pas un atome d'intelligence.
Passons en revue, avec M. Lacordaire, quelques-unes de ces inventions
simples et pratiques dues à l'observation et qui transformèrent
rapidement leur auteur en millionnaire.
« Une paysanne américaine, qui portait des oeufs au marché,
n'arrivait jamais à destination sans en avoir de cassés.
Elle avait beau prendre des précautions, le cahot de sa voiture,
le ballottement des paniers lui causaient régulièrement
un préjudice plus ou moins grand. Un jour, elle s'avisa d'un
moyen bien simple pour isoler ses oeufs un à un : elle les mit
dans des boîtes divisées en compartiments avec du carton.
Celui-ci n'était pas cher à cette époque.
Elle en pouvait acheter plus qu'il ne lui en fallait pour peu d'argent.
Cette idée lui valut plus d'écus que n'en amassa la Perrette
du pot-au-lait. La paysanne américaine, satisfaite du résultat,
fabriqua des boîtes à compartiments, les vendit et s'enrichit.
« Un paysan de l'Etat du Maine se désolait de voir l'effrayante
consommation de souliers que faisaient ses quatre ou cinq garçons,
butant du pied contre les pavés et usant une paire de chaussures
en un rien de temps. Comment y obvier ? Il imagina de faire revêtir
ces souliers de bouts en cuivre, s'en trouva bien, prit un brevet, exploita
son invention et y gagna un demi-million de dollars... »
Combien d'autres inventions fructueuses naquirent d'une observation
du même genre.
C'est en regardant sa petite fille malade, qui jouait avec des débris
de bois hors d'usage, que Crandall, dont le nom est populaire aux États-Unis,
eut l'idée de fabriquer ces jeux de cubes de bois qui, sous divers
noms : boîtes d'alphabets, boîtes de métamorphoses,
etc., ont fait le tour du monde et ont apporte des sommes énormes
à leur inventeur.
L'inventeur de la balle à corde élastique retenue par
un anneau, laquelle se vendait un sou, a réalisé, en une
année, une fortune colossale.
On a gagné des millions de dollars avec ces petits ressorts en
bronze servant de pinces serre-papiers, et personne n'a songé
que le premier qui les mit en vente n'avait fait que copier un objet
absolument identique déjà en usage chez les Romains, il
y a vingt siècles.
Du reste, fréquemment, on n'invente pas, on retrouve. L'épingle
de sûreté, partout employée aujourd'hui, était
connue des Romaines bien avant notre ère ; un Américain
s'en est souvenu et a gagné 500.000 dollars. - Un autre a remplacé
les baleines des corsets par des plumes de dindon et de poulet : son
brevet lui a été acheté aussitôt pour la
somme rondelette de 250.000 francs.
Un Américain s'est fait 25.000 francs de rentes en inventant
le presse-citron en verre.
A Chicago, un ouvrier employé à la fabrication des boîtes
de conserves, trouve le moyen de les ouvrir sans couteau, par une simple
pression. La maison Armour lui en commande 500.000 d'un coup et le voilà
richissime.
Le brevet de l'encrier automatique qui fournit invariablement la même
quantité d'encre à la plume qu'on y trempe, a été
vendu 2 millions et demi.
L'agrafe et oeillet « Hump » qui, par un procédé
bien élémentaire, ne peuvent se détacher, ont eu
preneur à un prix encore plus élevé.
On assure que l'individu qui, le premier, eut l'idée du porte-crayon
muni d'un morceau de gomme à effacer gagna avec ce simple objet
plus de 500.000 francs.
Celui qui imagina le pince-cravate est devenu millionnaire.
Samuel Fox, qui remplaça les baleines des parapluies par une
ossature métallique, amassa 6 millions.
Le créateur du patin à roulettes laissa à sa mort
3 ou 4 millions.
Harvey Kennedy, qui lança le lacet de soulier, gagna 12 millions
à cette opération.
Enfin, il y a environ trois quarts de siècle, à Paris,
ne vit-on pas un inventeur gagner plus de cent mille francs - véritable
fortune pour l'époque , - avec morceau de papier léger
soutenu par trois bouts de fil, qui constituait un parachute, jouet
dont le succès fut considérable ?
Ces petites inventions procurèrent la fortune à leurs
auteurs. Et, pourtant, elles ne présentaient pas un caractère
d'utilité indéniable. Il faut croire que ces inventeurs
eurent la chance.
La chance, tout est là !... Mais pourquoi cette heureuse fatalité
ne favorise-t-elle pas plus souvent les hommes dont les découvertes
géniales marquent les étapes du progrès humain
?
Quand, plus tard, on recensera les nouveaux riches créés
par la guerre, on verra probablement encore à l'origine de leur
richesse, la chance, les relations, l'audace, et l'on s'apercevra sans
doute une fois de plus que la fortune aura été encore
bien moins au génie lui-même qu'aux parasites du génie.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 20 mai 1917