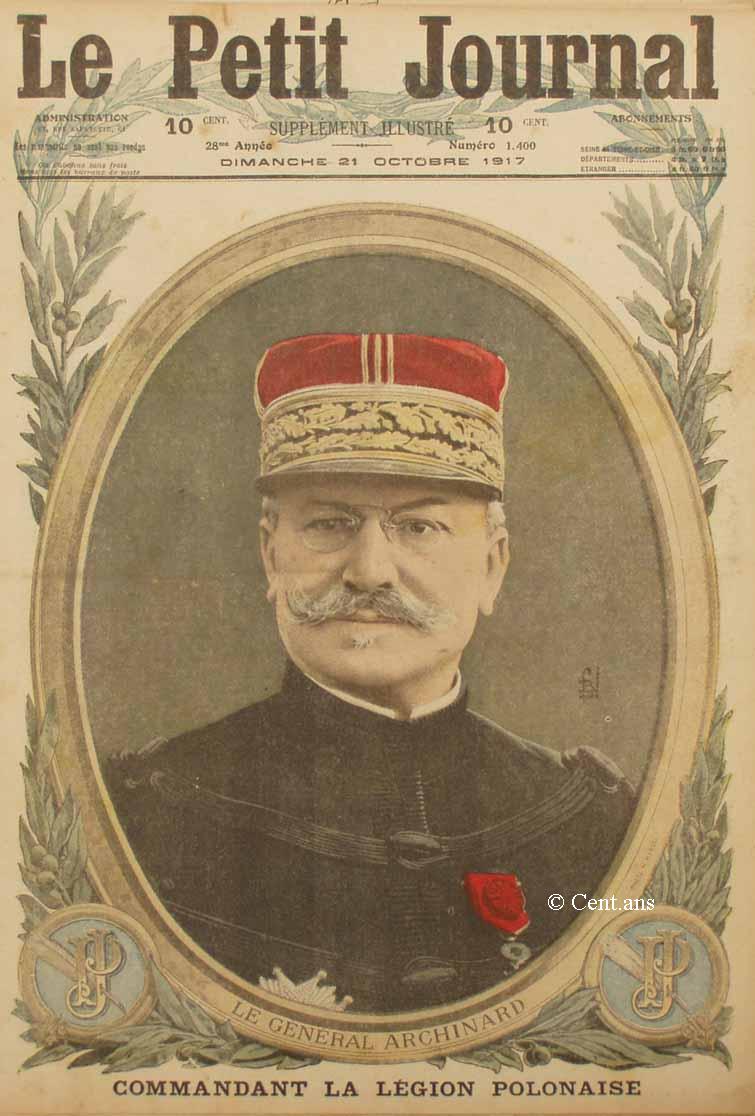Le général Archinard
chef de la mission militaire franco-polonaise
Le général Archinard, chef de
la mission militaire chargée de la formation de l'armée
polonaise en France, comptait, avant la guerre, parmi les plus illustres
de nos officiers coloniaux.
Il venait d'être nommé grand-croix de la Légion
d'honneur quand la guerre éclata. Un commandement lui fut confié
en Alsace, sous les ordres du général Pau.
Lors de la seconde occupation de Mulhouse, il arbora son fanion de commandant
d'armée à Heimsbrunn, après le combat du 19 août
où les Allemands furent battus et perdirent dix-huit canons de
campagne.
Chargé d'inspection dans la zone des armées en septembre
1914, l'ancien vainqueur d'Ahmadou et de Samory fut atteint par la limite
d'âge en 1915 et placé au cadre de réserve. Le voilà
de nouveau au premier plan.
« La nomination du général Louis Archinard au poste
de chef de la Mission militaire franco-polonaise », dit la revue
Polonia a été accueillie dans les milieux polonais
avec la plus profonde reconnaissance envers le gouvernement de la République.
La haute expérience du général ainsi que ses grandes
qualités militaires et civiques sont le meilleur présage
pour l'avenir de la formation de l'armée polonaise. »
VARIÉTÉ
Les Légions polonaises
Corps étrangers au service de la France. -Les légions de Dombrowski. -- Poniatowski, le Bayard polonais. - L'indépendance de la Pologne.
Les étrangers ont, de tout temps, servi
volontiers dans nos armées. Deux mobiles bien de différents
les y amenaient : l'intérêt, d'une part ; l'amour de notre
pays, de l'autre. Les uns étaient des mercenaires ; les autres
des Français de coeur.
C'est parmi ces derniers qu'il faut ranger les Polonais qui, à
diverses époques, combattirent pour la France.
Avant la Révolution, nos rois ne voulaient, pour constituer les
corps d'élite chargés de veiller sur leur sécurité,
que des soldats étrangers : Suisses, Écossais, irlandais,
Allemands, etc. Ils estimaient
qu'un soldat étranger en valait trois : c'était un soldat
de moins pour l'ennemi, un de plus dans les rangs de l'armée
française : enfin, c'était un Français qu'on pouvait
laisser à le culture ou à l'industrie
Pour cette triple raison, on ne négligeait rien afin d'attirer
l'étranger : haute paie, uniforme élégant, bel
équipement, service agréable, tels étaient les
avantages qu'on réservait aux mercenaires venus des pays pour
s'engager en France.
Les Suisses ont servi chez nous, sans interruption, depuis la fin du
XVe siècle jusqu'à la Révolution.
A début du XVIIIe siècle, des régiments irlandais
entrèrent au service de la France.
Quant aux Allemands, c'est a partir du règne de François
1er qu'ils formèrent ces régiments de reîtres et
de lansquenets dont les croquis de Callot nous ont conservé le
souvenir.
Ces soldats étaient recrutés en Allemagne par les soins
d'officiers français qui tenaient marché d'hommes, de
préférence dans les cercles de Franconie et de Souabe.Plus
tard, les ministres de la guerre traitaient avec les petits souverains
allemands ; électeurs de Bavière et de Trèves,
duc des Deux-Ponts, duc de Nassau, de Brunswick, et autres principicules
à court d'argent qui vivaient de la traite de leurs sujets.
La Révolution, loin de chasser l'étranger les armées
françaises s'efforça au contraire, de l'y attirer. Lisez
le livre d'Arthur Chuquet sur la Légion germanique,
vous verrez qu'en 1792, dès que la France eût déclaré
la guerre à l'Autriche, les ministres, les représentants
du peuple proposèrent a l'envie d'organiser des légions
étrangères et, comme disait l'un d'eux, « de faire
des levées aux dépens des autres puissances ».
Ce n'étaient plus alors des mercenaires qu'il s'agissait d'amener
en France, c'étaient des volontaires, des soldats de la Liberté.
Et leur origine n'importait guère. On ne leur demandait pas d'où
ils venaient. La France, qui s'armait contre les tyrans, regardait tous
les peuples connue des alliés naturels : les Français
voyaient, dans tout ennemi de l'oppression, un concitoyen et un frère.
Le 8 juillet 1797, Brissot, dans un discours à l'Assemblée
législative, s'écriait : « La France s'honorera
toujours de recevoir ceux qui viendront se ranger sous ses drapeaux,
et, quelle que soit leur patrie, ils ne seront jamais étrangers
pour elle. »
Le premier corps étranger qui se créa fut la Légion
des Belges et Liégeois. Une Légion Batave fut constituée
ensuite, composée de Hollandais et de Brabançons.
Puis vint la Légion des Allobroges, composée de Savoisiens,
de Piémontais et d'habitants du Valais.
Enfin, sur l'initiative d'Anacharsis Cloots, fut créée
la Légion Germanique. Ce corps ne servit que dans la guerre contre
les royalistes en Vendée. Cette légion de Boche n'inspirait
qu'une confiance limitée au gouvernement révolutionnaire.
***
Les premières légions polonaises ne devaient se former
que trois ans plus tard. Les insurrections polonaises de 1792 et de
1794 avaient échoué ; le troisième partage de la
Pologne s'accomplissait. L'armée polonaise ne voulut pas servir
ses vainqueurs.En masse, chefs et soldats émigrèrent vers
la France, patrie de la liberté - de cette liberté que
les Polonais n'avaient pu conquérir pour leur propre pays.
Du moins, là, disaient-ils, nous ne vivrons pas en esclavage.
Dombrowski fut le premier chef polonais qui vint offrir sort épée
à la France. C'était un des plus illustres généraux
qu'eût produits la Pologne. En 1792, il s'était distingué
dans la guerre de l'indépendance. Il fut nommé général
de division peu de temps avant la prise de Varsovie par les Russes.
Fait prisonnier, il fut amené à Souvarow, qui le reçut
avec distinction et le pressa vainement de prendre du service en Russie.
Dombrowski préféra venir en France apporter à Bonaparte,
dont la gloire commençait à rayonner sur le monde, le
concours de ses talents militaires.
La Constitution de l'an III avait supprimé les régiments
étrangers et interdit leur emploi dans l'armée française.
Le Directoire tourna la difficulté en acceptant le concours de
Dombrowski, non pour la France, mais pour la République cisalpine
que Bonaparte venait de constituer.
C'est donc à Milan que Dombrowski organisa la première
légion polonaise.
A la tête de ces admirables soldats, aguerris par quatre ans de
combats en Pologne, il combattit à Reggio, prit une part active
à la campagne de Naples, fit des prodiges à la Trebbia,
où il reçut, en pleine poitrine, une balle qui l'eût
infailliblement tué, si elle ne se fût aplatie sur un exemplaire
de l'Histoire de la Guerre de Trente Ans, de Schiller, qu'il
avait toujours dans sa poche.
En 1806, Dombrowski et ses Polonais prirent part à la campagne
de Prusse avec Napoléon. Le général entra en Pologne
et seconda Poniatowski pour la délivrance de leur patrie commune.
Le rôle de Dombrowski ne fut pas moins glorieux pendant la campagne
de Russie. C'est lui qui livra la bataille de Borissow et tint en échec
l'ennemi pour permettre à l'armée de passer la Bérésina.
Après Leipzig, il prit le commandement général
des troupes polonaises à la place de Poniatowski et se battit
à leur tête pendant la campagne de France. Il ramena ensuite
ses soldats dans leur patrie, sur la promesse, que lui avait faite le
tsar Alexandre, de rendre la liberté à la Pologne.
Mais, cette promesse, le tsar ne la tint pas. Et Dombrowski, écoeuré,
se retira et alla finir sa vie dans ses terres, loin des luttes de la
guerre et de la politique.
***
Kniaziewicz, l'un des chefs las plus valeureux des légions polonaises
au Service de la France, avait, lui aussi, combattu pour l'indépendance
de son pays en 1794.
La Pologne vaincue, il partit pour la France refuge de tous les amants
déçus de la liberté et entra, en 1798, dans les
légions de Dombrowski. Il fit la campagne de Naples sous Championnet
, se conduisit de la façon la plus brillante à Magliano,
à Terni, fit capituler Gaëte par un coup d'audace, Pour
le remercier des services rendus à la France, Championnet le
chargea d'apporter à Paris trente-cinq drapeaux pris à
l'ennemi.
Dubois-Crancé en le présentant aux membres du Directoire,
disait :
« C'est l'un de ces Étrangers qui ne le ont pas pour nous.
L'honneur de vous offrir ces trophées militaires est le pris
de ses vertus guerrières et de ses services. »
Sur le Rhin, en 1800, Kniaziewicz, à la tête d'une nouvelle
légion polonaise, se distingua encore et fut un des artisans
de la victoire de Hohenlinden.
Mais après les pourparlers de Lunéville, le général,
découragé et indigné à la pensée
que sa patrie ne serait pas encore libérée, donna sa démission
et retourna en Pologne, où il vécut dans la retraite jusqu'en
1812.
A cette époque, il se laissa de nouveau entraîner dans
la grande épopée et accepta le commandement d'une division
de la Grande-Armée. Il se battit à la Moskova et fut blessé
grièvement à la Bérésina, où il commandait
en chef le contingent polonais.
***
Mais la plus grande figure de la Pologne aux temps héroïque
des guerres napoléonniennes, c'est celle du prince Joseph Poniatowski,
celui que sa bravoure fit appeler le Bayard polonais.
Poniatowski avait fait ses premières armes dans l'armée
autrichienne, puis il avait pris part à la guerre de l'indépendance
contre les Russes en 1792.
Dans l'insurrection de 1794, il s'enrôla comme simple volontaire
sous les drapeaux de Kosciusko, mais bientôt il reçut le
commandement d'une division, et il rendit les plus grands services pendant
les deux sièges de Varsovie.
Après l'issue désastreuse de cette lutte, Poniatowski
se retira à Vienne.
Quand les Français, après Iéna, envahirent la Pologne,
Poniatowski se vit offrir le gouvernement de Varsovie par le roi de
Prusse : mais, suivant l'impulsion générale de la nation
polonaise, il embrassa le parti des Français, organisa rapidement
une armée polonaise et servit fidèlement, depuis lors,
la cause française, qui se confondait, dans son esprit et dans
son coeur, avec celle de sa patrie.
En 1809, il se couvrit de gloire en défendant Varsovie, avec
une poignée d'hommes contre l'armée de l'archiduc Ferdinand
d'Autriche. Le traité de Vienne n'avait pas rendu la liberté
à la Pologne. Cependant, Poniatowski et ses compagnons restèrent
fidèles à Napoléon. Ils espéraient toujours
et supportaient tout.
C'est ainsi que, lorsque éclata la guerre avec la Russie en 1812,
Poniatowski offrit à l'empereur une armée de cent mille
hommes. Il lui offrit quelque chose de plus précieux encore,
peut-être : les conseils de son expérience pour la conduite
de la guerre dans un pays que nul ne connaissait mieux que lui. L'empereur,
aveuglé par son orgueil, accepta les hommes et repoussa les conseils.
Poniatowski ne se conduisit pas moins de la façon la plus glorieuse
pendant toute la campagne. Il se signala à Smolensk, à
la Moskova, à Borodino, entra l'un des premiers à Moscou.
Pendant la retraite, il fut blessé grièvement. Guéri,
il rejoignit Napoléon avec un corps de de Polonais fidèles.
A Leipzig, son héroïsme le fit nommer maréchal de
France sur le champ de bataille.
C'était le couronnement de sa gloire militaire. Mais, à
ceux qui l'en félicitaient, il répondit :
« Je suis fier seulement d'être le chef des Polonais. Quand
on a le titre unique, et supérieur au maréchalat, celui
de généralissime des Polonais, tout autre ne saurait compter.
D'ailleurs, ma mort approche je vais mourir comme général
polonais, et non comme maréchal de France. »
Le pressentiment du grand soldat n'était que trop exact. Trois
jours après, chargé de protéger la retraite, et
n'avant avec lui qu'un petit nombre de soldats, il contint les colonnes
ennemies jusque sur les bords de l'Elster. Là, pressé
par les forces supérieures, ne pouvant traverser le fleuve, dont
les Français avaient détruit les ponts, couvert de blessures,
il refusa néanmoins de se rendre, poussa, son cheval dans le
fleuve et Essaya de le traverser à la nage. Mais emporté
par le courant, il se nova.
Son corps, retrouvé quelques jours plus tard, fut inhumé
à Cracovie, près de celui de Kosciusko.
On se rappelle l'admirable chanson qu'inspira à Béranger
la fin du Bayard polonais, et le cri impressionnant que le poète
mit dans la bouche de Poniatowski mourant :
« Rien qu'une main, Français, je suis sauvé ! »
Ce cri qui s'élève encore, dit le poète, alors que le guerrier a roulé au fond des eaux, qui donc le pousse ?...
C'est la Pologne et son peuple fidèle
Oui, tant de fois, a pour nous combattu.
Elle se noie la sang qui coule d'elle,
Sang qui s'épuise en gardant sa vertu.
Comme ce chef mort pour notre patrie,
Corps en lambeaux dans l'Elster retrouvé.
Au bord du gouffre un peuple entier nous crie:
« Rien qu'une main, Français, je suis sauvé ! »
***
Cette mai, les Polonais sont assurés de la trouver cette fois.
Ils en trouveront même plus d'une ; ils trouveront toutes les
mains unies des peuples alliés contre leurs tyrans.
Mais ils ont voulu combattre avec nous, avec nos alliés non point
seulement pour leur propre liberté, mais pour la liberté
du inonde.
C'est ainsi qu'ils ont demandé à constituer une légion
polonaise comme aux temps glorieux de Dombrowski et de Kniaziewicz.
Et c'est, en France, comme il y a cent vingt ans, que cette légion
s'est créée.
N'est-ce pas surtout aux Polonais que s'applique le mot Célèbre
: « Tout homme a deux patries, la sienne et la France. »
Je n'ai parlé que des principaux chefs des légions polonaises
d'autrefois. Mais combien d'autres se sacrifièrent pour notre
pays. La Grande-Armée, en 1812, ne comptait pas moins de 80 bataillons
et de 76 escadrons polonais
Le chef de la députation polonaise présentée alors
à Napoléon lui disait :
« ...Votre Majesté travaille pour la postérité
et pour l'Histoire. Si l'Europe ne peut méconnaître nos
droits, elle peut encore bien moins méconnaître nos devoirs.
Nation libre et indépendante depuis les temps les plus reculés,
nous n'avons perdu notre territoire et notre indépendance ni
par des traité, ni par des conquêtes, mais par la perfidie
et la trahison. La trahison n'a jamais constitué des droits...
Nous sommes seize millions de Polonais, parmi lesquels il n'y en a pas
un dont le sang, les bras, la fortune ne soient dénoués
à Votre Majesté. Chaque sacrifice nous paraîtra
léger s'il a pour effet le rétablissement de notre pays
natal, de la Dvina au Dniester, du Borysthène à l'Oder.
L'intérêt de Votre Majesté demande le rétablissement
de la Pologne et certes, l'honneur de la France y est également
intéressé... Depuis trois siècles, la Pologne,
dans ses malheurs, a toujours tourné les yeux vers la. France.»
Et la Pologne resta, fidèle à la France vaincue comme
à la France victorieuse.
En 1814, lorsque tout fut perdu, les Polonais demeurèrent inébranlables
dans leur attachement à notre pays et en donnèrent des
preuves éclatantes sur le théâtre même des
grandes opérations actuelles. Dans la forêt de la Fère
et près des sources de l'Ourcq, leurs cavaliers infligèrent
des échecs sérieux aux Prussiens. Devant Berry-au-Bac,
les lanciers polonais, formant l'avant-garde du général
de Nansouty, se couvrirent de gloire. Ensuite , poursuivant l'adversaire
qui s'était retiré au delà de la Miette et cherchait
à se reformer dans la plaine située entre la Ville-aux-Bois
et, Juvincourt, ils le défirent totalement. Le général
Dautancourt écrit à se sujet, dans son Journal des
campagnes, de 1813 et 1814 : « Chargé à
nouveau par les lanciers du brave Skarzynski et voyant toute la division
prête à fondre sur lui, l'ennemi fut mis dans une déroute
si complète que je ne crois pas qu'on ait jamais vu de cavalerie
fuir avec un abandon aussi désespéré... »
Ce sont des Polonais qui, dans la défense de Paris, en 1814,
tirèrent, des hauteurs de Montmartre, les derniers coups de canon
contre les Russes du compte de Langeron.
Jamais la France ne s'est battues sans que les Polonais soient à
ses côtés. En 1870, ils étaient à Châteaudun
avec Lipowski, à Dijon avec Bossak-Hauke.
Dès le début de cette guerre, ils étaient nombreux
dans nos corps étrangers. Ils vont être plus nombreux encore
dans l'armée que commandera le général Archtinard.
Tant d'héroïsme et de fidélité doivent trouver
enfin leur récompense. « La constitution d'une armée
polonaise, disait récemment, dans le Petit Journal,
notre éminent directeur, M. Stéphen Pichon, est la première
consécration officielle donnée à l'indépendance
de la Pologne. »
Cette indépendance, ce sera l'honneur de la France d'avoir concouru
à l'assurer à ses frères fidèles, à
ces Polonais qui se disent avec fierté les « Français
du Nord ».
Ernest Laut
Le Petit Journal illustré du 21 octobre 1917