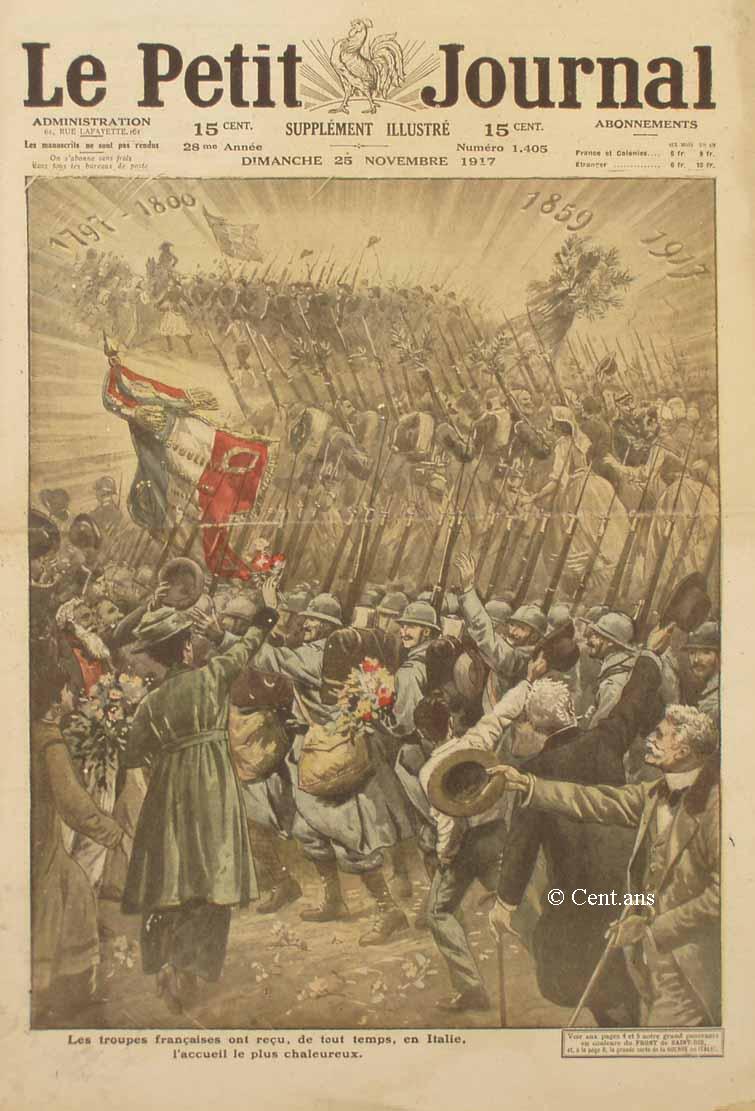LES FRANÇAIS EN ITALIE
VARIÉTÉ
LES FRANÇAIS EN ITALIE
Jadis : Bayard à Brescia. - Naguère : les campagnes de Bonaparte. - La guerre de 1859. - Les poilus d'aujourd'hui retrouveront en Italie la poussière de leurs aïeux et la trace de leurs vertus.
Un refrain de la Fille du tambour-major, l'entraînante opérette d'Offenbach, chante dans autre mémoire :
Petit Français, brave Français,
Viens délivrer notre patrie,
Tu seras bien reçu, tu sais,
Par les enfants de l'Italie.
Il est rare, en effet, qu'au cours des siècles,
les Français aient été mal reçus par les
enfants de l'Italie. Car, presque toujours, lorsqu'ils allèrent
chez eux, ce fut pour les aider à secouer le joug étranger
et pour leur porter la liberté.
Même au temps des grandes guerres du XVe et du XVIe siècles,
Quand les Français à tête
folle
S'en allèrent en Italie...
Comme disait plus tard une épigramme
de Voltaire, ils n'y portèrent point la destruction et le pillage.
Les soldats de Charles VIII, de Louis XII et de François 1er
étaient des guerriers français. Même en pays ennemi,
ils respectaient le droit des gens.
A propos de Brescia, où nos poilus défilaient ces jours
derniers, on a évoqué le souvenir de Bavard, le chevalier
sans peur et sans reproche.
C'est à Brescia qu'en 1512 Bayard fut blessé, au cours
de l'assaut victorieux que les troupes de Gaston de Foix donnèrent.
contre la ville que les Vénitiens occupaient.
On le transporta dans la demeure d'une dame noble qui vivait avec ses
deux filles, et qui éprouva un grand saisissement à la
pensée qu'on allait peut-être piller sa maison.
Bayard, quoiqu'atteint grièvement et pouvant parler à
peine, s'efforça de la tranquilliser :
« Madame, lui dit-il, croyez qu'il ne vous sera fait aucun déplaisir,
vous avez céans un gentilhomme qui ne vous pillera pas, mais
vous fera toute courtoisie. »
Quelques semaines après, au moment où le chevalier guéri
vint prendre congé de son hôtesse, celle-ci, en témoignage
de reconnaissances, lui remit un coffret contenant 2.500 ducats. Bayard,
qui « oncques ne fist cas d'argent » les accepta d'une main,
mais pour les offrir de l'autre aux jeunes filles de son hôtesse.
« Les gens de guerre, leur dit-il, ne sont pas riches mais voici
votre mère qui m'a donné deux mille cinq cents ducats.
Je vous en donne mille à chacune pour vous aider à vous
marier. Vous prierez Dieu pour moi, autre chose ne vous demande. »
Et, ayant laissé le reste de la somme pour les pauvres, il s'en
fut rejoindre ses soldats..
Voilà comment agissait, en pays conquis, l'homme qui était
le modèle de l'armée. Comment l'armée elle-même
se fût-elle livrée aux exactions alors que ses chefs lui
donnaient de tels exemples ?
Par contre, les Italiens de ce temps-là purent, à maintes
reprise, faire la différence entre les troupes françaises
et les aventuriers, les reîtres d'Allemagne que Charles-Quint
envoyait contre elles en Italie.
Pendant des siècles, Rome a gardé l'effroyable souvenir
des « bandes noires » de Georges Frundsberg et de Philibert
d'Orange qui, ayant pris la ville le 6 mai 1527, la livrèrent
pendant huit jours et huit nuits, au massacre et au pillage. Les lansquenets
allemands firent un terrible carnage des habitants, brûlèrent
les églises, jetèrent les reliques au vent, transformèrent
en écurie la chapelle Sixtine, donnèrent les bulles papales
en litière à leurs chevaux et profanèrent jusqu'aux
tombeaux des pontifes. Des prêtres furent brûlés
vifs, d'autres assommés, d'autres écorchés vivants.
Le pape Clément VII fut emprisonné au château Saint-Ange.
Et, pendant que toutes ces horreurs s'accomplissaient, l'hypocrite Charles-Quint,
qui avait déchaîné ces hordes de barbares sur la
Ville Éternelle, Charles-Quint, affectant de n'être pas
maître des bandes qui agissaient en son nom et par son ordre,
faisait dire des messes, en Espagne, pour la délivrance du pontife.
Les Boches du XVIe siècle étaient, vous le voyez, les
dignes précurseurs des Boches du XXe ; et l'empereur autrichien
d'alors valait l'empereur allemand d'aujourd'hui, pour la félonie,
la traîtrise et la cruauté.
***
Ces régions de la Vénétie
et de la Lombardie, où nos soldats accourent aujourd'hui à
l'appel de la nation soeur, furent naguère le théâtre
des actions militaires qui comptent parmi les plus glorieuses de notre
histoire. Que de noms de villes et de villages de ce pays, illustrés
par le génie de Bonaparte et par les talents militaires de ses
lieutenants, survivent dans nos familles françaises. Duroc y
conquit le titre de duc de Frioul ; Mortier, celui de duc de Trévise
; Augereau, celui de que de Castiglione ; Victor, celui de duc de Bellune
; Moncey, celui de duc de Conegliano ; Lannes, celui de duc de Montebello
; Clarke, celui de duc de Feltre, Masséna, avant d'être
prince d'Essling, fut duc de Rivoli.
Ces rivières, dont les noms réapparaissent aujourd'hui
dans les communiqués, virent alors passer les Français
qui marchaient victorieux sur l'Autriche. Au mois de mars 1797, les
soldats de Bonaparte livrèrent sur la Piave et sur le Tagliamento
des combats glorieux.
Et nos soldats étaient accueillis en frères par la population.
L'hôte préférait entretenir la troupe française
que de subir la rapacité autrichienne. L'historien Edouard Gachot,
dans son livre sur la Première campagne d'Italie, écrit
:
« Dans ces pays pressurés, parfois dévastés,
on trouvait des hommes épris d'admiration pour les héros
de Rivoli ; des hommes aux larges initiatives qui voulaient secouer
le joug des vieux gouvernements autoritaires. »
Et ces hommes accueillaient nos soldats en libérateurs.
Les troupes françaises, d'ailleurs, se gardaient de tout excès
; et les chefs s'empressaient dès leur entrée dans les
villes de donner confiance aux populations. Lorsqu'au mois de mai 1796,
Masséna arriva à Milan, il trouva aux portes de la ville
une députation composée des administrateurs municipaux
et du représentant de l'archevêque. Tous, dit M. Gachot,
semblaient alarmés et priaient le général de ne
pas traiter Milan en ville conquise.
Masséna leur répondit :
« La République fait la guerre aux
rois et non aux peuples : le culte sera libre et vos propriétés
seront sous la sauvegarde française. »
De telles déclarations, confirmées par la discipline imposée
aux troupes, rassuraient bien vite les habitants et valaient sympathie
et confiance à nos soldats.
Lors de la seconde campagne d'Italie, en 1800, Bonaparte dans sa proclamation
au peuple cisalpin disait :
« Le peuple français, pour la seconde
fois, brise vos chaînes... » Cependant, à sa première
entrée dans Milan, la population, craignant le retour possible
des Autrichiens, n'avait pas osé manifester sa joie de la délivrance.
Mais peu de jours après l'occupation française, la confiance
grandissait, toute crainte était bannie. Un soir que Bonaparte
se trouvait au théâtre de la Scala, une manifestation éclatait
en son honneur : « Vive le libérateur de l'Italie ! »
criait-on. Après le spectacle, des citoyens voulaient dételer
les chevaux de sa voiture et la traîner.
Et, quand il y revint encore, après Marengo, accompagné
de Lannes et de Murat, et escorté par les chasseurs de sa garde,
ce fut une véritable explosion d'enthousiasme. Le peuple criait
« Victoire ! » et « Vive le consul », et jetait
des fleurs au-devant de lui.
Les Autrichiens étaient loin ; et les Français avaient
conquis tous les coeurs.
***
En 1859, lors de la guerre qui donna l'unité et la liberté
à l'Italie, la fraternité franco-italienne se manifesta
plus ardemment encore.
Cette campagne de 1859, campagne de deux mois, véritable marche
triomphale, nous pouvons d'autant mieux en évoquer le souvenir,
qu'elle fut, par excellence une épopée française,
une guerre populaire acceptée avec enthousiasme, menée
avec entrain.
Nos soldats la firent en chantant et en se jouant. « Jamais, disait
un historien italien, on ne vit des hommes aller au feu avec autant
de belle humeur. »
A Gênes, quand les troupes françaises débarquèrent,
tout le monde était animé d'une véritable fièvre
patriotique. Les régiments de zouaves, de turcos, de chasseurs
et d'infanterie de ligne défilaient sur un tapis de fleurs que
les dames italiennes leur jetaient du haut des balcons. Les turcos et
les zouaves étaient surtout les héros de la fête.
Les premiers campaient aux portes de la ville dans un bois de myrtes
et de citronniers. Ils étaient l'objet de la curiosité
générale. On allait leur rendre visite et on les comblait
d'oranges, qu'ils entassaient en piles énormes devant leurs tentes.
Les soldats de tous les régiments traversant la ville avaient
des bouquets au canon de leur fusil.
Evviva la guerra ! criait-on partout sur leur passage.
La campagne s'ouvrit par le mauvais temps, mais l'entrain des troupes
n'en fut pas diminué.
« La gaité est à l'ordre du jour, écrivait
le correspondant d'un journal parisien. Nous avons fait dix-huit lieues
par un véritable déluge. Toutes les cataractes du ciel
étaient ouvertes ; nos soldats avaient de l'eau jusqu'à
mi-jambe, et ils n'ont pas un seul instant cessé de chanter et
de rire. Notez qu'ils portent soixante livres pesant, sans compter la
clarinette, comme ils disent. Les chemins étaient semés
de fondrières ; chaque homme a littéralement couché
deux nuits dans l'eau : rien n'y a fait. Pas un murmure, pas une plainte...
»*
On chantait... On chantait la Piémontaise :
Salut aux héros de la France !
Salut aux soutiens de l'honneur !...
On célébrait les vins du pays ami :
Vive le vin d'Asti !
Ah ! sapristi !
Qui vous rend le nez cramoisi.
Et chaque arme avait sa chanson qui résonnait
le long des routes : le chant des Turcos, rimé en l'honneur
de Bourbaki ; celui des Chacals ou des Lascars ; celui
des Chasseurs de Vincennes. Les zouaves avaient reconstitué
leur théâtre de Crimée et jouaient des vaudevilles,
des drames et des opérettes.
Héroïsme et gaîté, ces deux vertus bien françaises
ne se manifestèrent jamais de façon plus éclatante
qu'en ce temps-là.
L'arrivée des Français avait alors, comme aujourd'hui,
en Italie, répandu la confiance et l'espoir de toutes parts.
« Une chose frappa tout le monde ici, disait une correspondance
de Turin, c'est la complète sécurité des Piémontais,
à quelques kilomètres seulement de l'armée d'invasion
des Autrichiens. Comme quelqu'un faisait remarquer cette sécurité
à plusieurs personnes, une dame répondit :
« - C'est tout naturel, les Français
sont là ! »
A Gênes, le roi Victor-Emmanuel s'extasiait devant la beauté,
l'air martial de nos soldats, et il s'étonnait de leur admirable
discipline collective jointe à leur irrésistible élan
individuel.
- L'armée française, lui répondit Napoléon
III, c'est le patriotisme organisé,
La définition n'est-elle pas exacte aujourd'hui comme alors ?
L'entrée des Français à Milan, après la
victoire de Magenta, renouvela le bel enthousiasme des Milanais accueillant,
cinquante-neuf ans auparavant, les glorieuses phalanges du premier Consul.
« Toutes les fenêtres et même les toits étaient
garnis de monde, dit un compte-rendu. Dans la rue Cusani, un citoyen,
qui tenait dans ses bras un charmant enfant, au moment où passait
le maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, l'éleva à
la hauteur du maréchal, auquel l'enfant offrit une couronne de
fleurs. Le duc, ému, prit cet enfant et l'ambrassa. La foule
éclata en applaudissements frénétiques. »
« Figurez-vous, écrivait le chroniqueur Amédée
Achard, correspondant de guerre d'un journal de Paris, figurez-vous
quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue, un délire pour
lequel le dictionnaire français ne fournit point de mots. Multipliez
l'ivresse par l'enthousiasme, ajoutez la frénésie à
l'exaltation et vous aurez à peu près une idée,
du spectacle que présentait Milan. Ce n'était plus une
ville, c'était un volcan... »
Mais ce délire populaire n'excluait pas les grâces les
plus délicates. On donnait comme logements aux officiers les
plus beaux palais ; on leur offrait des repas exquis. Canrobert demande
à voir les plantons qu'on a mis à sa disposition : ce
sont les membres de la plus haute aristocratie milanaise.
Quant aux Milanaises, elles rivalisaient de charmes pour les Français.
Un officier de zouaves raconte : « Les femmes s'approchent de
nous pour nous mettre à la boutonnière la plus belle fleur
de leurs bouquets. »
Galliffet, alors lieutenant, écrit à un de ses amis :
« Chaque Milanaise veut embrasser un libérateur. »
***
Rien n'est nouveau sous le soleil : l'histoire se recommence sans cesse.
Brescia, la cité héroïque, a vu, en 1512, passer
les soldats de Bayard ; en 1797, les chasseurs d'Augereau et de Sérurier
; en 1859, la garde impériale a bivouaqué sur ses remparts.
Ces jours derniers, elle voyait défiler dans ses rues, alertes,
non moins glorieux que leurs devanciers, les poilus de la grande guerre.
En 1859, au passage des zouaves, on évoquait les anecdotes héroïques
de Crimée ; on évoque en ce moment les mille traits de
courage accomplis par nos soldats depuis trois ans ; et ce sont les
noms de Verdun, de la Somme, de l'Yser, qui sont là-bas sur toutes
les lèvres, comme naguère les noms de Sébastopol,
d'Inkermann et du Mamelon Vert.
On saluait au passage tels drapeaux déchirés par les balles.
Combien de ces loques sublimes, lacérées par les balles
allemandes, pourront recevoir le même hommage du peuple italien.
Après les guerriers bardés de fer du temps de Charles
VIII et de Louis XII, après les Républicains aux «
habits bleus par la victoire usés », après les soldats
au pantalon garance, voici les poilus vêtus de bleu horizon. Et
ce sont toujours les mêmes soldats, les mêmes Français,
empressés à venir au secours des opprimés, prompts
à verser leur sang pour la liberté des peuples et pour
la cause du droit.
Ils vont retrouver en Italie, pour employer l'admirable expression de
la Marseillaise, avec la poussière de leurs aînés,
la trace de leurs vertus ; et inscrire dans l'histoire, à côté
des noms de Marignan, de Rivoli, de Marengo, de Magenta et de Solférino,
d'autres noms également glorieux.
Ernest Laut.
Le Petit Journal illustré du 25 novembre 1917