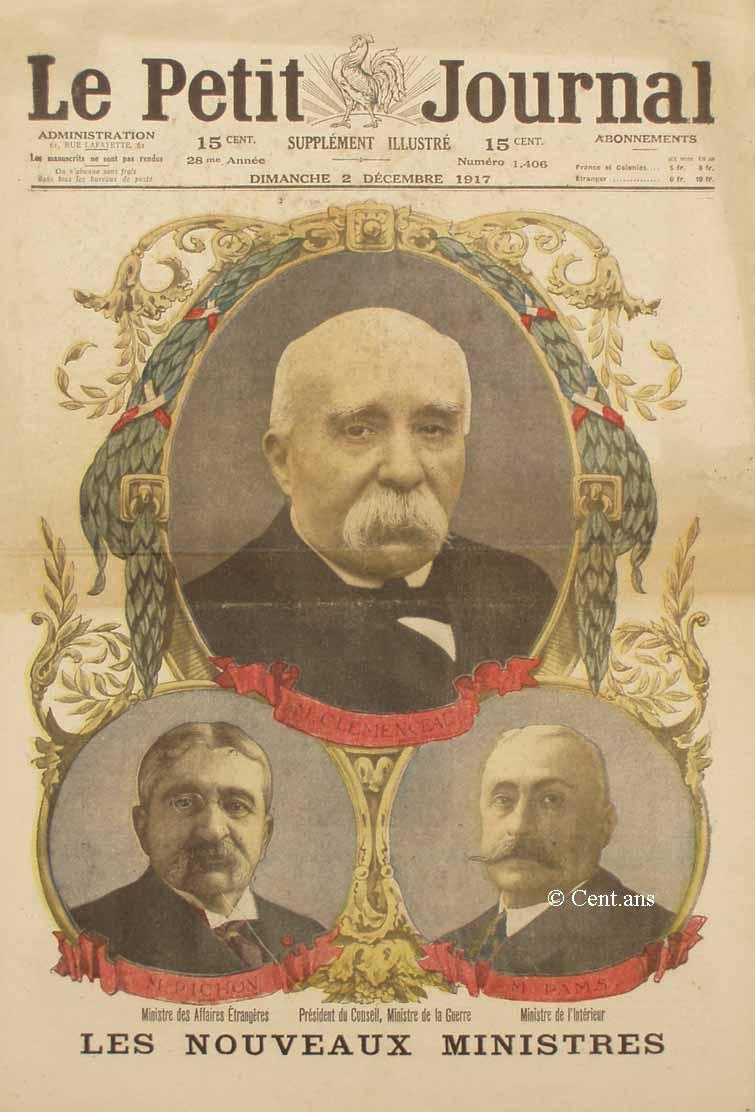NOS PORTRAITS
M. CLEMENCEAU
Président du Conseil et ministre de la Guerre
M. Georges Clemenceau est né à
Mouilleron-en-Pareds (Vendée), le 28 septembre1841. Nous donnons
plus loin une vue de sa maison natale. Il vint à Paris en 1865
pour y faire sa médecine. Reçu docteur en 1869, il s'établit
dans le 18e arrondissement dont, à la chute de l'Empire, il devint
maire. En 1871, il siégea à l'Assemblée nationale
comme représentant de la Seine. Conseiller municipal de Paris,
il devint en 1875 président de l'Assemblée communale.
Il fut de 1875 à 1885 député de la Seine et de
1885 à 1893 député du Var.
Journaliste, sa vigueur et sa verve le placèrent au premier rang
de nos écrivains politiques. En 1902, il rentra au Parlement
comme sénateur du Var ; et, en 1906, il fit partie du cabinet
Sarrien (24 mars) comme ministre de l'Intérieur. Le 26 octobre
1906, il recueillait comme président du Conseil la succession
de M. Sarrien : il resta au pouvoir jusqu'au 20 juillet 1909.
A la fin de 1915, M. Clemenceau fut appelé à la présidence
de la commission de l'armée et, à la commission des affaires
extérieures du Sénat.
M. Clemenceau est l'auteur de plusieurs ouvrages. De la génération
des éléments anatomiques, le seul livre qu'il ait
écrit en sa qualité de médecin ; la Mêlée
sociale, le Grand Pan, recueils d'articles sur des sujets
d'ordre politique : Les plus forts, roman , des nouvelles littéraires,
parmi lesquelles le Bouvreuil et le Sabotier, un petit chef-d'oeuvre
que nos lecteurs trouveront dans l'Almanach du Petit Journal de
1918.
Tout le monde sait que, dans les heures angoissantes que nous traversons,
M. Clemenceau a toujours témoigné d'un patriotisme absolu,
intransigeant et qu'il n'a qu'une préoccupation ; la guerre,
et qu'un but : La victoire.
M. Stéphen PICHON
Ministre des Affaires étrangères
Il est inutile de présenter M. Pichon
à nos lecteurs, qui, depuis près de quatre ans, ont eu
l'occasion d'apprécier, à côté de son talent
d'écrivain, sa compétence particulière dans les
questions extérieures.
Si l'on l'on veut se rappeler ce qu'il a écrit, à propos
des Japonais, des sentiments réels des Bulgares à notre
égard, de la politique à suivre en Orient, en Russie,
ou dans les autres parties du monde au fur et à mesure que se
déroulaient les événements, on pensera avec nous
que nul de nos compatriotes n'a vu comme lui les dangers qui nous menaçaient,
les pièges qui nous étaient tendus, et l'on doit regretter
que ses conseils, toujours formulés avec la réserve d'un
homme qui sait les difficultés, n'aient pas été
mieux suivis. Notre politique extérieure, sera en bonnes mains.
M. Pichon est né à Arnay-le-Duc (Côte-d'Or), le
10 août 1857.
En 1880, il est l'un des collaborateurs de M. Clemenceau à la
Justice. Dès 1883, il est élu conseiller municipal
de Paris et en 1885 il est élu député de la Seine.
Ensuite, M. Stephen Pichon fut nommé ministre plénipotentiaire
à Port-au-Prince, Saint-Domingue, à Rio-de-Janeiro, à
Pékin : il occupait ce dernier poste lors de la fameuse révolte
des Boxers.
Revenu dans la métropole, M. Stéphen Pichon ne tardait
pas à être envoyé à Tunis comme résident
général (1901).
Devenu sénateur du Jura, il fit partie du ministère Clemenceau
le 25 octobre 1906, avec le portefeuille des Affaires étrangères,
portefeuille qu'il conserva également dans les deux cabinets
Briand, d'abord du 24 juillet 1909 an 30 octobre 1910, puis du 3 novembre
de la même année au 27 février 1911 et en 1913,
dans le cabinet Barthou.
M. Stéphen Pichon poursuit auprès de M. Clemenceau au
ministère une collaboration qui, remonte à prés
de quarante ans. Cette longue intimité n'est-elle pas à
l'honneur de l'un et de l'autre
M.PAMS
Ministre de l'Intérieur
M. Jules Pams, d'abord avocat, propriétaire terrien, puis industriel, est né le 14 août 1852 à Perpignan. Il siégeait au conseil général des Pyrénées-Orientales, quand en 1893 il fut élu député par les électeurs de Céret, qui le réélurent, d'une façon ininterrompue ; en 1904, les électeurs sénatoriaux des Pyrénées-Orientales l'envoyèrent au Sénat. De 1911 à 1913, il a fait partie comme ministre de l'Agriculture de cabinets Monis, Caillaux et Poincaré. En 1913, il donne sa démission pour se présenter à la présidence de la République ; il recueillit 327 voix tandis que M. Poincaré en obtenait 429. M. Pams, qui est membre du conseil supérieur des beaux-arts, s'intéresse d'une façon effective aux arts et aux artistes.
VARIÉTÉ
Ministères et ministres
Les plus longs ministères et les plus courts. - Une fantaisie d'Alphonse Karr. - La journée d'un ministre. - Habits et galons. - Le grand ministre.
Nous avons un nouveau ministère.
Ce doit être à peu près le cent cinquantième
depuis la Révolution et, environ, le soixantième depuis
1871. Les ministères ont été terriblement vite
pendant la troisième République.
Livrons-nous au petit jeu ordinaire.
Depuis 1789, quels furent les ministères les plus courts ?
En tête vient celui du 12 juillet 1789, formé après
le renvoi de Necker et qui tomba le 16, gardant le nom de « ministère
des cent heures ».
Un autre cabinet fut dit plus tard « le ministère des trois
jours ». Ce fut le ministère Bassano, formé le 10
novembre 1834 et décédé le 14.
Le 9 janvier 1851 était constitué le ministère
Rouher, Drouyn de Lhuys, général Regnault, de Saint-Jean-d'Angély,
etc.; il tombait le 19.
Le 9 août 1870, le ministère Palikao se formait pour être
emporté par la tourmente le 4 septembre.
Un ministère Dufaure dure sept jours, du 18 au 25 mai 1873.
Mais tout cela n'est rien : nous eûmes plus récemment un
ministère Ribot, qui dura ce que durent les roses : l'espace
d'un matin.
Quant aux ministères les plus longs, si nous nous en tenons seulement
à ceux de la troisième République, nous trouvons
le ministère Waldeck-Rousseau, le ministère Combes, le
ministère Méline et le ministère Clemenceau, qui
durèrent chacun de deux à trois ans.
Trois ans !... C'est un maximum de durée qu'atteignirent rarement
nos ministères.
Cette instabilité ministérielle étonne quelque
peu les gens qui ne connaissent pas nos moeurs politiques. Il y va quelques
années, le sultan du Maroc Moulay-Hafid, apprenant que France
venait encore de changer de ministère, disait en ricanant à
notre consul à Fez
- C'est curieux comme vous changez souvent de grand-vizir, chez vous.
Depuis mon avènement, vous en êtes au quatrième.
alors que, moi, j'ai toujours le même.
Avouez que la réflexion du souverain marocain ne manquait pas
de justesse. Nous changeons vraiment trop souvent de vizirs. Dans la
législature qui précéda la guerre, nous eûmes
sept ministres de l'Intérieur, autant des Affaires étrangères
et huit ministres de la Guerre.
En quatre ans ! ... Tant de changements de personnes, entraînant
chaque fois des modifications dans le personnel, dans les méthodes,
dans la politique, ne font-ils pas préjudiciables à la
bonne marche des affaires du pays ?
Qu'importe ! diront les sceptiques ; les ministres passent, mais les
ministères restent. C'est, en somme, l'administration qui nous
régit, l'administration aux routines immuables, quel que soit
le ministre. Peu nous chaut qu'on nous mette un médecin à
l'agriculture et un avocat à la marine. N'est-il pas entendu
que nous vivons aujourd'hui sous 1e règne de l'incompétence
?
Aujourd'hui, braves gens?... Consolez-vous donc ! Ce n'est pas seulement
d'aujourd'hui que nous vivons sous ce règne.
Laissez-moi vous citer, à ce propos, une jolie fantaisie satirique
d'Alphonse Karr qui, je crois bien, sera éternellement d'actualité.
Il y est question d'un chef d'Etat qui - le ministère avant donné
sa démission - se préoccupe de nommer un nouveau cabinet.
On le voit, livré à de profondes méditations. C'est
qu'il entend donner les portefeuilles aux plus dignes, les aux plus
capables, en même temps qu'aux plus honnêtes et aux plus
dévoués à la patrie.
- Je vais, se dit-il, appeler aux Finances un homme qui, plus que tous
les autres, aura fait, dans le commerce ou l'industrie, une grande fortune,
contre laquelle ne s'est jamais élevée la moindre réclamation.
Et le bon chef d'Etat se flatte, en agissant ainsi, d'imiter le tsar
Pierre le Grand qui, lorsqu'il voulait nommer un maire, se promenait
dans le village, cherchait la maison la mieux tenue, le jardin le mieux
cultivé, et confiait au propriétaire la conduite des affaires
de la commune.
Pour l'instruction publique, le chef d'Etat médite de s'adresser
à un littérateur ou à un philosophe ayant autant
de sagesse que de talent ; pour la Guerre, il se propose de solliciter
le concours de quelque général illustré par de
grandes actions et mûri par l'expérience.
Quant à l'Agriculture, il entend choisir pour la diriger un homme
qui aura conduit un domaine, petit ou grand, dans la voie du progrès
et en aura tiré le meilleur parti.
De même pour les Affaires étrangères : il lui faut
un ministre qui connaisse à fond, non seulement la géographie,
l'étendue, la situation, les forces, les faiblesses, les intérêts
et les prétentions de tous les Etats du monde, mais sache aussi
l'histoire de tous leurs rapports avec la France dans tous les temps...
De même encore pour la Marine, les Travaux publics, le Commerce,
Bref, il veut que chaque département soit gouverné par
l'homme qui y a montré et prouvé le plus d'aptitudes,
de lumières d'activité et de dévouement.
Or, tout en méditant ainsi, le bon chef d'Etat feuillette distraitement
une bible qui se trouve sur la table à portée de sa main.
Et voilà que ses veux tombent sur cette parabole :
« Les arbres, avant voulu élire
un roi, s'adressèrent aux plus utiles d'entre eux. Mais l'olivier
se récusa, occupé qu'il était à faire son
huile. La vigne s'excusa sur le soin de son raisin et de son vin. Enfin,
tous refusèrent. Seule, la ronce accepta, parce que, seule, elle
n'avait rien à faire.»
Et le chef d'Etat, avant lu cela, comprit qu'il ne pourrait pas composer
son ministère comme il l'eût rêvé, et qu'à
défaut des compétences spéciales qu'il eût
voulu réunir, force lui serait de se rabattre sur les hommes
qui ne font que de la politique, c'est-à-dire sur ceux qui, pareils
à la ronce, ne produisent rien.
Le badinage est joli, n'est-il pas vrai ? Mais ce n'est qu'un badinage.
Et injuste, comme toutes les généralisations. Il y a,
certes, parfois, dans les ministères, bien des incompétences
- nous en avons eu, depuis la guerre, trop de preuves, hélas
! Mais il y a des compétences aussi, de hautes valeurs, politiques,
diplomatiques, financières. Et n'avons-nous même pas vu
des hommes abandonner leurs propres affaires, si lucratives, si prospères
fûssent elles, pour se consacrer tout entiers à l'œuvre
du salut national.
***
Etr' ministr', y a pas d'chos' meilleure,
Suivant l'opinion d'bien des gens,
Car, s'il y a de fichus quarts d'heure,
Il y a bien plus d'joyeux moments.
C'est un refrain d'opérette qui dit cela.
Mais ce refrain d'opérette n'a certainement pas été
écrit par un ancien ministre. Il est certain, en effet, que,
dans la fonction ministérielle, il y a beaucoup plus du fichus
quarts d'heure que de joyeux moments.
D'abord vous imaginez vous ce que peut être la journée
d'un ministre ?... Un de nos anciens secrétaires d'État,
humoriste à ses heures, disait naguère que les ministres
étaient, en France, avec les cochers d'omnibus, les citoyens
qui donnaient à leur pays la plus grosse somme de travail.
M. le ministre se lève de bonne heure. Pourtant, il s'est couché
la veille très tard, car il n'a guère que la nuit pour
travailler en paix. Le jour, il appartient à son cabinet, à
son ministère, au Parlement ; mais il ne s'appartient jamais
; il n'appartient jamais à sa famille.
Certes, il ferait volontiers la grasse matinée, mais l'impérieux
devoir l'appelle. Il saute du lit, procède aux soins de sa toilette,
avale son premier déjeuner, puis mande auprès de lui son
secrétaire particulier qui lui apporte sa correspondance personnelle...
des monceaux de lettres, la plupart sollicitant une faveur, c'est-à-dire
une injustice ou un passe-droit.
« Que d'amis, que de parents naissent en une nuit à un
ministre ! » dit La. Bruyère. En effet, les nouveaux ministres
se découvrent, du jour au lendemain, des centaines de vieux camarades,
d'amis très intimes dont ils ont oublié même le
nom, mais qui se rappellent à leur bienveillance. On s'est perdu
de vue, sans doute, mais on s'est tutoyé il y a trente ou trente-cinq
ans... Rappelez-vous, mon cher ministre !... Et le ministre est, bien
obligé de se souvenir : il répond de sa main au vieux
camarade, pour qu'on ne l'accuse pas d'indifférence et d'orgueil.
Cela le mène jusqu'à neuf heures. Déjà son
antichambre regorge de solliciteurs. Électeurs, parlementaires,
fonctionnaires se succèdent dans son cabinet, apportant leurs
réclamations, leurs sollicitations, leurs requêtes. Le
ministre écoute d'une oreille, tandis qu'il prête l'autre
à son chef de cabinet qui l'entretient à mi-voix des affaires
du service et lui demande des signatures.
Dix heures !... M. le ministre est attendit au conseil. Il monte en
voiture et parcourt, pendant le trajet, les feuilles du jour, où,
parfois, les notes désobligeantes ne lui sont pas ménagées.
Il est plus de midi quand le conseil prend fin. M. le ministre n'a pas
longtemps pour déjeuner. Les directeurs de son ministère
sont déjà là, qui lui demandent audience.
Force lui est de s'en rapporter à eux pour toutes les affaires
qui n'engagent pas la politique du cabinet. Ce n'est pas le désir
qui lui manque, bien souvent, de s'occuper des détail administratifs,
de secouer les vieilles routines, mais comment le pourrait-il ?... Comment
pourrait-il lire les lettres, compulser les dossiers ?... L'opposition
le harcèle, les interpellations se multiplient.
Vite, vite ! aujourd'hui, l'ordre du jour appelle l'interpellation Machin...
Le ministère est menacé. Le président du conseil
va poser la question de confiance. Il faut être à la Chambre
de bonne heure. Quelle après-midi !... De trois heures à
sept heures, la séance se déroule au Palais- Bourbon.
On lutte ! Discours, attaque, riposte vote final. Le gouvernement se
tire d'affaire, mais au prix de quels efforts !
M. le ministre revient en hâte de la Chambre. Enfin, il va pouvoir
s'asseoir à la table de famille. Bienheureux quand quelqu'un
de ses proches ne vient pas entraver sa digestion en lui apportant quelque
recommandation ; car un ministre trouve des quémandeurs et des
quémandeuses jusque dans sa propre maison.
Et je passe sur les jours où il y a des déjeuners ou des
dîners officiels, des cérémonies, des inaugurations,
des réceptions, et où il faut prononcer des discours que
le ministre ne peut préparer qu'en prenant
sur les heures de son sommeil.
Voilà comment un ministre passe sa journée. Et quand il
a vécu ainsi tout un jour dans le travail, dans la trépidation,
dans la fièvre, il recommence le lendemain.
Cette existence justifie le mot de lord Rosebery, qui disait :
- Il y a deux plaisirs suprêmes dans la politique : l'un idéal, l'autre réel. L'idéal, quand on reçoit le portefeuille ministériel ; le réel, quand on le passe à son successeur.
***
Savez-vous que nos ministres pourraient porter un superbe costume brodé
sur toutes les coutures, avec chapeau à plumes et l'épée
au côté.
Napoléon qui, bien qu'il fût son propre premier ministre
et s'occupât de toutes choses avec une égale compétence,
trouvait encore le moyen de s'attacher à toutes les questions
de décorum, avait, dès son avènement à l'empire,
fixé le costume que devraient porter ses ministres.
Le Livre du Sacre nous en donne la description. « Habit, manteau
et culotte de velours bleu, brodé d'argent, doublure en soie
blanche, ainsi que les parements du manteau brodés d'argent ;
ceinture de moire brodée et garnie de torsades d'or ; cravate
de dentelles. Epée suspendue à l'écharpe blanche.
Chapeau relevé par devant, orné de plumes blanches. »
Les seules broderies de ce costume revenaient à 1.300 franc,
celles du manteau 2.800 francs
***
La Restauration ne voulut pas être moins
somptueuse que l'Empire dans la tenue de ses ministres.
En 1816, ces dignitaires portaient la tunique et le manteau de cour
en velours bleu avec broderies d'or sur toutes les coutures, la culotte,
les bas et les souliers blancs, le glaive pareil à celui des
maréchaux, le chapeau à la Henri IV surmonté de
plumes blanches sans nombre.
Sous Louis-Philippe, les ministres, en grand apparat, portaient encore
le costume surchargé de broderies.
La Révolution de 1848 supprima le costume des ministres. Le second
Empire le rétablit. Il se composait d'un « habit de drap
bleu national à neuf boutons dorés à l'aigle, brodé
au collet, parements, poitrine, écusson de taille, bouquets de
poche, baguette et bord courant. Gilet blanc à 5 boutons. Pantalon
de casimir blanc avec galon sur la couture. Bottines vernies. Chapeau
feutre noir orné d'une ganse brodée en or sur velours
noir ; plumes blanches. Epée dorée à poignée
de nacre.
Tel est le costume que nos ministres pourraient porter, car le décret
qui le fixait n'a jamais été abrogé. Il est seulement
tombé en désuétude sous la troisième République.
La République n'a pas que supprimé en fait la belle tenue
des ministres ; elle a encore simplifié leur portefeuille.
Celui-ci, sous l'Empire, était en maroquin, rouge, orné
de dorures au petit fer. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une simple serviette
avocat en cuir chagriné à petits grains, l'intérieur
divisé en plusieurs compartiments, fermoir d'acier avec clef
minuscule qui suffit pour tenir clos les plus grands secrets de l'État.
Chaque changement de gouvernement implique une fourniture nouvelle chaque
ministre tombé ayant le droit d'emporter, dans sa chute, à
titre de souvenir - souvenirs et regrets ! - la précieuse serviette.
Quant au traitement des ministres, il a varié suivant les régimes.
Il était de 100.000 francs sous Napoléon et même
de 120.000 pour les ministres de la Guerre et des Affaires étrangères.
Il descendit à 48.000 francs en 1848. Il est aujourd'hui de 60.000
francs. Soit, par mois, 5.000 fr. Ils sont payés régulièrement
le 30 par le caissier de chaque ministère et, chose curieuse,
celui-ci s'efforce toujours de réunir, pour payer le «
patron », des billets de banque neufs et des pièces d'or
nouvellement frappées. C'est une tradition qui se continue régulièrement.
Quand il y a changement de ministère et que ce changement s'effectue
dans le cours d'un mois, on ne peut plus payer le traitement mensuel
on paie alors par jour, tous les mois étant supposés avoir
également trente jours. On verse à chaque ministre sortant
autant de fois 1/30 de son salaire mensuel qu'il est resté de
jours en exercice durant ce mois. Les autres trentièmes appartiennent
au nouveau ministre.
L'État loge ses ministres. Mais un décret de 1911 met
à leur charge tous les frais de la maison jusqu'aux livrées
et cocardes de leurs gens, ainsi que les dépenses afférentes
aux réceptions, repas, buffets, orchestres, vestiaires. Ils doivent
solder également de leur poche les contributions et taxes dont
le paiement incombe légalement aux personnes logées par
l'Etat.
Il faut avouer que, par ce temps de vie chère, soixante mille
francs pour payer tout cela et, représenter généreusement
et dignement la France, ce n'est guère, et qu'un ministre qui
n'a pas de fortune personnelle ne doit guère pouvoir, en quittant
le ministère, s'acheter, comme le lieutenant de la Dame Blanche,
un château sur ses économies.
***
Nous avons eu pourtant, et nous aurons encore de grands ministres à
ce prix.
« Le grand ministre, disait Emile de Girardin est celui que résume
dans sa pensée toutes les saines idées de son temps. »
Or, toutes les saines idées de ce temps-ci se résument
en une seule : l'idée de patrie. Mener la France, par les voies
les plus rapides, à la paix victorieuse, entretenir en elle la
confiance, la certitude de vaincre qui donne la force de supporter les
privations et les épreuves, telle est l'oeuvre à accomplir.
Le ministre qui l'accomplira aura mérité d'être
appelé grand ministre ; son ministère aura été
un grand ministère.
L'opinion publique, qui fait confiance à M. Clemeneau, et qui
connaît l'ardeur patriotique dont il a toujours témoigné
au cours de sa carrière politique, a le ferme espoir que son
ministère sera ce ministère-là.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal illustré du 2décembre 1917