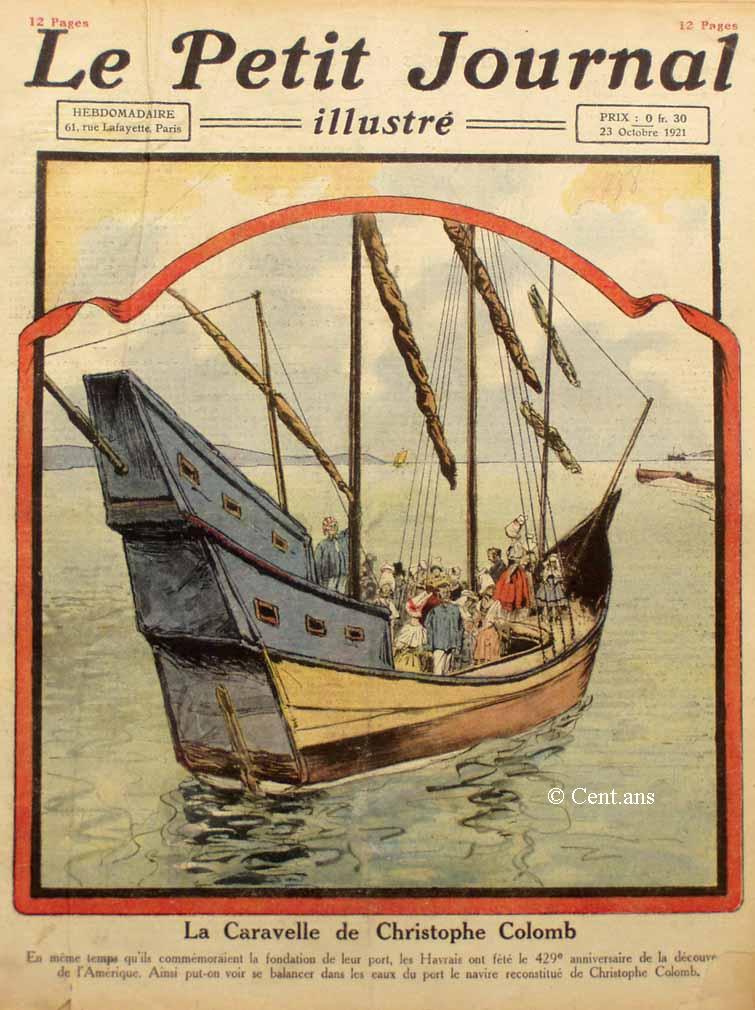Les grands faits
LA CARAVELLE DE CHRISTOPHE COLOMB
On a vu qu'au cours des fêtes du Havre, se trouvait, parmi les attractions
nautiques, la reconstitution, un peu réduite, d'une caravelle. celle
qui avait porté Christophe Colomb vers le Nouveau Monde.
La vérité historique n'a peut-être pas été
très exactement sauvegardée par les Havrais. Mais peut-on
leur en faire le reproche lorsque tant de mystères enveloppent encore
l'origine et les aventures du grand navigateur ? Il n'y a pas si longtemps
qu'on est arrivé à cette certitude que Colomb était
né en Corse, à Calvi, vers 1436. Longtemps on le crut Génois.
Lui-même la laissé croire, par orgueil, pour s'apparier à
la famille illustre des Colombo, de Gênes, et Fernand Colomb, son
fils, qui a raconté sa vie, n'a fait que présenter les événements
sous le jour le plus favorable à la mémoire qui lui était
chère. Au point de vue historique, la plupart des relations de l'époque
sont fausses.
Quoi qu'il en soit, Christophe Colomb se trouvait, vers sa vingt-cinquième
année, au Portugal, s'y était marié et s'occupait de
géographie et d'archéologie. Il s'occupait non moins activement
de commerce et il est à peu près certain que ce fut son désir
de trouver de nouvelles « terres à épices » qui
le poussa à rechercher vers l'Ouest les « Indes occidentales
». Le roi de Portugal, pressenti, refusa de favoriser l'expédition.
Colomb, alors, s'adressa à Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon.
Ceux-ci, séduits par l'idée d'ajouter des colonies à
leur royaume, acceptèrent la proposition.
On accorda au navigateur le titre héréditaire de Grand-Amiral,
la vice-royauté des pays à découvrir et la dîme
de tous leurs revenus. Assuré alors de faire un voyage profitable,
il partit, le 3 août 1492, du petit port de Palos. Des trois caravelles
qui composaient la petite flotte, deux appartenaient à Martin Pinzon,
un armateur de la ville, la dernière au roi. Martin Pinzon partit
avec Colomb sur la Santa-Maria, une caravelle de 23 mètres
de long et qui comptait cent hommes d'équipage dont un certain nombre
de condamnés à mort graciés pour la circonstance.
La navigation fut dure. Il fallut calmer tour à tour les terreurs
et les révoltes des équipages. Enfin, après 65 jours
de traversée, le 1r octobre 1492, l'expédition aperçut
une première terre qui fut baptisée San-Salvador. Puis on
mit le pied à Cuba, enfin à Saint-Domingue. L'Amérique
était découverte.
Par une étrange destinée, Colomb n'eut pas l'honneur de donner
son nom à sa conquête. Ce fuit Amerigo Vespucci, un navigateur
florentin, qui, le premier, démontera, en 1499, que les terres nouvelles
n'étaient pas un archipel, mais un vaste continent interposé
entre l'Europe et les Indes.
Quant au premier géographe qui appliqua au Nouveau-Monde son nom
actuel, ce fut un savant lorrain, nommé Waldseemuller et qui habitait
Saint-Dié. La carte qu'il dressa, en 1506, fut en effet la première
à porter cette appellation : Ameriga Vespucci mourut, en 1512, sans
s'être douté un instant de la gloire qu'on lui accordait. Les
Américains, par contre, n'ont jamais oublié. l'origine de
leur nom et l'on se souvient qu'au lendemain de l'armistice, une délégation
des États-Unis est venue célébrer à Saint-Dié,
dans sa maison natale, le vieux cartographe français.
José Maria de Heredia, le poète puissant, a célébré
dans le sonnet que nous reproduisons ici la merveilleuse aventure de ces
hardis conquérants.
Les fêtes du Havre
Il y a quatre cents ans à pareille
époque, l'espace où s'étend aujourd'hui la ville du
Havre, et toute la partie comprise entre la côte d'Ingouville et l'estuaire
de la Seine n'étaient qu'un immense marécage. Quelque,
criques profondes coupaient cette longue bande de marais ; la principale,
nommée, crique de Grâce, servait au mouillage aux bateaux de
la côte,
C'était là une excellente disposition pour l'aménagement
d'un port. Louis XII y avait pensé ; Francois Ier réalise
l'idée, racheta les droits du seigneur de Graville ; propriétaire
du sol, fit creuser le port et bâtir la ville qu'il dénomma,
Le Havre-de-Grâce.
La ville du Havre s'en est souvenue fort à propos en dressant ces
jours derniers sur l'une de ses plus belles places, la statue du roi-gentilhomme.
François Ier en effet, créa la ville et donna l'essor à
son port. Dés l'année 1510, le Havre-de-Grâce bénéficiait
de tout le trafic commercial de la Manche. De là partaient déjà,
pour les Indes orientales et occidentales, d'innombrables navires ; c'était
le début des relations commerciales avec l'Amérique, qui devaient
bientôt apporter à la ville d'inépuisables éléments
de prospérité.
On ne sait pas assez que François ler fut le premier de nos rois
qui comprit la nécessité pour la France d'être une grande
puissance maritime. Quand il eut fait son port du Havre, il rêva d'avoir
une grande flotte.
En ce temps-là, les flottes marchandes ne comptaient pas de bâtiments
dont la jauge dépassât 1,500 tonneaux. On citait comme des
monstres marins quelques boutres qui transportaient les produits de l'Inde
à Bruges et à Anvers, et qui dépassaient ce chiffre.
François Ier voyait plus grand. Il fit construire au havre un vaisseau
qu'on appela la Grande-Nos et qui jaugeait 2,000 tonneaux, Malheureusement,
la Grande-Nau était lourde et peu maniable on dut démolir
sur place ce navire qui avait très peu navigué.
La ville du havre, en célébrant la mémoire de son fondateur,
aurait pu reconstituer la Grande-Nau, Elle fit mieux c'est la restitution
d'une caravelle rappelant celle dans laquelle Christophe Colomb fit le premier
voyage d'Europe en Amérique, qui fut offerte aux spectateurs.
Par une heureuse coïncidence, en effet, la célébration
du 429e anniversaire de la découverte de l'Amérique vint apporter
un élément de succès de plus aux fêtes du Havre
; et c'est fort à propos que fut honorée la mémoire
du grand amiral, « inventeur » de ces Indes occidentales où
tant de pionniers français devaient aller après lui courir
les grandes aventures.
Combien d'entre eux partirent de ce port du Havre. Combien, lorsqu'ils y
revinrent, furent émerveillés des progrès accomplis
en leur absence.
Depuis quatre siècles, notre grand port n'a pas cessé d'être
l'objet de constantes améliorations.
Richelieu continua l'oeuvre de François Ier i1 doubla le port en
transformant en bassin la crique de la Grande Fosse, voisine de la crique
de Grâce. Ce bassin qui existe toujours tel que te grand cardinal
le fit aménager prit le nom de Basisin du Roy. Colbert y fit mettre
des portes pour qu'il fût constamment à flot. Vauban perça
un bassin nouveau et y amena les eaux de la rivière d'Harfleur.
De jour en jour le port s'agrandissait ; les bateaux affluaient. On creusait
de nouveaux bassins ; et cependant la place manquait toujours, tant le trafic
du port augmentait.
En 1847, on commençait l'immense bassin de Leurre qu'on terminait
en 1860. C'est celui qui devait plus tard être affecté aux
navires de la Compagnie transatlantique.
Quand on eut tout conquis sur la terre, il fallut entreprendre des conquêtes
sur la mer et l'on fit un nouvel avant-port. La loi de 1909 avait prévu,
pour les travaux considérables du port du Havre, plus de 86 millions
de dépenses.
Et cela n'est rien. L'évolution d'un grand port commercial ne doit
jamais s'arrêter : de même que ne s'arrête jamais l'évolution
en matière de constructions navales.
Dans quelles proportions considérables avons-nous vu, depuis une
quinzaine d'années, s'augmenter les dimensions des transatlantiques
!
Le Washington, le premier paquebot de la Compagnie transatlantique
qui, en 1866, fit le service du Havre à New-York, ne portait que
300 personnes, soit 50 hommes d'équipage et 250 passagers. Les transatlantiques
d'aujourd'hui transportent eu moyenne 3.000 personnes, la population d'une
petite ville.
Le Washington avait 105 mètres de long et 13 mètres
de large. C'étaient là des dimensions regardées comme
considérables pour l'époque. N'importe quel transatlantique
d'aujourd'hui a, pour le moins, 200 mètres de long et 28 mètres
de large. On conçoit que pour recevoir ces villes flottantes, il
faille sans cesse améliorer et agrandir les bassins et les ports.
Or, on a déploré bien souvent que ces agrandissements et ces
améliorations se fissent, au Havre, plus lentement que dans les ports
de l'étranger. On citait notamment, avant la guerre, le port de Southampton,
où, en moins de trois ans, on avait construit, pour recevoir les
immenses navires du type Olympic, un port en eau profonde, un bassin et
une forme de radoub.
Au Havre, disaient les spécialistes, il eût fallu plus de vingt
ans... Et encore on n'eût jamais osé faire aussi grand.
La cause en est qu'au Havre, c'eût été l'affaire de
l'Administration. En trois ans, chez nous, le Parlement n'eût même
pas trouvé le temps de discuter le projet.
En Angleterre, l'oeuvre fut entièrement accomplie par l'initiative
privée. L'État n'y eut aucune part. Et voilà pourquoi
tout alla si vite et si bien.
Ernest Laut.
Le Petit Journal Illustré du dimanche 23 octobre 1921