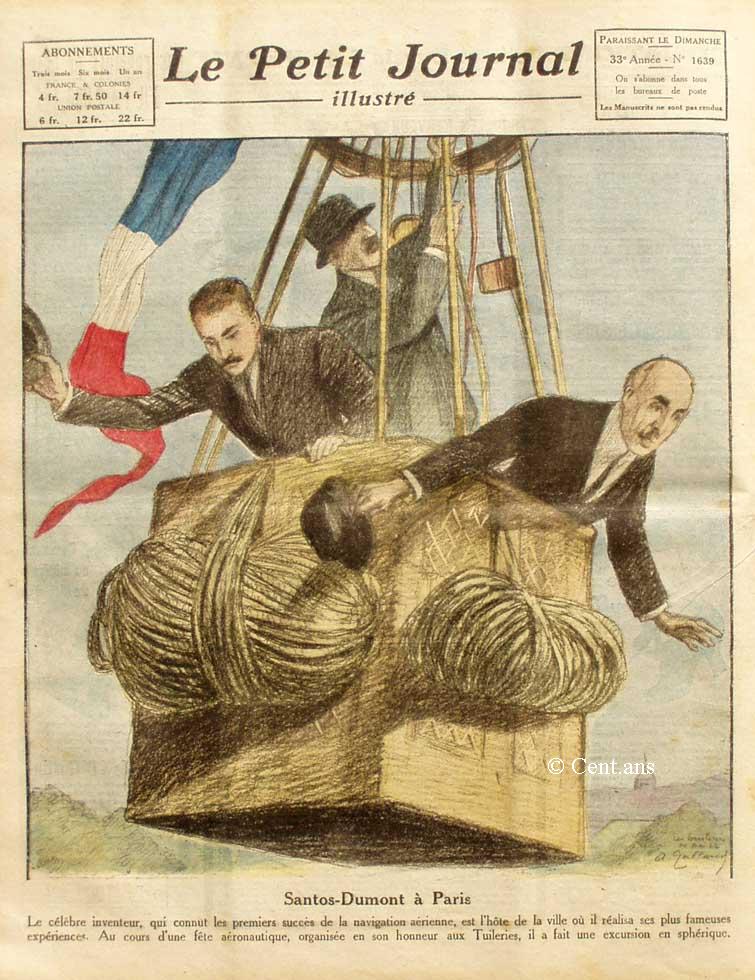Les grands faits
SANTOS-DUMONT A PARIS
En l'honneur du célèbre précurseur de le navigation aérienne, une grande fête fut organisée dimanche aux Tuileries. Le Grand Prix de l'Aéronautique, pour ballons sphériques, fut disputé, et c'est La Cigogne, bord de laquelle avaient pris place, aux côtés de Santos Dumont, le comte de La Vaulx et M. Georges Besançon, aéronautes notoires, qui pilota la course. Treize sphériques s'élevèrent un à un et disparurent dans la direction du Sud-Ouest. La Cigogne qui, bien entendu, ne prenait pas part à l'épreuve, atterrit le soir même à RambouiIler.
La semaine
Le premier vol de Santos-Dumont.- Un siècle d'art floral. - L'homme et l'oiseau.
Santos-Dumont est dans nos murs. Sa présence
parmi nous évoque tout naturellement à l'esprit des vieux
Parisiens plus d'un souvenir.
Je le revois, pour ma part, il y a de cela un peu moins de seize ans - c'était
au mois de novembre 1900 sur la pelouse de Bagatelle le jour où il
conquit le prix que l'Aéro-club avait décidé d'attribuer
à l'aviateur qui ferai un parcourt de cent mètres en ligne
droite.
Il y avait là une foule haletante qui gênait les évolutions
de l'aviateur, mais qui se serait fait hacher sur place plutôt que
de reculer d'un pas.
Sautos-Dumont fit un premier essai dans le sens du vent. Les chronométreurs
le suivaient en automobile, et l'un d'eux - détail singulier dont
les témoins doivent se souvenir - tenait dans ses mains une pile
d'assiettes. Il en laissait tomber une chaque fois que l'aviateur quittait
le sol ou reprenait contact avec lui. On pouvait ainsi mesurer les différentes
envolées.
Cette première épreuve n'eut qu'un succès relatif.
On constata deux vols successifs, l'un de 40, l'autre 60 mètres.
Santos-Dumont décida immédiatement de recommencer l'expérience
en volait cette fois contre le vent. Son aéroplane s'éleva
à cinq mètres environ et passa à quarante kilomètres
a l'heure au-dessus de la foule qui ne se dérangea pas.
Quand il eût atterri, on mesura au décamètre la distance
parcourue. L'aviateur, en 21 s. 1/5, avait volé 220 mètres.
Ce fut, dans le public, un véritable délire. On se précipita
vers le triomphateur. On l'enleva de terre ; il refit, en sens contraire,
les 220 mètres de son parcours sur les épaules de quelques-uns
des plus robustes parmi ses admirateurs.
Il n'y a pas, je le répète, seize ans de cela...
***
Tout évolue, tout s'améliore, tout se perfectionne à
la faveur de la civilisation, du progrès et de la science. D'aucuns
prétendent que l'homme seul fait exception. Mais ce sont les pessimistes
qui disent cela. Tout, dans la nature est susceptible de perfectionnement.
La Fédération des Syndicats horticoles va nous en faire l'expérience
en ce qui concerne la fleur. Elle a eu l'idée, vraiment instructive
et originale, de nous montrer, dans son exposition qui va s'ouvrir, ce que,
grâce à l'art du jardinier, les fleurs ont gagné dans
le cours d'un siècle, en variété et en beauté,
Je ne sais pas s'il est un art qui, en l'espace de cent ans, ait fait autant
de progrès que celui-là, Au début du XIX siècle,
la roseraie de la Malmaison qui était la plus belle, la plus complète
de France, et de laquelle l'impératrice Joséphine donnait
tous ses soins, ne comprenait guère qu'une centaine de variétés
de roses. On en compte aujourd'hui plus de neuf mille.
Combien de fleurs qui furent inconnues de nos aïeux ont enrichi nos
jardins depuis un siècle ! Le Camélia, fleur préférée
des élégantes du temps de Louis-Philippe et du second Empire,
n'est connu en Europe que depuis l'année 1800. L'azalée n'apparut
qu'en l825. Nous avons connu, il y a une cinquantaine d'années, les
premiers chrysanthèmes. C'étaient des fleurs bien modestes.
L'art floral en a fait de pures merveilles.
De même, nos pères ont ignoré jusqu'au nom de l'orchidée,
cette fleur étrange et somptueuse dont certaines variétés
représentent aujourd'hui une fortune.
L'exposition qui va s'ouvrir résumera toutes ces découvertes
et tous ces progrès. Elle montrera aussi l'évolution accomplie
dans l'art de présenter la fleur et de traiter le bouquet. Jadis,
on ne connaissait que le bouquet arrondi en forme de chou avec son entourage
de papier à dentelle. Nos fleuristes ont depuis longtemps renoncé
à cette présentation banale et peu esthétique.
Regardez la moindre bouquetière de la rue, groupant en gerbe quelques
roses, quelques oeillets -
encore une fleur dont les progrès furent merveilleux - avec une ou
deux tiges de mimosa
et un peu de verdure légère, et vous me direz si ce n'est
pas là oeuvre d'artiste, en vérité.
***
Le colonel Howard Bury, l'explorateur du Mont Everest, a raconté,
au cours de la conférence qu'il a faite ces jours derniers à
la Sorbonne, que, dans les hautes régions du Thibet qu'il vient de
parcourir, les animaux sauvages n'étaient nullement effrayés
par la vue de l'homme et venaient au contraire au devant de sa caravane.
Les oiseaux, surtout, vivaient en parfaite intimité avec lui et ses
compagnons.
Les oiseaux sont plus moins sauvages et craintifs suivant qu'on les pourchasse
ou qu'on les traite avec douceur. Allez à Londres : vous pourrez
vous offrir du premier coup la joie, de charmer les pierrots. Il y a, dans
Hyde-Park, un petit kiosque où l'on va prendre le thé avec
des gâteaux. Asseyez-vous sur la terrasse. Vous n'y serez pas d'une
minute qu'une nuée d'oiseaux vous entourera. Les moineaux grimperont
sur votre sable, picoreront dans votre assiette, agiront en un mot avec
vous sans la moindre défiance.
A Paris, rien de pareil. Si vous n'êtes pas leur ami, leur fournisseur
habituel, s'ils ne vous connaissent pas intimement, ils accepteront vos
largesses, mais ils garderont leurs distances.
Cela prouve tout simplement que les moineaux de nos squares n'ont pas toujours
été traités avec autant de douceur que les oiseaux
du Thibet ou les moineaux des parcs londoniens. Ils ont gardé de
ce fait une sauvagerie instinctive et se montrent moins familiers que leurs
cousins de l'Himalaya et leurs frères de l'autre côté
du détroit.
Ernest LAUT.
Le Petit Journal Illustré du dimanche 21 mai 1922