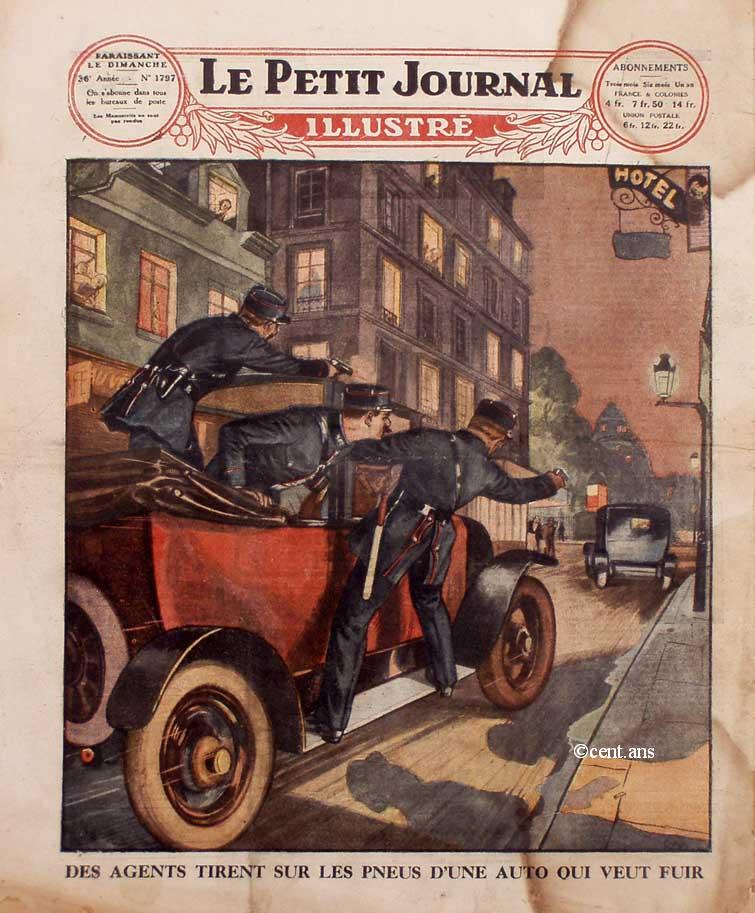Les agents tirent
La paisible rue des Archives, à
Paris, a vu se dérouler, une de ces dernières nuits, un spectacle
comme on en voit seulement se dérouler, au cinéma, dans les
films américains.
Une superbe limousine, faisant d'ahurissantes embardées, accrocha
au passage l'aile d'un camion automobile. Mais, bien loin de s'arrêter,
le conducteur continua sa roule. Des agents accourus lui firent signe de
stopper. Il n'en fit rien. Persuadés alors qu'ils avaient affaire
à des bandits en auto, les agents réquisitionnèrent
un taxi et s'élancèrent à la poursuite du fuyard. Mais
celui-ci, plus rapide, menaçait de disparaître. Les poursuivants
n'hésitèrent pas davantage. Ils sortirent leurs revolvers
et, visant les pneus, se mirent à tirer.
Ce moyen énergique réussit. Bientôt la limousine dut
s'arrêter. On conduisit au poste le plus proche le chauffeur récalcitrant
et là, on s'aperçut qu'on se trouvait simplement en présence
d'un honnête négociant qu'un dîner trop copieux avait
fortement éméché et qui, n'ayant pas sur lui un permis
de conduire en règle, avait eu peur d'entrer en conversation avec
les agents de service sur la voie publique.
Il ne pouvait pas imaginer que ceux-ci recourraient à des méthodes
américaines pour le contraindre au respect du règlement.
L'attirance de l'inconnu
Le Pôle Nord, longtemps inaccessible, va-t-il être un but de promenade ?
C'est un instinct de la nature
humaine de vouloir briser le cercle étroit de l'horizon où
il se sent enfermé, de chercher à aller ailleurs, plus loin,
plus loin encore. Le plus grand nombre ne peut réaliser cet obscur
désir ; tout le long de leur existence casanière, enchaînés
par la nécessité inéluctable, ils restent des rêveurs
d'infini. Mais d'autres, plus favorisés ou plus audacieux, partent,
vont droit devant eux, parcourent le vaste monde. Voyageurs par curiosité
ou explorateurs par passion, ils poursuivent l'inconnu comme un chasseur
traque la bête qui fuit.
Au temps où le progrès n'avait créé ni la vapeur,
ni l'électricité, ni l'automobile, ni l'avion, ni aucun des
engins modernes qui permettent d'aller loin, d'aller vite, le champ des
découvertes à faire semblait illimité. Mais peu à
peu notre globe s'est, pour ainsi dire, rétréci. Toutes les
mers ont été sillonnées, tous les continents, toutes
les îles explorées, tous les sommets escaladés. II n'est
plus un point de sa surface où l'homme insatiable n'ont posé
le pied.
Plus un point !Si, il reste un endroit encore inviolé, la cime du
mont Everest, dans la chaîne de l'Himalaya, la plus haute montagne
du monde. Et c'est pourquoi, depuis quelques années, nous voyons
des expéditions tenter cette ascension vertigineuse, des hommes mourir
pour atteindre ce but, d'autres recommencer derrière eux. Nul n'a
encore réussi. Mais soyez sûrs qu'on y parviendra et qu'après
le premier vainqueur, il se trouvera des imitateurs pour refaire la même
conquête, affirmer ainsi que le sommet de l'Everest appartient aux
hommes aussi bien qu'un faubourg de Londres ou une forêt du Congo.
Ce besoin de réitérer l'expérience, de l'humaniser
en quelque sorte, de la vulgariser, nous venons d'en avoir un exemple. Le
Norvégien Amundsen qui, en 1911, était parvenu au pôle
Sud par les moyens ordinaires, c'est-à-dire à pied, accompagné
de traîneaux. Amundsen a voulu conquérir en avion le pôle
Nord, atteint avant lui, en 1900, par le commandant Peary.
Je ne nie pas que sur la calotte glacée de notre globe tournoyant,
il y ait d'intéressantes observations scientifiques à faire,
à compléter
même à l'occasion. Mais un raid en avion jusq'au pôle,
un raid dont l'aller et le retour ne tirent en tout que quelques heures,
ressemble plus à un tour de force, à une gageure qu'à
un voyage d'exploration utile. Ce que Peary avait réalisé
au prix des plus effroyables difficultés, Amundsen a voulu l'accomplir
de nouveau, facilement, comme en se jouant et pour pouvoir dire ensuite
- Vous voyez bien ! Le pôle Nord n'est pas si loin. On peut y aller
comme on veut. C'est un endroit de la terre aussi banal que les autres !
Et peut-être en effet le deviendra-t-il ? Mais combien de temps, combien
de peines, combien de morts il aura fallu pour ce résultat !
Le premier qui songea, sans doute, à risquer cette tentative fut
Davis, qui, en 1586, atteignit le 72°41 de latitude nord et fut arrêté
par la banquise. A partir de ce moment, les explorations se multiplièrent.
On ne saurait les rappeler toutes. Citons cependant Henri Hudson, qui, en
1609, découvrit le Spitzberg et pénétra dans le détroit
qui porte son nom ; Behring qui, en 1728, eut également l'honneur
de baptiser un détroit ; la mission Parry qui, en 1819, fit la première
exploration systématiquement organisée avec hivernage, raids
vers le Nord et relevés scientifiques.
Puis c'est le long martyrologe qui commence. En 1832, le lieutenant français
Jules de Blosseville s'élança du Groenland vers le pôle
et disparut avec toute sa mission. En 1845, Franklin, dont c'était
la troisième tentative, disparut de même. Vingt missions se
lancèrent à sa découverte. Quatre ans plus tard seulement,
l'une d'elles trouva les restes de Franklin et de ses compagnons. Ces morts
tragiques ne découragent pas les hardis conquérants du pôle.
Ils se font de plus en plus nombreux. Nansen, en 1895, gagne le point le
plus élevé qui ait été atteint jusqu'alors.
Le 11 juillet 1897, le Suédois Andrée, avec deux camarades
d'aventure, s'élance vers le Nord en ballon. Il n'en revint jamais.
L'expédition de Toll, en 1902, fait quatre victimes. Antundsen, dont
on reparle aujourd'hui, découvrit en 1905 le passage du nord-est,
mais perdit, au cours de son voyage, plusieurs compagnons. Enfin voici celui
qui devait être le conquérant du pôle !
Dès 1885, Peary commença ses explorations dans l'Océan
Arctique. En 1891. Il fit sa première tentative. Il la recommença
en 1893, puis en 1896. Enfin il repartit de nouveau en 1905 et ce fut seulement
le 6 avril 1909 qu'il planta son drapeau Point exact où il n'y a
plus, par un phénomène géographique assez déconcertant
quand on y pense, ni nord, ni ouest, ni est, de quelque côté
qu'on se tourne, on a toujours en face de soi, et uniquement, le sud.
Au moment où nous mettons sous presse, on n'a encore reçu
aucune nouvelle des avions montés par Amundsen et ses compagnons.
Il faut espérer qu'on n'aura pas à ajouter de nouveaux noms
à la liste trop longue des martyr du pôle et, quel que soit
le caractère de ce raid, qu'il se terminera heureusement et pour
le sport et pour la science.
Roger Règis.
Le Petit Journal Illustré du dimanche 31 mai 1925