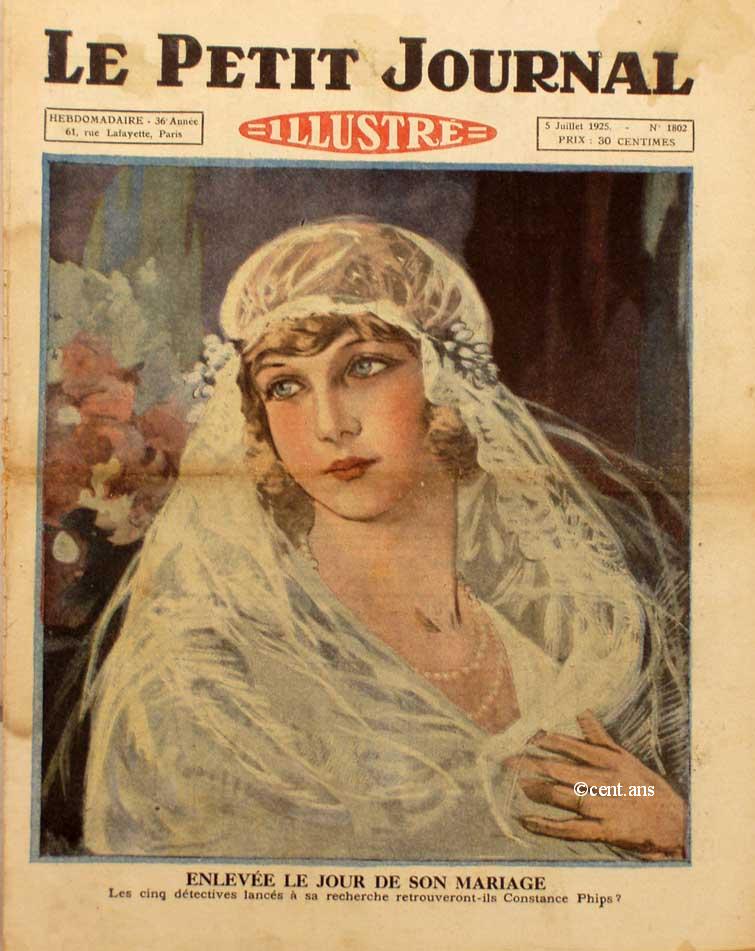Disparue le jour de son mariage
Il se produit tous les jours, dans la réalité, des faits étranges,
mystérieux, dont nous nous étonnons. II n'est donc pas impossible
qu'une jeune fille disparaisse le jour de son mariage.
Mais l'événement a de quoi
nous surprendre quand il se passe dans des circonstances aussi spéciales
que celles-ci: Constance Phips est la fille unique d'un milliardaire américain.
De passage à Paris, sa beauté blonde et touchante séduit
un gentilhomme français qui demande sa main et l'obtient. Le mariage
a lieu à la Madeleine avec une magnificence, une splendeur qu'on
imagine. Une foule de curieux, de journalistes, de photographes assiègent
l'église à la sortie des jeunes époux. Puis ceux-ci
se rendent dans un vaste hôtel où doit avoir lieu le repas
offert aux invités. Or, au moment de se mettre à table, on
s'aperçoit que Constance Phips a disparu !
Qu'est-elle devenue ? L'a-t-on enlevée ? La retrouvera-t-on ? Tel
est le problème angoissant qui se pose.
Pour le résoudre, Il faut rire « Les cinq détectives
» le passionnant roman de Gabriel Bernard dont le Petit journal
illustré commence aujourd'hui la publication, pour la plus grande
joie de ses lecteurs forvents des beaux récits d'aventures et d'amour.
Tout le monde, nous n'en doutons pas, voudra connaître l'émouvante
histoire de cette jolie héroïne dont nous donnons le portrait
en première page.
Ce portrait, dû au pinceau délicat de l'excellent artiste
qu'est notre collaborateur Raymond Motiz a tout pour séduite même
les plus difficiles. On y peut admirer tout à la fois le charme pudique
de la jeune fille, un peu rougissante sous son voile blanc de mariée,
et la grâce très particulière de l'Américaine
en qui se confond le sang de plusieurs races, quintessence en somme de plusieurs
beautés différentes.
Le fait de la semaine
Le timbre à six sous et la circulation postale - Une loi immuable .
Dans la plus triste période de l'histoire
contemporaine de la France, la taxe des lettres n'a pas monté à
plus de vingt-cinq centimes... La voici bientôt à trente.
Le timbre-poste, en France, ne date que de soixante-seize ans. Auparavant,
le coût du transport des lettres était proportionné
à la distance, et c'était non l'expéditeur, mais le
destinataire qui payait la taxe en recevant le pli.
Dans le dernier tiers du XVIIe siècle, l'Etat prit le monopole des
postes. Une lettre coûtait alors, de Paris à Bordeaux, cinq
sols; de Paris en Angleterre, dix sols (il y avait deux bateaux par semaine)
; de Paris à Liége, seize sols. Le sol équivalait,
comme pouvoir d'achat, à trente centimes environ de notre monnaie.
Ce n'était pas trop cher, si l'on songe à la difficulté
des communications et à l'état des chemins en ce temps-là.
Cent ans plus tard, une lettre, expédiée à moins de
vingt lieues coûte quatre sous, à cent lieux dix sous; au-dessus
de cent cinquante lieues, quatorze sous.
On conçoit qu'à un tel tarif, les Français n'écrivaient
guère.
Or, dans le premier tiers du XIXe siècle, les choses n'en allaient
guère mieux; et la population se plaignait fort de l'énormité
des taxes dont le port des lettres était frappé. Ces taxes
étaient toujours, comme deux siècles auparavant, calculées
suivant la distance. Elles étaient énormes pour les lettres
qui allaient d'un bout de la France à l'autre. Un journaliste d'alors,
qui protestait contre l'excès de ces redevances, disait qu'une lettre
venant de Toulon à Paris, coûtait à celui qui la recevait
la valeur d'une journée de travail.
Au tarif de 1827, il fallait payer pour une lettre expédiée
de Marseille à Paris, la somme de 1 fr.20 centimes.
L'Angleterre eut le timbre-poste en 1840.
La France hésita neuf ans avant de suivre le bon exemple, et les
Français, quant au montant de la taxe, furent infiniment moins favorisés
que leurs voisins,
Le premier timbre, créé le 1er janvier 1849, fixait le port
des lettres à 0 fr.20. Un an plus tard, le gouvernement élevait
le tarif à 0.25. En 1853, on revenait à 0.25, pour remonter
0.25 en 1871. En 1878, on se décida pour 0,15; et, en 1906, on en
vint enfin au tarif. de 0. 10, dont les Anglais jouissaient depuis soixante-six
ans.
Le timbre ne resta à ce prix réduit que pendant dix ans. La
guerre vint : en 1916, on remonta à 0.15. En avril 1920, on revint
au prix fort de 0.25, tarif qui n'avait plus été appliqué
depuis les jours de misère et de deuil de 1871.
Enfin, cette fois, ce record lui-même est dépassé;
L'État, en appliquant ce tarif, après avoir, en ces dernières
années, relevé considérablement toutes les taxes postales,
télégraphiques et téléphoniques, ne se montre-t-il
pas quelque peu imprudent ?
Il est une loi économique immuable qui veut que la consommation,
en toutes choses, augmente quand les prix sont bas, et qu'elle diminue considérablement
quand les prix sont trop élevés.
L'Administration des Postes a fait, dans le passé, quelques expériences,
pourtant convaincantes, de la vérité de cette loi.
En 1871, quand on releva la taxe des lettres à on espérait
une plus-value de 20 millions; on n'en obtînt même pas la moitié.
L'excès des taxes fiscales, suivant la pittoresque expression de
Mirabeau le père - Mirabeau « l'Ami des Hommes », - produit
l'effet de l'épervier sur la basse-cour : il fait fuir la matière
imposable.
Quand le timbre est fixé à un prix trop élevé,
on écrit le moins possible; quand il est à un prix raisonnable,
on écrit beaucoup.
Lorsqu'en 1903 fut effectuée la réduction du timbre de 0.15
à 0.10. on constata que cette réduction n'avait causé
dans les recettes qu'un fléchissement momentané. Bientôt,
la lettre coûtant moins cher, les Français prirent l'habitude
d'en écrire un plus grand nombre, et le déficit prévu
fut comblé.
C'est une expérience qui a toujours donné les mêmes
résultats. Autrefois, les cartes pneumatiques, les « petits
bleus » valaient 50 centimes; on les abaissa à 30. Immédiatement,
l'augmentation de consommation fut assez forte pour compenser d'emblée
la diminution de prix. La réforme n'entraîna pas de déficit
même la première année.
Depuis la guerre, le « petit bleu » a été reporté
à 4o centimes; le public s'en est servi beaucoup moins; on en a élevé
le prix à 6o, puis à 75 centimes : le public ne s'en sert
plus du tout.
Du train dont on va - car il parait évident qu'on n'en restera pas
là - les taxes postales, télégraphiques et téléphoniques
ne tarderont pas à atteindre des taux réellement prohibitifs.
Elles gêneront le commerce et feront encore augmenter le prix de la
vie - pourtant assez élevé comme cela. Quant aux profits qu'en
retirera le Trésor, nous en reparlerons.
Une chose est à craindre, c'est que ces augmentations excessives
diminuent la circulation postale et télégraphique et réduisent
l'usage du téléphone. Ce serait un résultat profondément
funeste. Toute diminution d'activité des services publics est un
signe d'affaiblissement général; et c'est un pays en décadence
que celui ou les progrès de la civilisation ne peuvent plus être
mis à la portée de tous.
Ernest Laut .
Le Petit Journal Illustré du dimanche 5 juillet 1925